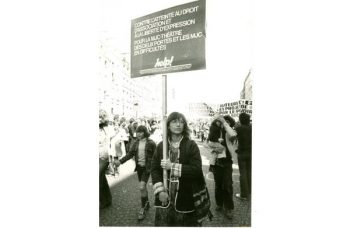Alice Pallot utilise la pratique photographique pour mettre en évidence des problèmes écologiques bien souvent invisibilisés. Elle collabore avec des scientifiques et crée des images à la lisière entre l’image document et la science-fiction. Ses séries photographiques prennent la forme de récits et sollicitent notre réflexion sur les menaces invisibles, tangibles, qui pèsent sur les milieux naturels fragilisés par l’anthropisation.
Elle a récemment développé le projet Algues Maudites (2022–2025), qui traite de l’impact des marées vertes en Bretagne (Côtes-d’Armor) sur la biodiversité et les écosystèmes du littoral dans la baie de Saint-Brieuc, accompagnée par l’association Sauvegarde du Trégor et le scientifique Frédéric Azémar (CNRS). Dans ce projet, elle étudie l’eutrophisation de la matière organique et l’influence conjointe du réchauffement climatique et de l’augmentation de la luminosité sur la photosynthèse des algues marines. Pour rendre visible cette présence excessive de phosphore ou d’azote dans un écosystème provoquant son asphyxie, avec Frédéric Azémar, elle a recréé en aquarium les conditions d’un milieu saturé d’algues évoluant vers une carence en oxygène. Elle a ensuite documenté cette expérience dans le film Anoxie Verte.
Pauline Lisowski : Comment te positionnes-tu parmi les artistes qui interrogent le vivant et les enjeux liés au climat? De quelle manière ton engagement a-t-il évolué ?
Alice Pallot : Le projet Algues maudites fut un projet charnière, le plus engagé avec des scientifiques. Avant celui-ci, j’ai toujours essayé d’avoir un lien avec les sciences, de traduire des données scientifiques, de les donner à voir, notamment au travers de la série Oasis réalisée avec Botanical Agency (duo de praticiens de l’espace basés à Paris et à New York, Elena Seegers et Simon de Dreuille, formés en architecture, botanique et histoire de l’environnement). Cette série porte un regard véridique sur la beauté́ et la brutalité́ des déchets générés par l’industrie florale. OASIS est le nom du produit phare de la société́ américaine Smithers-Oasis, spécialisée dans la fabrication de blocs verts de mousse à base de plastique qui, comme leur nom l’indique, gardent les arrangements de fleurs fraîches humides et les maintiennent en place. La mousse OASIS est en effet une solution pratique pour le design floral, mais elle est également hautement toxique et non biodégradable. Elle se décompose rapidement en une poudre fine, source d’une pollution diffuse, agressive et durable.
Le projet Algues maudites est lié à une problématique très concrète, les déchets de l’agriculture intensive, avec une cause très définie, dont on connaît les conséquences. Je cherchais à percer une bulle d’omerta environnementale, à la raconter d’une autre manière.
D’autres scientifiques de Rennes m’ont ensuite contactée pour un projet au Maroc. Puis, j’ai travaillé avec le CNRS Occitanie ouest durant la résidence R1+2 en collaboration avec le CNRS Occitanie Ouest où j’ai pu échanger avec les scientifiques sur le gaz H2S, imperceptible. J’ai notamment eu une commande du CNRS qui voulait que je fasse des projets artistiques sur des recherches. Au Maroc, j’ai enquêté sur le macaque de Barbarie dans la plus grande forêt de cèdres au monde pendant quelques mois. L’enjeu était de travailler sur la sécheresse et les impacts qu’elle peut avoir, à travers l’étude du comportement du macaque de Barbarie. Ensuite, l’agence spatiale européenne en collaboration avec Leica a fait appel à moi pour créer un lien entre leurs images vues du ciel, des images satellites, et mes photographies.

P.L. : Ton travail artistique cultive à la fois une forme de poésie, suscite la contemplation et des interrogations. Tes images oscillent entre réalité et fiction, entre rêverie et documentaire. As-tu toujours voulu cultiver cette ambiguïté-là ?
A.P. : Je trouve que nous sommes dans une société où il y a tellement d’images. Il y a tellement d’images que produire des images chocs ne m’intéresse pas. J’ai envie de réaliser des images esthétiques qui vont nous emmener dans un imaginaire de l’ordre de la synergie collective, également nous alerter. Je cherche à attirer pour mieux questionner en créant un imaginaire de l’étrange qui nous alerte sur une situation.
En cultivant une ambiguïté entre le réel et le non réel, une sorte d’étrangeté va peut-être émerger de cette esthétique. Il s’agit de faire comprendre une problématique sans devoir lire un texte scientifique et de rentrer dans le sujet directement en étant impacté par l’image. De fait, je crée des images étranges et belles qui permettent aux spectateurs de s’interroger sur une problématique environnementale. Nous pouvons avoir l’impression que certaines images de la série Algues maudites peuvent être un peu lunaires et que d’autres non. Je cherche à invoquer ma vision d’un futur proche à travers la documentation du réel, du présent. Les spectateurs peuvent penser que ce sont des images retouchées alors que les images ont été réalisées sans retouches, avec des déchets que j’utilise comme filtres.
P.L. : Dans tes premières séries, le cadrage et les couleurs étaient importants.
A.P. : Pour la première série, réalisée à l’occasion de mon diplôme, LÎle Himero, un travail sur les îles éoliennes volcaniques, je construisais un univers, un monde en dé-contextualisant le tout. La série présente des images qui donnent l’impression d’un monde complètement fantasmagorique, alors qu’il s’agit d’un volcan habité.
P.L. : De quelle manière associes-tu tes photographies entre elles, notamment par le biais de l’exposition ou de l’édition ?
A.P. : J’ai eu des approches très différentes selon les temporalités et selon les projets. Pour mon premier projet, LÎle Himero, il y a eu d’abord mon diplôme. Ensuite, j’ai auto-édité un livre en 20 exemplaires.
Après, j’ai réalisé la série « SUILLUS, Looking at the sun with closed eyelids » pendant le Covid, à l’occasion de l’appel à projet « The World Within » avec le Hangar, à Bruxelles. Cette série évoque l’ombre noire de l’imperceptible pollution du zinc, qui perdure encore aujourd’hui dans une relation tendue avec une nature renaissante. Elle s’efforce de souligner le contraste entre l’apparence idyllique du Sahara et sa réelle toxicité́ sous-jacente, les images ayant été́ élaborées sur place du lever au coucher du soleil sans retouches. Un nouvel espace se crée, un micro-écosystème où réalité́ et fantasmagorie fusionnent.
Cette œuvre a été exposée pendant 4 mois à Hangar, parmi 27 autres projets sur le confinement. Cela m’a menée à un projet collectif qui consistait à réaliser une auto-édition en collaboration avec des amis, qui allaient chacun, chacune apporter quelque chose. Un ami sérigraphe a réalisé la couverture, une amie spécialisée en reliure a collaboré sur le projet éditorial, une amie curatrice a écrit le texte.
Ensuite, le projet Algues maudites, avec la première série produite grâce à la résidence R1+2, a résulté d’une résidence de trois semaines. La Villa Pérochon puis l’ESA avec l’Agence Spatiale Européenne et Leica m’ont demandé de continuer le projet d’une autre manière, de pousser les recherches que je n’avais pas terminées à travers les différentes résidences. Ce qui m’a permis de poursuivre mes recherches notamment sur l’expérimentation avec les algues toxiques qui poussaient sur les tirages. L’équipe du centre d’art contemporain photographique m’a régulièrement dit pendant la résidence que ce qui leur importait n’était pas le résultat final, mais l’expérimentation.
Par ailleurs, je suis très inspirée par les univers cinématographiques et considère mes séries comme des films, des storyboards, par narration, par typologie d’histoires. Je crée des liens entre une nature morte, un paysage, un portrait, une image microscopique, une image d’archive, une image d’archive revisitée, une image qui a été réalisée via une expérimentation.

P.L. : Quand tes images sont exposées, elles constituent donc des récits. Quand tu crées des livres, les réalises-tu de la même façon ?
A.P. : La narration me semble accentuée dans les livres. Le livre du projet SUILLUS est composé avec beaucoup de pages blanches, afin de transcrire des moments d’attente, de vide, des temporalités qui sont très différentes d’un quotidien habituel sans crise sanitaire.
Ce rapport à la narration est en effet accentué par le livre et par le fait de pouvoir l’exprimer d’une autre manière en tournant les pages d’une certaine façon, avec des vis-à-vis, avec du texte. Pour le livre ALGUES MAUDITES, A SEA OF TEARS, édité par AREA BOOKS, Michel Poivert a écrit une préface pour laquelle il se met à la place d’une intelligence artificielle. Il a réécrit une histoire dans mon histoire. Selon moi, cela renforce à 100 % le côté narratif que l’image donne déjà. De même, dans le livre rouge pour ALGUES MAUDITES, RED BLOOM, Luce Lebart a écrit dans sa préface un lien narratif que je n’avais pas perçu : elle compare les expérimentations, les tirages putréfiés à des charognes de Baudelaire. Dans ce livre, Andreina De Bei, rédactrice en chef adjointe du magazine Sciences et Avenir, mène un entretien avec un scientifique et un militant avec qui j’ai travaillé. Elle a dû leur poser certaines questions d’autres manières, et trouver des formes pour exprimer des problématiques globales, qui n’ont pas le même retentissement pour le militant et pour le scientifique. Le livre a permis de débloquer certaines choses dans la recherche aussi, conceptuellement. En somme, l’objet livre induit un autre élément de l’ordre de la narration.
P.L. : À la suite du projet Algues maudites où l’image était d’une certaine manière vivante, en évolution, presque dans un processus de détérioration, comment vas-tu te positionner pour les projets à venir ?
A.P. : Ces images vivantes sont nées suite à un accident en laboratoire au CNRS : J’avais placé des algues sur un tirage pour faire une photographie, je les avais laissées, et puis, trois semaines plus tard, j’ai vu que le tirage avait évolué, et je me suis dit que ce serait dommage de ne rien en faire. Il s’agissait d’une expérimentation visuelle de la matière et du toxique. Maintenant, comme cette série photographique a déjà connu plusieurs présentations dans différents territoires, j’ai envie qu’une exposition puisse voyager d’une autre manière. Selon moi, pour être respectueux de l’environnement, il serait nécessaire de construire des expositions avec des œuvres uniques, réalisées sur un temps long, avec le moins de processus chimiques possible, et qui puissent durer ou pas, dans le temps. Ces œuvres-là pourraient voyager, trouver une itinérance d’exposition de manière un peu locale, déjà dans le même pays, et après voyager plus loin.
P.L. : Tes projets sont toujours nés d’une rencontre ou d’un fait de société où une problématique importante est à soulever… Est-ce que cette méthode de travail relève de l’expérimental ?
A.P. : Le processus expérimental n’est pas uniquement présent dans la finalité d’un projet. Il l’est aussi dans la manière d’aborder le sujet. Mes projets partent toujours d’une rencontre liée à une problématique environnementale.
Mon nouveau projet, en Ariège, intitulé Là-Haut, dans les lacs des Pyrénées, part d’une rencontre avec un scientifique assez militant.
P.L. : Tu évoques l’impact de tes projets et comment faire différemment. Vas-tu limiter ton nombre d’images ? Est-ce que la résidence est un moment uniquement de recherches ? Comment ces différents temps s’élaborent ?
A.P. : Pour ce projet-là, j’ai une bourse du CNAP. J’ai un an et demi pour réaliser les photographies. Après vient le temps des expositions. Ma volonté serait de produire très peu d’œuvres en termes de quantité d’expositions.
P.L. : Envisages-tu d’autres collaborations avec des personnes aux profils variés ?
A.P. : Récemment, j’ai eu l’occasion de rencontrer Estelle Zhong Mengual et Baptiste Morizot dont les recherches et les écrits me passionnent. Il m’intéresserait de voir comment les scientifiques et les philosophes vont appliquer leurs recherches en regardant mes photographies.
P.L. : Tu fais partie d’un collectif d’artistes. Que t’apporte le fait de travailler à plusieurs ?
A.P. : Le collectif est vraiment essentiel dans l’art, mais surtout en tant que photographe, car on est souvent seul lorsqu’on élabore un projet. Je souhaite créer en collectif, partager et rendre compte d’un monde abîmé ensemble à travers différentes écritures photographiques. Je veux poser des questions, faire bloc, sensibiliser, alerter. J’ai le sentiment d’un moment charnière actuel autour du médium, que les formes esthétiques expérimentales touchent et permettent d’agir, de rendre visible de manière de plus en plus probante. J’ai pour projet de continuer vers cette voie, porter le non visible à travers une réinvention du médium photographique, mais aussi vers le décloisonnement d’autres médiums.
En 2019, j’ai créé le collectif De Anima avec six personnes, des architectes, un scénographe, deux biologistes. Nous souhaitions créer en collaboration avec la nature et dans une sorte d’harmonie avec le vivant qui nous entoure. Nous avons réalisé des œuvres vivantes et avons travaillé pendant quatre ans sur le champignon.
Nous avons eu l’opportunité d’être sélectionnés pour l’exposition Unbound durant la foire Unseen à Amsterdam, curatée par Damarice Amao du Centre Pompidou. Nous souhaitions laisser les champignons vivre dans l’exposition et créer une sorte de collaboration de manière à le laisser s’exprimer. Nous sommes partis de données de recherche scientifique qui stipulent que certains champignons, notamment les pleurotes, pourraient avoir un langage de plus d’une cinquantaine de mots.
Nous avons alors mis des champignons dans l’exposition, à travers des briques qui ont été recyclées, qui ne sont plus utilisées pour le commerce, mais où des champignons poussent tout de même, beaucoup plus lentement. Nous avons ainsi confectionné un appareil électrique, mis des électrodes sur les champignons, pour leur donner une voix, et faire en sorte d’écouter leur langage. Nous nous appuyons sur une recherche, la montrons de manière à la rendre tangible, presque en tant qu’expérience sensible. Le collectif permet aussi de déployer des moyens artistiques, physiques, même financiers, qui ne sont pas les mêmes.
Actuellement, je fais partie du collectif Tendance Floue que je viens de rejoindre. Ce qui permettra de nous poser d’autres questions, sur le rapport à la photographie.