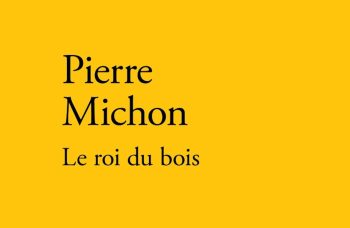Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui, nous publions une contribution de Itzhak Goldberg.
En 2002, dans les Cahiers de médiologie, cette science hybride entre l’art et la communication, Daniel Bougnoux déclare non sans un certain pathos :
« Tous les hommes sont égaux mais personne n’est le portrait exact d’une autre personne… Support de désir, de séduction, d’étrangeté, fenêtre sur l’âme, chaque visage est un mystère, dont le portraitiste traque le sens, à moins qu’il n’en approfondisse l’énigme[1] ».
A priori, le visage cherche à saisir la particularité d’un être, le dépouiller de sa part de connu pour en dévoiler l’inconnu. Tout en représentant une humanité commune, le portrait définitif, utopique, était censé faire voir ce qui reste inévitablement « l’absolument autre » selon Levinas.
Nous nous heurtons également à une autre difficulté, celle de l’approche traditionnelle de la série en histoire de l’art. Souvent perçue selon une perspective « générique » qui néglige le sujet, l’étude de la série se réduit essentiellement à une analyse formelle du modèle, en en évacuant la spécificité iconographique. Tradition qui trouve sa justification avec le rapprochement de la naissance de la série dans la pratique impressionniste. L’argumentation est bien connue ; avec les impressionnistes le sujet est banalisé, traité comme motif et l’accent est mis sur les composants picturaux de l’œuvre. Ce célèbre passage « de quoi à comment » donne déjà lieu à une phrase prophétique de Thadée Natanson, le fondateur de la revue symboliste, La revue blanche, qui déclare à propos de Monet que l’étape suivante de son travail artistique serait de peindre « un cube de pierre ». Monet serait-il aussi le père de la série minimaliste ?
Cette omission de l’analyse sémantique n’est plus possible avec le visage, car c’est justement son caractère spécifique qui contraste avec le principe régulateur de la série. Pas toujours toutefois, car curieusement il existe une autre possibilité d’envisager le lien entre le visage et la série. La série serait aussi une pratique obsédée par cet objet impossible à cerner qu’est le visage. Le visage unique reste inaccessible, car il n’est ni stable, ni fixe, mais en changement constant. Autrement dit, on répète ce que l’on n’arrive pas à dire une fois pour toutes ou encore pour l’affirmer avec force.
On trouve indirectement cette idée chez Freud qui, en parlant de ce que l’on peut nommer le cérémonial névrotique, décrit le sujet pris dans une incapacité à atteindre un but idéal et contraint en conséquence à « de petites pratiques, petites adjonctions, petites restrictions, qui sont accomplies, lors de certaines actions de la vie quotidienne, d’une manière toujours semblable ou modifiée selon une loi[2] ». Entre obsessions et religion, on aura du mal à trouver une meilleure définition de la série.
Si l’espoir de capter le visage humain a longtemps animé la peinture, le XXe siècle, lui, hanté par ce qu’il ne peut saisir, fasciné par ce qu’il sait ne pas pouvoir accomplir, entreprend à son tour cette quête sisyphéenne et s’obstine dans cette fiction, mais en connaissance de cause et en faisant souvent appel à la série.
Personne d’autre que Giacometti n’est mieux placé pour emblématiser cette quête, cette dernière étape de l’aventure humaine, humaniste même, dans sa lutte interminable avec ou contre ses modèles, avec sa recherche désespérée de la « ressemblance ». Dans son cas, c’est un effort paradoxal : c’est chaque fois à l’aide d’une série qu’il tente de former un visage unique ou même le visage. Un effort désespéré, tant le peintre et sculpteur suisse, dans sa « poursuite morcelée » qui passe dix fois par le même chemin, est tantôt trop proche de son objet qu’il pétrifie et consume, tantôt trop éloigné. Cette quête visagière de Giacometti permet de faire la distinction entre le visage sériel et une série de visages. Il ne s’agit pas simplement d’une formulation différente pour cette technique artistique, mais de l’écart entre la série traditionnelle et la série dans sa version moderne.
La série n’est pas une invention du XIXe siècle. On peut qualifier de série, ou de séquence sérielle, les stations du Chemin de croix, les représentations des quatre saisons, des cinq sens, des mois de l’année, etc. Cependant, à la différence de ce type de série qui fonctionne sur un principe narratif (les liens entre les éléments sont alors de nature logique et chronologique), la série contemporaine déplace l’accent sur la syntaxe plastique, changement qui bouleverse les conceptions traditionnelles. De fait, elle fonctionne sur les ressemblances et les différences découvertes entre plusieurs éléments de même type. Quant aux visages, il s’agit d’un thème particulier. Certes, on n’y trouve pas la dimension narrative, caractéristique de la série traditionnelle. Toutefois, en regardant les autoportraits de Rembrandt, de Dürer ou, plus proches de nous, de Bonnard ou de Helene Schjerfbeck, on constate la volonté de ces artistes d’introduire la dimension temporelle. Par contre, il n’existe pas chez eux une volonté consciente de créer un dispositif formel pour les unifier.
Cette volonté apparaît chez le peintre expressionniste Alexej von Jawlensky, qui est le premier à pratiquer d’une manière systématique le visage sériel. L’artiste déclare : « J’éprouvais le besoin de trouver une forme pour le visage[3] », déclaration suivie par une expérimentation qui dure pendant toute sa longue carrière artistique. Ainsi, quand les premiers visages, ceux qu’il réalise avant 1914, sont encore distincts les uns des autres et gardent une certaine ressemblance avec leur modèle, dès 1917 sa pratique se modifie radicalement. Pendant vingt ans, Jawlensky traite presque exclusivement ce thème à travers trois séries : Têtes mystiques, 1917/1923, Têtes géométriques, 1924/1933, Méditations, 1933/1937. Le processus de stylisation entrepris se manifeste déjà avec la série des Têtes mystiques. Le peintre s’engage sur un chemin qui le mène au dépouillement et où le travail stylistique effectué tend à éliminer toutes les traces d’individualisation perceptibles. La volonté d’aboutir à un archétype est encore plus manifeste, plus systématique, avec les Têtes abstraites, série de têtes géométriques réalisées à partir de 1921. Ici, les lignes nettes sont d’une précision mécanique et délimitent les zones de couleur ; Jawlensky aboutit à un modèle linéaire stable où seuls varient désormais les aspects chromatiques. Puis, avec la dernière série, Méditations, c’est autour d’une composition cruciforme que le visage s’articule. Cependant, cette volonté de réaliser des séries de visages, unifiées par une structure commune, ne se résume pas uniquement à son aspect formel. Le visage est multiple, mais s’inscrit dans une quête du visage unique. Une autre phrase de l’artiste exprime clairement son désir : « j’avais compris que la grande peinture n’était possible qu’en ayant un sentiment religieux. Et ceci je ne pouvais le rendre que par le visage humain[4] ».

Dans sa quête, Jawlensky vise ainsi à dépasser la condition anthropomorphique pour aboutir à une forme d’utopie singulière, celle du visage abstrait, mais dont l’abstraction est chargée d’une forme extrême de spiritualité, voire religiosité. Cette façon d’envisager le visage sériel nous permet de souligner le caractère des visages des années soixante, qui, en apparence, semblent se fonder sur le même principe formel unificateur. D’ailleurs, Lichtenstein reprend une des Têtes mystiques, la recyclant à sa façon[5]. Mais, clairement, ces nouvelles figures humaines, isolées ou encore plus au sein d’une série, ne s’engagent pas dans un chemin expressif ou spirituel comme c’était le cas chez Jawlensky. Toute visée humaniste disparaît quand, dématérialisés sans être altérés, les visages se voient remplacés par des signes qui célèbrent l’anti-héroïsme de la vie moderne. Réduits à une vision stéréotypée qui s’arrête à la surface de la toile, dénués d’émotion, vidés de toute expressivité, ils tirent leur pouvoir de fascination ou d’hallucination de cette éviction de toute trace de vie. Avec le pop art, ces faces à l’aspect lisse et brillant d’une pellicule-épiderme, entourées d’objets de consommation, ne sont plus que « choses » parmi d’autres. La structure de ces toiles où tous les composants se trouvent sur le même plan, détachés les uns des autres, isolés sans hiérarchie aucune, indique clairement la remise en question de la vision égocentrée, depuis toujours au cœur de la vision humaniste. Visages inscrits dans une temporalité figée ou suspendue. Visages anonymes, banalisés et interchangeables ou, au contraire, visages reconnus universellement (Kennedy, Marilyn) qui se transforment en signe, en marque déposée[6]. Visages qui semblent étrangement dépourvus de toute fonction, de toute transitivité ; ils ne renvoient plus à un faire, mais à un voir ou plutôt à un paraître. Les visages de Warhol sont comme des signes vides en pilotage automatique qui dégagent une aura proche du clignotant lumineux d’une enseigne publicitaire. Série ou blocs de visages, qui par leur aspect cumulatif perdent toute notion de singularité. Candide ou faussement candide, Warhol déclare :
« Quelqu’un a dit que Brecht voulait que tout le monde ait les mêmes opinions. Je veux que tout le monde ait les mêmes opinions. Mais Brecht voulait y parvenir par le communisme, d’une certaine façon. La Russie le fait selon les ordres du gouvernement. Ici, c’est en train d’arriver tout seul, en dehors de tout gouvernement strict. Donc, si ça marche, sans qu’on ne fasse rien, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sans qu’on devienne communistes ? Tout le monde a la même allure et le même comportement, et de plus en plus[7] ».
Mais personne d’autre que Baudrillard ne décrit mieux cette forme de neutralité :
« La réalité ne peut plus que se répéter ou se détruire. Elle ne débouche sur rien qui la dépasse donc elle est obligée de se démultiplier, de se dupliquer, de se cloner elle-même, à l’image du corps ou des idées. À partir du moment où il n’y a plus un objectif, une finalité, une transcendance… les choses sont livrées à elles-mêmes, c’est-à-dire au destin de se reproduire indéfiniment… elles n’ont plus de fin, aux deux sens du terme, c’est-à-dire qu’elles n’ont plus aucune finalité mais dans le même temps elles se révèlent interminables, définitivement lancées sur une orbite vide », écrit-il[8].
Warhol, mais aussi d’autres artistes – Lichtenstein, Chuck Close – détruisent tranquillement la notion de l’identité singulière. C’est un lieu commun que de dire que la photographie reste indispensable à la fois pour le pop art et pour l’hyperréalisme. Il va de soi que la reproduction de la photo, sa prolifération, en fait un domaine au traitement sériel rêvé. Généralement, la photo semble remplacer le portrait classique, mais en le vidant de toute dimension expressive et psychologique, en faisant abstraction de l’émotion et de la sensibilité[9]. C’est avant tout l’école de Düsseldorf, avec comme chefs de file Bernd et Hilla Becher, qui est devenue l’emblème de cette option esthétique. Curieusement, avec eux ou avec leurs élèves, la présence humaine est rarement traitée. Sauf exception notable : Thomas Ruff. Chez ce dernier, l’anonymat du modèle, la position frontale, le fond monochrome et lisse, toutes ces caractéristiques formelles font penser immédiatement aux photos qu’on obtient à l’aide du photomaton. De fait, le cadrage qu’emploie Ruff est strictement identique à celui du photomaton. Vus souvent de face, ces portraits sont des bustes découpés arbitrairement, emprisonnés à l’intérieur de la photo, avec une tête d’une taille démesurée par rapport au reste du corps. L’artiste nous dit : je les photographie de la même façon que j’aurais fait avec des bustes en plâtre. Mais contrairement aux bustes, ces corps n’ont aucun volume, ils sont aplatis sur un fond monochrome qui rejette toute notion d’espace. Effigies bidimensionnelles qui semblent être posées délicatement sur leur support, une mince pellicule ajoutée après coup à la pellicule d’origine. De même que le spectateur ne peut inscrire ces personnages dans un espace fixe, il ne peut les inscrire socialement. Résolument dans la lignée de la production contemporaine, les personnages de Ruff ne révèlent rien sur leur milieu, de la même façon qu’ils semblent résister à toute investigation psychologique. Ces visages restent désespérément neutres, empreints d’une espèce de froideur réductrice qui gomme presque toute forme d’affectivité.
Anonymes, puisque les personnages de Ruff ne sont pratiquement jamais exposés séparément, ils composent une « chaîne » de photos, aux formats identiques, apparemment interchangeables. Dans la série de portraits, déclare Thomas Ruff, je ne m’attache pas à la singularité d’un individu ; chacun les représente tous. Interchangeables sont les visages de l’artiste allemand, car, par leur étrange proximité, ces visages « moyens » (pour un spectateur moyen ?) paraissent comme des identités désertées. Désertées également par le caractère presque totalement inexpressif du visage : tout se passe comme si l’expression était retenue dans l’anatomie. La juxtaposition des portraits à laquelle nous assistons fait penser plutôt aux clichés, souvent affichés sur les parois du photomaton, qu’on suppose oubliés par des gens de passage, forcément anonymes. Le rapport qui s’établit entre ces clichés, un rapport purement contingent, renvoie plus au catalogue qu’à la série à proprement parler. Le terme « Typologies » — titre d’une exposition américaine à laquelle a participé Ruff — résume bien son aspiration.
Si Ruff est devenu l’emblème de ce traitement sériel, d’autres artistes lui emboîtent le pas. De façon étonnante, toutefois, on y retrouve parfois l’écho lointain des séries du passé, avec la réintroduction d’une dimension temporelle. À une différence près. Avec Dürer ou Rembrandt, chaque œuvre tentait d’immobiliser le temps, donnant l’impression que ces créateurs tentaient, d’une manière héroïque et désespérée, de lutter contre son passage. Avec Opalka, par contre, les écarts extrêmes réduits entre les prises de la photographie, la mise en scène inchangeable, font que le temps semble glisser, avancer de façon imperceptible.
Ailleurs, utilisant la technique numérique, Michel Salsmann combine en une seule image des dizaines d’autoportraits photographiés de face, qui s’étalent sur une trentaine d’années. L’aspect « tremblant », les effets de transparence que laissent deviner les différentes « strates » de chacune de ces représentations, sont à l’opposé de l’image unique qui fragmente et « pétrifie » le temps. Le flou des « portraits » de Salsmann, leur apparence fluctuante, labile, est une façon de refuser la poursuite désespérée, sisyphéenne, de capter pour toujours un instant de la vie. La lucidité de ces images est de s’inscrire sans aucune illusion dans un cycle inévitable, celui d’un effacement dynamique. Ce cycle est magnifiquement décrit par Borges :
« Se pencher sur le fleuve, qui est de temps et d’eau
Et penser que le temps à son tour est un fleuve
Puisque nous nous perdons comme se perd le fleuve
Et passe un visage autant que passe l’eau[10] ».

Nous pouvons rapidement mentionner les visages sériels obtenus par les nouveaux médias électroniques. Sans doute, les changements techniques, « le passage de la photographie à l’image » (Quentin Bajac) apportent avec eux des changements de la définition identitaire : des visages métastables, transsexués, incertains, des métamorphoses informatiques. Quand la science attaque de toutes parts l’illusion du moi stable, apparaissent, pour en témoigner visuellement, le sampling et le morphing, ces séries interminables. Ce ne sont pas de véritables traces identitaires, mais des entre-deux indéfinis[11]. Les artistes, écrit Dominique Baqué, imaginent « la collusion progressive de deux visages différents… jusqu’à ce point de vacillement, de tremblement où les deux fusionnent en un être unique et improbable, où l’un est l’autre[12] ». En contrepoint finalement avec les visages d’un Djamel Tatah. Curieusement, ces visages multiples et indifférenciés dégagent non pas le sentiment d’une foule anonyme, mais d’une véritable communauté qui partage quelque chose en commun. Ces visages, qui font face, nous touchent profondément, car il semble que Tatah se pose encore cette question essentielle : comment rendre visible le concept d’humanité ?
[1] D. Bougnoux, « Interventions sur le visage », Les Cahiers de la médiologie 14, Paris, Gallimard, 2002, p. 5.
[2] Sigmund Freud, « Actions compulsionnelles et exercices religieux » (1907), in Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973.
[3] Alexej von Jawlensky, « Lettres au moine Willibrord Verkade », Wiesbaden, le 12 juin 1938, in Itzhak Goldberg, Jawlensky ou le visage promis, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 234.
[4] Ibid.
[5] Roy Lichtenstein, Portrait de femme, 1979.
[6] « La beauté archétypique de la star retrouve le hiératisme sacré du masque : mais ce masque est devenu parfaitement adhérent, il s’est identifié au visage, confondu avec lui ». Edgar Morin, Les stars, Paris, Seuil, 1962.
[7] Voir à ce sujet « Le communisme esthétique d’Andy Warhol » dans le catalogue Le grand monde d’Andy Warhol (Réunion des musées nationaux). Et https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-oeuvres/le-communisme-et-la-philosophie-d-andy-warhol-7914504
[8] Jean Baudrillard, Télérama, n° 2923, 18 janvier 2006, p 10.
[9] « Le statut du portrait (et du visage) passe aujourd’hui par la photographie », Denis Hollier, « Qui commande », Artstudio, n° 21, 1992, p. 38.
[10] Jorge Luis Borges, L’Auteur et autres textes : El hacedor », Gallimard, 1965, Traduit de l’espagnol par Roger Caillois.
[11] « Le corps n’est plus cette substance symbolique, il est l’instrument banal de nos transhumances quotidiennes, quand il n’est pas cloué face à l’écran… À ce moment elles (les images) n’ont plus de fin, aux deux sens du terme, c’est-à-dire qu’elles n’ont plus aucune finalité mais dans le même temps elles se révèlent interminables, définitivement lancées sur une orbite vide… Avec le fantasmatique, il y avait encore du conflit… Avec le fantomatique, nous avons perdu notre ombre, nous sommes devenus transparents, nous évoluons dans un monde d’ectoplasmes » Jean Baudrillard, Télérama, op. cit.
[12] Dominique Baqué, Visages, du masque grec à la greffe du visage, Paris, Regard, 2007, p. 196.