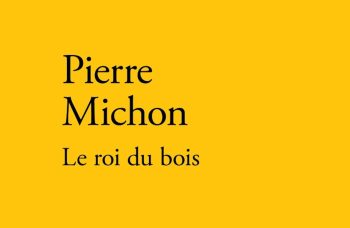Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui publions une contribution de Rudy Rigoudy.
Pour une claire voyance
À partir d’une production artistique personnelle au long cours, je vais essayer de montrer qu’un réseau de paysages photo-graphiques, mis en scène sur Instagram, peut être considéré comme une forme d’autoportrait. Pour atteindre cet objectif, nous interrogerons tout d’abord la voyance – au sens de Maurice Merleau-Ponty, qui la définit comme : « une faculté de l’image à rendre présent ce qui est absent par des indices corporels qui disent plus qu’ils ne signifient ». Cela nous conduira à comprendre pourquoi mes paysages photo-graphiques sont des images autobiographiques et auto figuratives . Dans un deuxième temps, nous verrons comment j’essaye de m’approprier Instagram – notamment la grille structurant le mur de mon compte. Je crée une œuvre qui met en scène mes images et interroge la relation dynamique qu’elles entretiennent entre elles et avec un espace multidimensionnel.

Mais avant de démarrer, arrêtons-nous quelques instants sur l’idée qu’une possible approche du Visage[s] ou du portrait pourrait être basée sur les Transferts comme double et mise à distance . La notion de transfert induit un déplacement, une projection, le passage d’un support à un autre, d’une position à une autre ou d’un état à un autre. Le pluriel indique qu’il existe une diversité de modes de transmission sans pour autant situer leur niveau de complexité. Les éléments – double et mise à distance – contextualisent l’approche des modes de transferts. Un double peut être une copie, la répétition d’un original ou une quantité multipliée par deux. Mettre à distance c’est prendre du recul, s’éloigner physiquement ou mentalement d’une situation ou de personnes. Mais dans le cadre d’une réflexion sur les formes du portrait, l’intitulé Transferts : double et mise à distance induit des questions liées à l’identité. En effet, il est admis qu’un individu projette des intentions sur autrui ou se projette dans l’autre, ou à la place de l’autre, pour définir ou redéfinir son point de vue et son identité. Un double peut être quelqu’un qui me ressemble. Cela peut être un alter ego, tout comme je peux être moi-même habité de dualité. Nous le voyons, c’est en fonction d’une perception particulière, d’un point de vue conscient ou inconscient, que nous appréhendons – avec plus ou moins de distance, avec plus ou moins de clarté – notre rapport à nous-même et aux autres. Dans ce contexte, les images sont précieuses pour donner du sens à l’identité et à la posture d’un individu dans son rapport au monde. Maurice Merleau-Ponty explique qu’une image « n’excite pas toujours notre pensée à retrouver la forme vraie des choses, mais qu’au contraire elle renvoie à notre point de vue ». Serait-ce donc à dire qu’une image posséderait un pouvoir réfléchissant ? Si tel est le cas, nous pourrions admettre qu’en me projetant vers ce qui est figuré à sa surface par le regard, je vois ce qu’elle montre et que dans le même temps je prends conscience que je suis en train de regarder. Mais, c’est évident, je ne me vois pas littéralement dans l’image pour autant. Ce n’est pas un miroir optique. C’est plutôt un miroir symbolique et, en me projetant dedans, ou à travers elle, je transfère mon attention à l’extérieur de moi-même. Elle reçoit la charge de ma présence et de ma rencontre avec elle. De son côté, elle m’envoie ce qu’elle contient de visible tout en me renvoyant à l’acte que je suis en train de faire. Par son intermédiaire, je reconnecte mon corps et mon esprit à la dynamique de ce qui m’entoure dans l’instant de l’expérience . La double dimension de mon identité – le Moi et le Je – s’active et redevient consciente. Le regard et la vision me permettent ainsi de me laisser transporter sensiblement dans le visible figuré dans l’image et de prendre la mesure de la voluminosité qui me sépare non seulement de la figuration, mais également de la matérialité de l’image elle-même. Un échange est généré dans une relation circulaire – en @LLER-RETOUR.
Ces premiers éléments de réflexion nous permettent d’amorcer l’idée qu’il se passe quelque chose d’ordre phénoménologique lorsque je regarde le monde à travers une image et, par extension, à travers une interface de vision. L’œil, le visage ou un appareil photo sont autant de points de contact entre moi-même, les autres et le monde. En effet, l’inclusion d’images dans un espace de la web intimité s’articule particulièrement aux questions liant transfert et identité. Un compte sur les réseaux sociaux est un espace de projection de soi – apparenté au miroir – que l’on alimente et que l’on entretient pour se voir exister soi-même et aux yeux des autres. Reste à savoir quelle image chacun construit et donne de lui-même à travers les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, c’est à travers la mise en scène de paysages photo-graphiques que je me raconte sur Instagram.
Paysage auto figuratif ou anti selfie
Pour comprendre en quoi un paysage photo-graphique représente à mes yeux un autoportrait, commençons par lire cette citation de Robert Frank :
« Pourquoi fais-tu toutes ces images ?
– Parce que je suis vivant ».
Pour Robert Delpire – précieux montreur d’images, malheureusement décédé au moment où j’écrivais ces lignes -, toutes les images de Robert Frank sont des autoportraits. Il explique que dans le regard de Robert Frank, la photographie n’est plus une vitre entre le réel et nous, mais un miroir. Derrière ce miroir il y a Robert Frank qui se confronte au réel et qui exprime, dans ces instantanés, un sentiment tout simple, celui d’être au monde. En affirmant « je suis vivant » lorsqu’on lui demande pourquoi il fait toutes ces images, il montre que ses images sont révélatrices d’une présence, d’un être-là, et rien d’autre. Bien que chacune d’elles représente quelque chose de particulier qu’il a vu, elles sont finalement pour lui toujours la même : la trace d’un « regard à l’extérieur de l’intérieur et, inversement, de l’extérieur à l’intérieur ». Cela correspond à l’idée de Merleau-Ponty selon laquelle : « l’artiste doit être transpercé par l’univers et non vouloir le transpercer ». Dans une relation d’échange et d’imprégnation, « son œil voit le monde, et ce qui manque au monde pour être photographie, et ce qui manque à la photographie pour être elle-même ». Elle restitue sa disponibilité à ce qui lui fait face et qui l’englobe tout en le renvoyant à lui-même et à sa relation avec l’appareil qui l’a fait naître. Comme l’explique Vilém Flusser, l’image rend visible le programme du geste photographique qui a lieu dans l’espace-temps de l’acte de regarder . Au cœur d’un jeu, relevant d’une esthétique de la spontanéité , le photographe et son appareil se confondent et respirent ensemble au rythme du monde.

Pour visualiser ce processus, l’image – Je ne vois que ce que je regarde – illustre le mode opératoire de mes prises de vue. Bien qu’elle se passe dans le mouvement, j’ai essayé de fixer et transposer sous forme schématique l’expérience de l’acte photographique. Vu de dessus, je suis le cercle noir au centre du carré : l’opérateur. Le cône en pointillé qui s’étend jusqu’au contour du cercle représente mon champ de vision. L’arc de cercle qui clôt cet angle de vue correspond à la limite maximum de ma perception de l’espace, à l’horizon. Ce dernier est une frontière mouvante. Entre terre et ciel, il matérialise une limite qui est définie par la position spatiale de mon point de vue et par les variations atmosphériques auquel il est soumis. Le cercle bleu, comportant plusieurs nuances, correspond à l’environnement dans lequel j’évolue et qui m’englobe. Le dégradé matérialise la diminution de mon champ de vision – qui est déterminée par mon point de vue. À l’extérieur de ce cercle c’est l’espace indéfini du monde.
La ligne noire juste au-dessus de l’opérateur représente l’écran de mon smartphone, mon appareil photo. C’est à travers lui que je perçois ce que je vise et vois. Il est une interface de vision avec laquelle je cadre le paysage face à moi. Je me projette corporellement à travers lui vers l’horizon. Situé entre le corps et le monde, l’appareil – que Vilém Flusser appelle black box – est « un espace interstitiel » qui permet qu’ils ne soient pas isolés l’un de l’autre, mais qui, au contraire, les connecte, intensifie et programme leur relation. Adapté à la mobilité, c’est une prothèse prolongeant le corps, toujours prête à capter, transformer et diffuser « une vision mise en forme par et dans le mouvement ». Le deuxième cercle noir correspond à la figure que je choisis comme sujet, comme centre d’attention. Son positionnement est à distance de moi. Isolé dans le cadre, il crée de la profondeur dans la surface de l’image.
Jusqu’ici il a été question des flèches bleues qui partent de mon corps vers le visible dans le schéma. À l’inverse, les flèches bleues, partant de l’horizon et du sujet dans ma direction, vont dans le sens de ce qu’explique Merleau-Ponty : le sujet « dévoile les moyens, rien que visibles, par lesquels il existe sous nos yeux ». Elles indiquent que le monde se rend lui-même visible et convergent vers mon regard à travers l’écran du smartphone. Le cadre de l’image et les lignes horizontales bleues, à l’intérieur de mon champ de vision dans le schéma, sont finalement des moyens de mesurer la spatialité de ma relation de voyant avec le visible. Le carré – format qui constitue chez moi une forme d’obsession – est à considérer, à l’instar du pixel ou du carreau dans la maison de Jean-Pierre Raynaud , comme une unité. Il est l’unité de ce que mesure mon regard. Il me permet de fragmenter le monde afin que je puisse me l’approprier en ancrant mon passage par et dans l’image. Les lignes à l’intérieur de mon champ de vision permettent, quant à elles, de mesurer l’espace représenté dans la surface de l’image. Elles marquent les distances – en @LLER-RETOUR – entre l’horizon, le sujet et mon regard.
Une grille formée de repères jaunes et bleus apparaît également dans l’ensemble du format carré. Les jaunes correspondent à la grille présente sur l’écran de mon smartphone lorsque je regarde et cadre à travers lui. À la prise de vue, je m’appuie sur elle pour composer avec les lignes de force et les masses visuelles que j’observe pour construire l’espace du paysage. Par exemple, je place l’horizon, ou la ligne horizontale constituant la surface d’un lac, sur le tiers inférieur ou au centre du format carré. Les repères bleus correspondent à un découpage du format par le nombre d’or. Ils me servent pour transformer l’image – pour repositionner un motif par exemple -, ou pour ajouter, en postproduction, des éléments graphiques ou textuels. En intégrant la grille à un appareil de vision – comme dans l’écran des perspectographes d’Albrecht Dürer et de Léonard de Vinci -, mon regard se projette à travers un filtre de perception vers une réalité mise à distance, fictionnalisée en quelque sorte.
Ce schéma ne révèle que le mécanisme de l’acte photographique. Dans le flux de l’action, la perception visuelle stimulée par le paysage est spontanée. Elle répond à une attirance subjective créée par et pour le visible. La photographie est le réceptacle de cette expérience esthétique de l’évanescence. Une vision fragmentaire de ce que j’ai regardé et vu se laisse entrevoir : la représentation d’un paysage localisé mais déterritorialisé. À l’instar d’un haïku ou d’une estampe japonaise de l’ukiyo-e , elle encode un phénomène éphémère dans l’instantanéité de la vision. Elle donne à voir ce que les Japonais appellent l’image du monde flottant.
L’image, finalement, est un signe : celui d’un état de choses où mon corps, appareillé et immergé dans un phénomène atmosphérique, enregistre une trace de mon point de vue. À l’instar de l’œil, elle connecte l’intérieur et l’extérieur de mon corps. Ce qui est dedans et ce qui est dehors coexistent et transforment l’expérience sensible du monde en une expérience perceptive de soi , en une image auto figurative . En quelque sorte, je fixe des points de passage par et dans mes images. Ce sont des balises sur la carte de mes expériences du monde. Elles tiennent le rôle de stimuli mémoriels et me renvoient, a posteriori, à un instant, un espace et un contexte. En plus d’incarner un point de vue, elles sont à la fois des gestes , des vecteurs narratifs et, comme le souligne Serge Tisseron, « peuvent constituer un moyen d’être dans le monde en acte ou en image ». Conscient « d’être-là » dans l’acte photographique, je cherche à m’assurer de ma présence dans le monde . Mettre un écran entre le visible et moi entraîne une acuité de mon regard et multiplie la « regardabilité » de ma relation corporelle à l’espace visible.
L’interface, constituée de l’image-écran, interroge le rapport intime du corps à l’espace, même s’il est absent de la photographie. Comme l’explique Jean Baudrillard, « l’expérience du monde qui surgit de la réalité devient ainsi un objet » visible. Et même si « une image ne peut pas remplacer une expérience », on peut tout de même penser que « l’ouverture au paysage est simultanément l’ouverture à l’énigme que je suis pour moi-même ». Mes paysages photo-graphiques sont les reflets d’une auto présence (in)visible. À l’inverse d’un selfie, qui témoigne d’une ultra visagéification dans les usages actuels du numérique, je n’ai pas besoin de me voir – ou de me montrer – dans l’image pour activer la mémoire de ma présence dans un lieu. C’est même plutôt l’inverse. Mon visage est absent de l’image car il est absorbé par l’en face de mon regard, par le paysage. Alors que les selfies ne prennent sens que par la présence de l’autoportrait intercalé entre l’objectif et le sujet en arrière-plan, je prends le contre-pied de cette codification. Ce n’est pas moi que je montre, mais ce que je regarde. Et, pour renforcer la dé-représentation de mon visage, je vide au maximum l’espace figuratif par la mise à distance de l’espace figuré. Il ne reste qu’un non-lieu atmosphérique hors du temps, un silence visuel où un regard(eur) solitaire a retenu sa respiration l’espace d’un acte photographique.
Flux Instagram
Après cette explication de ce qui constitue la première phase de mon processus créatif, voyons maintenant comment je mets en scène ces paysages photo-graphiques sur Instagram pour interroger la multi dimensionnalité des espaces de l’image.
En investissant cet espace de la web-intimité , mon intention est double : 1. me raconter en images, en m’inspirant librement des formes artistiques du récit de soi ; 2. m’approprier et révéler les caractéristiques structurelles d’un mur Instagram, à partir d’une déclinaison de contraintes plastiques et conceptuelles – impliquant des multiples de trois .
Pour ce faire, j’envisage mon mur, à l’instar du carton perforé d’un orgue de barbarie, comme la partition – ponctuée de notes visuelles – d’une ballade autobiographique. Voilà plusieurs années que j’alimente un compte Instagram de paysages photo-graphiques et que je les fais rebondir sur les réseaux. Avant de paramétrer mon profil utilisateur et de publier ces images, j’ai porté mon attention sur le contenu de ce réseau social, sur son fonctionnement et ses codes. J’ai d’abord flâné entre les images publiées par d’autres utilisateurs, liké certaines publications, exploré et analysé bon nombre de comptes. J’ai rapidement observé qu’à l’instar du manuscrit original du roman Sur la route (1957) de Jack Kerouac – écrit d’une traite à la machine à écrire sur un rouleau de 36 mètres de long – la page d’accueil d’un compte se déroule à la verticale. À la différence du manuscrit de Jack Kerouac qui reste unidirectionnel – comme pour évoquer un @LLER SANS RETOUR vers un territoire d’expériences toujours à l’horizon – il est possible de faire des @LLERS-RETOURS sur un mur Instagram et de flâner dans ce qu’il raconte. Sur un mur Instagram, les images miniatures – de format carré – s’empilent, au fur et à mesure des publications de l’utilisateur, par lignes sur trois colonnes. De fines marges blanches les séparent et matérialisent une grille. À l’intérieur du cadre de l’écran du smartphone – interface de prédilection pour la consultation et l’utilisation d’Instagram – cette grille projette l’espace sur lui-même . Chez certains utilisateurs, cet espace est un espace narratif signifiant, révélateur de la recherche d’une mise en cohérence de l’ensemble de leurs publications. En parcourant – en @LLER-RETOUR – les images présentées, une identité visuelle émerge par défilement.
Au-delà du storytelling autofictionnel constitué d’images-instants , ce sont des triptyques ou des #instagrid – des images divisées en trois, six ou neuf fragments – qui ont retenu mon attention. Ces images fragmentées en unités carrées sont construites par multiple de trois. Elles habillent et habitent la grille. Ce qu’elles représentent intègre et révèle à la fois le support sur lequel elles prennent corps. Ce sont les briques d’un mur qui peut être envisagé comme la trame d’une narration fragmentée. Tels les documents présentés dans les vitrines de La vie impossible (2001) de Christian Boltanski , les fragments autobiographiques qu’elles représentent s’appréhendent d’abord par l’ensemble qu’ils constituent. Ce n’est qu’en cliquant sur une image que l’on accède aux traces sensibles – localisation, titre, descriptif, hashtag, liens, likes, commentaires – et à la mémoire qui leur est associée. Les éléments de ces récits autofictionnels défilent sur deux niveaux – de haut en bas et d’avant en arrière – à la vitesse des mouvements impulsés par le doigt qui les explore à travers le cadre de l’écran.
Comme nous l’avons vu, j’ai intégré l’utilisation de la grille à la prise de vue de mes photographies et aux processus de post-production graphique. C’est donc cet élément, dès le début de ma présence sur Instagram, que j’ai décidé de m’approprier pour mettre en scène la publication de mes images. L’idée est d’installer un prolongement de mes réflexions sur la relation corps/interface/espace à partir de plusieurs séries qui s’imbriquent et se répondent par module et par séquence. Ce sont les notions d’empilement, d’alternance, d’alignement, de liaison, de fragmentation et de superposition, qui, pour l’instant, m’ont permis de les mettre en œuvre sur cet espace de monstration. Une logique multidimensionnelle – liée à la grille – a émergé après une période de tâtonnements. J’ai adapté la forme des séries et leur séquençage aux caractéristiques du support sur lequel elles sont publiées. Les liaisons – basées sur les multiples de trois et sur l’utilisation du blanc comme vide narratif – fluidifient la relation entre l’œil qui regarde mon mur et la main qui le fait défiler sur l’écran. Le défilement – en @LLER-RETOUR – du mur n’empêche pas de percevoir la volonté de mise en cohérence de cet ensemble qui devient, à mes yeux, un paysage interactif.
Libre à chaque utilisateur de cliquer sur une image en particulier pour accéder à des informations complémentaires (localisation, date, contexte, hashtag, etc.). S’il le fait, c’est comme s’il ouvrait les boîtes métalliques des Archives (1965-88) de Christian Boltanski . Des données contextuelles et mémorielles complètent sa perception du paysage photo-graphique en lui révélant un peu de ce que le champ de l’image ne montre pas.
Conceptuellement, un récit autofictionnel défile ainsi sur deux niveaux – de haut en bas et d’avant en arrière. Mais dans l’ensemble, c’est bien le mur Instagram qui, pour moi, fait œuvre. Son élaboration est un processus en mouvement dont la logique est de lier, dans une pratique mêlant recherche et création, des éléments autobiographiques, phénoménologiques, visuels et conceptuels sur Instagram. D’autant que le clic photographique et le clic écranique établissent tous deux un rapport corporel au paysage – l’un et l’autre permettant de se projeter vers un espace par une surface.
L’œil qui regarde
Dans le cadre de notre réflexion sur le(s) Visage[s], il semble finalement que le qualificatif d’anti selfie soit adapté aux images que je produis et que je mets en scène sur Instagram. À l’instar de Pablo Picasso qui explique : « Je peins comme d’autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont les pages de mon journal », elles transportent chacune un fragment de mon histoire – l’ensemble fabriquant un récit autobiographique fragmenté. Elles sont à la fois l’incarnation de mon point de vue sur un paysage qui absorbe mon regard et, peut-être seulement pour moi, un miroir dans lequel je reprends conscience de ma présence dans le monde .
À ce titre, comme le montre Henri-Georges Clouzot dans Le Mystère Picasso (1955) , chaque œuvre renvoie l’image de l’artiste luttant avec lui-même et avec le monde à travers la toile. Mes images, elles aussi, sont un @LLER-RETOUR à travers mon œil qui regarde.
Prendre le contrepied de l’ultra visagéification et de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux n’est pas anodin. C’est une forme de résistance à des codes sociaux orchestrés par les multinationales du web. Mais c’est surtout un moyen d’interroger les rapports entre les moyens techniques de l’appareillage du regard et de l’enregistrement de la mobilité dans la société nomade actuelle . Si même une voiture peut être une interface de vision et d’interaction, n’est-ce pas finalement la fluidité qui donne aujourd’hui une aura à l’image de soi dans son rapport aux autres et au monde ?