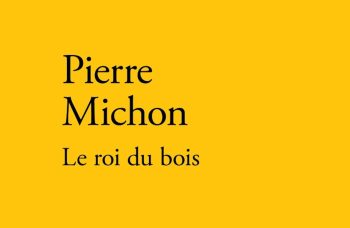Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui publions une contribution de Jean-Jacques Gay.
Visage(s) spectateur
Que regardent-ils ces visages masqués ? Ces « hommes sans visage(s) » acquis à la réalité virtuelle. Imaginez ces foules aveugles dans ces boxes impersonnels et vides, spectateurs vissés sur des tabourets rotatifs ou déambulant à jamais dans des halls déserts, sans but (visible),sans se toucher, sans communication. Ballet de fantômes, de morts-vivants, de zombies sans visages qui hantent les mondes parallèles : le factuel et le virtuel à la fois, perdus dans l’infra-mince[1] d’un art émergent.
Le spectateur de réalité virtuelle (VR ou Virtual Reality) est sans visage(s). Affublé de multiples profils, équipé d’un masque de vision et d’écouteurs, géolocalisé ou pas, il est au centre de l’action tout en en étant exclu. Il est seul, sans identité, sans émotions d’ailleurs, si le visage en est encore le reflet !
S’immerger dans la VR, « c’est un peu comme être à une fête sans y être invité ! », résumait le réalisateur de cinéma Jan Kounen[2]. Confronté aux nouvelles problématiques d’une production VR, il ajoutait : « c’est même être sous un régime fantomatique ! ».
Cette fascination pour la VR a aussi ses détracteurs. « Quel spectateur voudrait se coiffer d’une boîte à chaussures pour regarder un film ! », ironisait en 2018, Philippe Haïm, le directeur de la création du jeune studio Blackpills (plateforme de diffusion mobile de Xavier Niel) lors du colloque sur la création VR organisé par le cluster Pôle Media Grand Paris. Pourtant les industries de l’innovation, GAFAN[3]en tête, se précipitent sur le phénomène VR (pour ses ressorts techniques, créatifs et innovants). Et à voir ces foules aveugles, ces troupeaux sans émotion(s), qui s’y précipitent, il est temps d’interroger le double visage des nouveaux spectateurs de cette réalité virtuelleen passe de devenir, si ce n’est une industrie, tout du moins un divertissement, de masse sans écran fédérateur.
Depuis les frères Lumière, les spectateurs se rassemblent face à un écran de projection. Le cinématographe fédérait ainsi les foules, la télévision concentrait la famille, la tablette unissait le couple, le smartphone chacun pour soi dans les réseaux sociaux. Habitants de la réalité comme du virtuel, à la fois subjectifs et collaboratifs, passifs et passibles, les spectateurs VR sont inexorablement seuls : égoïstes, isolés, égocentrés ?
Pour appréhender la VR (ce nouveau méta-cinéma technologique, cette nouvelle machine à sensations multiples), nous convoquons ici, par le titre de ce texte, un film fantastique, celui du cinéaste français Georges Franju, Les Yeux [sans visage (1960). Car c’est à cette œuvre incunable que nous songeons en explorant les créations VR et surtout en observant l’attitude de leurs usagés, spectateurs augmentés[4] de cette proto-immersion.
Appréhender la VR en parlant du cinéma, c’est aussi écouter le cinéaste Jean-Luc Godard. Provocateur, il qualifiait le cinéma d’art moyen, qui ne « nous montre [que] l’infiniment moyen des choses ! » car, continuait-il, « pour pénétrer l’infiniment petit, il faut un microscope, et les étoiles ne peuvent être vraiment appréciées qu’avec un télescope…[5] ». Or, pénétrer l’infiniment grand comme l’infiniment petit est certainement le véritable objet des technologies de la réalité virtuelle qui, dès les années 1985, ont été créées pour nous projeter physiquement dans des surmondes extra-humains grâce à une télé-présence technologique.
Visage(s) théâtral
Mais d’où vient cette réalité dite virtuelle, méta-cinéma à la fois télescope et microscope ? « Être dans la VR c’est être dans l’œil du cyclone ! » (Lefdup) entend-on souvent ! Pourtant le spectateur de la VR grand public (sans autre interactivité que celle de regarder à droite et à gauche) est plus souvent expulsé de l’action en tant qu’inter-acteur. Pour faire (encore) une analogie au héâtre, nous pourrions dire qu’il est sur scène, comme, dès 2014, la chorégraphie à 360° que nous offre Blanca Li[6]. Il est au milieu de l’action, mais se retrouve effectivement au poulailler ! Acteur de ce « petit théâtre technologique » (Gay) et spectateur panoramique, il est enfin au milieu de la scène(comme au XVIIe siècle où le monarque avait sa place sur la scène du théâtre). Mais il y erre sans but, à la recherche de son double… exclu de la pantomime. Car, dans la VR tout nous ramène au théâtre : le panoramique, l’interaction visuelle directe, la liberté de se déplacer (sur certaines applications). Nous assistons alors à un petit théâtre dont nous, spectateurs, sommes le point d’attraction négligeable. Spectateur qui doit bouger pour exister. Comme l’indique Jean-Claude Yon, « il ne faut pas oublier qu’avant le XIXe siècle le spectateur était debout, turbulent, rentrait et sortait de la salle, à loisir. Et il a fallu l’assagir, l’assoir, lui donner un point de vue et le plonger dans l’obscurité[7] ».
Or la VR, avec ses devices, promet une libération de la posture assise tout en la préconisant. La VR prétend libérer le téléspectateur. Or, le voici harnaché, bridé, équipé, augmenté… pour quel plaisir de plus ?
Une autre chose nous ramène au théâtre, c’est l’expression même de réalité virtuelle. Elle remonte à 1938, lorsque Antonin Artaud utilise le syntagme « réalité virtuelle » pour décrire « la nature illusoire des personnages et des objets » dans le théâtre, dans les pages de son texte Le Théâtre et son double[8]. Artaud l’angoissé, Artaud l’acteur, Artaud le poète, Artaud le médium se retrouve dans cette expression, dans la réalité virtuelle de ses rôles, dans cette expression qu’il magnifie à travers son Théâtre de la Cruauté. On ne peut oublier ce dramaturge qui faisait remonter les tourments de son âme, de sa comédie, jusque sur son visage, dans les films de Carl Theodor Dreyer, Georg Wilhelm Pabst, Marcel L’Herbier, Jean Dréville ou Abel Gance… Acteur-médium à la recherche de son double, dans la cruauté de son théâtre : réalité virtuelle de ses voyages, dans le visage d’un autre.
Visage(s) technique
On évoque aussi le contexte théâtral, en 1950, lorsque l’ingénieur Morton Heilig (1926-1997) de l’université de Chicago met au point une « expérience de théâtre » qui permet d’englober tous les sens du spectateur d’une manière efficace, et qui ressemble étrangement aux appareils d’aujourd’hui. Douze ans plus tard, le même Heilig construira un autre prototype VR sous le nom de Sensorama (1962). Heilig tourne alors cinq courts métrages qu’il compte présenter à l’utilisateur de son Sensorama, de manière à engager plusieurs de ses sens-spectateurs par la vue, l’ouïe, l’odorat, le son ou le toucher. Un second prototype qui ressemble étrangement aux bornes d’ARCADE des jeux vidéo à venir 20 ans plus tard, le Sensorama 2 permettra aux spectateurs de vivre des expériences d’immersion visuelle et auditive face à une scène réelle filmée au préalable, en vue subjective, avec deux caméras de cinéma.

Mais il faudra attendre les années soixante-dix et l’arrivée de l’image synthétique pour que le professeur Thomas A. Furness (Université de Seattle, Washington) introduise la technologie de la réalité virtuelle en temps réel au sein de l’armée américaine, qui sera désormais dotée de simulateurs de combat de chars Bradley, puis de simulateurs de vol, pour ses pilotes. Ce n’est pas un hasard, si un des premiers jeux vidéo sera un simulateur de blindés fonctionnant en temps réel (Battlezone, 1980). C’est ainsi que l’image de synthèse (la 3D) en temps réel devient la matière de ce second monde virtuel et accélèrera l’immersion interactive des sens de ses acteurs humains dans le nouveau théâtre de la cruauté qu’est le jeu vidéo des simulateurs de combat.
Dans les années quatre-vingt, le développement exponentiel des technologies électro-digitales va amener le jeune ingénieur du MIT, Jaron Lanier (né en 1960) à populariser cette immersion des sens dans la virtualité d’autres mondes. En 1985, il fonde la société VPL Research, à l’origine d’appareils qui concrétisent la réalité virtuelle telle qu’on la pratique aujourd’hui. Travaillant pour l’industrie aéronautique et notamment la NASA, Lanier conçoit le Data Glove, l’Eye Phone, et l’Audio Sphere et des concepts comme le retour de force. VPL Research projette ainsi l’homme dans l’infiniment grand de l’espace (télétravail en temps réel des astronautes de Houston avec les robots embarqués sur les navettes spatiales US) et l’infiniment petit (exploration et action à l’intérieur du corps humain et des nanobiotechnologies médicales de pointe).
Visage(s) artistique
Ainsi, ce monde du virtuel, sans cesse écrit, décrit et manipulé par les artistes dès la fameuse cosa mentale[9] de da Vinci et des artistes-ingénieurs de la Renaissance, rejoindra celui imaginé par les artistes contemporains de la fin du vingtième siècle. En particulier ceux, hybrides, des nouveaux médias électro-digitaux, faisant usage de technologies de pointe, parfois industrielles, et permettant l’interfaçage d’une action physique, concrète, avec des mondes « rêvés », simulés en temps réel. Masqué, casqué, immergé dans des méta-productions, augmenté, trente ans après Lanier, le spectateur-consommateur n’a jamais été plus au centre de l’action de « possibles rêvés ».
Car, si cet oxymore[10] barbare de « réalité virtuelle » est aujourd’hui en vogue, c’est aussi l’affaire des artistes. Le terme réalité virtuelle est à définir, car l’opposé de virtuel n’est pas réel, qui lui s’oppose à irréel. Le virtuel trouve son opposé dans le factuel. La réalité virtuelle est selon Maurice Benayoun « le réel avant que le réel ne passe à l’acte[11] » (sous-entendu : avant qu’il ne s’actualise). Sur les traces de Deleuze qui considère que le réel est une multiplicité en devenir, Benayoun introduit ainsi l’idée d’un en deçà de la représentation qui précéderait son actualisation. Lanier parle de « quasi-réalité », donc de presque réel, et renvoie à la définition de Jaron Lanier « une technologie informatique (ou électromécanique) qui simule la présence physique d’un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels ». Environnement avec lequel l’utilisateur peut interagir de façon ludique. N’oublions pas que Lanier a commencé à développer la VR en 1982 dans les laboratoires de la firme de jeux Atari. L’industrie du jeu veillait, mais n’y crut pas assez. Depuis, elle est devenue très sensible à la VR et prête à projeter ses gamers dans les mondes techniques, scientifiques et économiques virtuels.
Malgré sa technicité, la réalité virtuelle est d’abord un petit théâtre, un jeu dans le face-à-face du regardeur et de son double. La notion de réalité virtuelle a toujours été implicitement esquissée par les philosophes. Platon dans son « allégorie de la caverne[12] », puis Descartes, qui pour sa part envisage l’hypothèse, dans son Discours de la méthode[13], que les témoignages de ses sens puissent n’être« qu’une série d’illusions coordonnées par un esprit malin…[14] » Esprit malin !? Le programmeur, le créateur (comme l’appelle Alan Turing) de la VR, espace où l’homme lui-même, démiurge, se créerait son monde quasi réel et y vivrait en dehors de sa condition humaine tel un esprit malin.
C’est cette technologie VR qu’utilise l’artiste post-conceptuel américain Matt Mullican pour réaliser Five Into One, en 1991, à Paris. Avec cette œuvre VR, Mullican plonge enfin son spectateur dans sa tête, dans son monde enfin factuel, visible et visitable en temps réel par les polygones de l’image de synthèse.
Depuis les années 60, Mullican travaille sur ses méta-mondes intérieurs qu’il extériorise sous psychotropes ou hypnose au cours de performances publiques proches du Living Theatre[15]. De ses expériences sur le symbolisme des représentations et des codes cognitifs, cet acteur majeur du post-conceptualisme tire une cosmogonie formelle en toiles immenses (bannières) proches de la cartographie mentale illustrée de pictogrammes, de circuits, dirigées par une charte graphique et colorée. Signalétique minimale et primaire que Mullican modélise en image de synthèse pour Five Into One, afin que son spectateur visite son univers, en passant de l’infiniment grand à l’infiniment petit, à travers la mémoire fantasque de son créateur. Un monde où le VERT représente les choses essentielles, le ROUGE les valeurs spirituelles, le JAUNE les manifestations conscientes, le BLEU les actes inconscients et le NOIR la communication et le langage. Cette œuvre de projection mentale permet, selon les termes de Mullican, de « valider l’image » (« validate the image »).
Visage(s) intérieur
Le dessin de Mullican « n’est plus seulement une représentation dans un espace conventionnel », écrit Pascal Rousseau, « mais la mise en présence d’une figure (de soi) dans un lieu réel (a real place)[16] ». Une œuvre commencée par des voyages dans les toiles des autres. Par exemple, installé sous hypnose à côté d’un dessin de Piranèse (Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778), la voix du médium Mullican nous fait voyager dans l’architecture du graveur italien comme s’il la parcourait en étant partie prenante des espaces dessinés, nous proposant une promenade digne des expériences critiques de Denis Diderot[17]. L’absorption[18] du spectateur dans l’œuvre est ici faite par la virtualité de la voix de l’artiste et la VR de Five Into One lui permettra alors d’en donner une réalité.
Si en 1991 Mullican s’est brièvement tourné vers la VR pour nous faire rentrer dans son méta-monde à travers cette œuvre unique et perdue, comme beaucoup de pièces technologiques, il va revenir à ses premières installations graphiques et comme beaucoup d’artistes s’attacher à garder intacts les visages de ses spectateurs comme partie intégrante de l’expérience artistique. Il ne sera plus possible de sacrifier l’émotion (Moben). Le spectateur doit regarder l’œuvre en face pour la partager. Et ces plasticiens ne cesseront de réhabiliter l’écran sous différentes formes et technologies mobiles (Cave, Web, interaction cognitive haptique, son spatialisé, 3D, télescope, dôme, Réalité Augmentée, etc.). Ainsi Jeffrey Shaw avec son Dôme, Maurice Benayoun avec le CAVE, Luc Courchesne avec la SAT, Atau Tanaka avec le son corporisé, Gregory Chatonsky avec le web installé, le collectif Dumb Type avec ses dispositifs scéniques, Dominique Gonzales-Foerster avec l’espace d’exposition, Masaki Fujihata avec la réalité augmentée rejoint par Mullican… et on écarte de nombreuses autres expérimentations qui vont nous mettre (la) face à la réalité de leurs mondes virtuels.
Pourtant, depuis 2013 l’industrie du divertissement revient en force pour nous proposer de nouveaux masques VR… HTC Vive, Samsung Gear, CardBoard, Oculus Rift[19] à connecter à de simples smartphones. Les spectateurs sont-ils prêts à se masquer la face ?
Aujourd’hui enfin souverain (dans tous les sens du terme du petit théâtre VR de ses émotions, qu’il soit auteur, consommateur ou industriel, le spectateur doit faire de ce nouvel outil de visualisation le possible de ses désirs. Car, si « le cinéma substitue un monde qui s’accorde à nos désirs » (André Bazin), comment appréhender la VR ? Comment vivre le méta-cinéma VR qui nous est promis, si ce n’est de désirer le vivre de tous nos sens technologiques.
Visage(s) émotif
Aussi révolutionnaire que les fantasmagories de EG Robertson[20] (1798), aussi libre que le Panorama (Fulton 1805) et aussi spectaculaire que le Cinématographe Lumière (1895), la réalité virtuelle dès 1980, puis augmentée des années 2000, et enfin mixe en 2010, nous propose de vivre une relation avec les images sans écran. Une organogenèse digitale avec chaque corps spectateur, une greffe technologique construite à partir d’expériences quotidiennes.
Des promesses sanglantes de cinéastes du fantastique tels que Michael Powell, avec Peeping Tom (Le Voyeur, 1960), ou Bertrand Tavernier, avec La Mort en direct (1981), le grand fantasme des auteurs a toujours été d’allier l’histoire à l’expérience et le sujet au regardeur. Le mythe de méta-cinéma du Rocky Horror Picture Show[21], devenu à la fois une expérience théâtrale (les cinémas sont également d’anciens théâtres) et (avant l’heure) un réseau social de fans, est dans la lignée des grands fantasmes des chargés de programmes nouvelles écritures – des grands médias de papa – pour faire de la VR un divertissement populaire et technologique. Mais passé l’effet wouah !, notre société du spectacle « émotionnaliste » (Jean-Louis Bischoff) a beaucoup de mal à sauter le pas d’une mutation industrielle et médiatique sans précédent. Équipements, usages, et narrations sont remis en cause au profit d’une nouvelle émotion-spectateur, alors que les publics sont déjà ailleurs sur les réseaux.
Et certains vont jusqu’à se moquer de cet appareillage, comme les plasticiens Fabrice Hyber ou Pierre Huyghe. En 1995, Fabrice Hyber, avec son POF #002 (Prototype d’Objet en Fonctionnement) Deep Narcissus, démontre ironiquement que la VR est question d’expérience personnelle. Il propose à son spectateur de s’équiper de ce POF, masque de plongée transparent à deux balles dont le verre est remplacé par un miroir. Ce dernier se perçoit juste un court instant avant de tomber dans une semi-obscurité où la vision de sa propre image, de son propre visage, devient une image jamais vue et toujours connue, qui n’existe que par les mouvements qu’il perçoit à l’écran. Juste retour de ses envies de voir quelque chose, de ses envies d’images. Habité par ce masque aveugle, qui devient de ce fait son visage, le spectateur a le temps de se poser une question : la VR est-elle un double chamanique pour parler aux autres mondes ?
Pierre Huyghe, quant à lui, imagine une prothèse différente. Une sorte de livre ouvert et lumineux qui couvre les visages des personnages de ses expositions et d’un long film (2h2mn) intrigant The Host and the Cloud 2011. Comme les spectateurs VR d’aujourd’hui, les acteurs de cet essai fantastique se montrent telle une communauté d’aveugles. Société futuriste hybride en pleine initiation (ou prière) aux flux de lumière, bal masqué rétro-futuriste d’une société sans visage à venir, quand tout le monde aura en prothèse, un masque VR de RA, par exemple ; est-ce ainsi que sera le monde ?

Paradoxalement, un des grands succès publics de la VR de la chaine Arte en 2015-2016 a été Notes On Blindness – Into Darkness, mise en expérience (utilisons ce terme un peu barbare) d’une histoire vraie. Celle d’un universitaire américain, John Hull, professeur de théologie, atteint d’une maladie visuelle dégénérative. Devenant aveugle jour après jour il écrit et décrit sa vie, son parcours vers le côté obscur de notre monde. Adaptation de ce livre, cette expérience VR, très esthétisante, ne nous fait jamais revivre cette tragédie. Et ironie du sort, le spectateur de Notes on Blindness met un masque VR non pas pour mieux voir… mais pour moins voir ! Et encore une fois, à la gloire de l’effet.
Visage(s) social
Pourtant, dispositif aux vertus curatives, la réalité virtuelle associée au jeu vidéo, fut utilisée pour faire revivre des traumatismes et soigner les stigmates psychologiques des vétérans traumatisés à base de jeux de rôles immersifs. Avec ses films Serious Game III (2010) et Reconnaitre et poursuivre (2003), le réalisateur/cinéaste Harun Farocki a démontré que ces reconstitutions virtuelles guerrières entraînent, soignent et distraient. Et le photographe belgo-tunisien Karim Ben Khelifa utilise aussi la VR, associée à l’IA (l’intelligence artificielle), comme un outil social, geste de réconciliation des affrontements fratricides.
En 2014, avec le projet The Enemy[22], le photographe reporter de guerre Karim Ben Khelifa, artiste invité au MIT[23], propose à l’Institut du Monde Arabe, en VR, et aussi sur smartphone en réalité augmentée, une expérience sidérante destinée aux populations ennemies. Fruit de ses recherches avec France Télévision et le MIT, cette rencontre – rendue possible avec la création d’avatars 3D de leur (meilleur) ennemi, mis en abîme par l’ajout de leur portrait photographique – peut-elle révéler le visage absurde de guerres fratricides ? The Enemy résonne comme le témoignage direct du journaliste dans ses face-à-face avec les combattants des cinq continents. Avec The Enemy, la VR nous fait non seulement accéder à une expérience technique et sociale inégalable, boostée par une Intelligence Artificielle et un sens journalistique probant, mais nous propose aussi de partager l’expérience avec d’autres regardeurs, à la fois spectateurs et acteurs de l’expérience. Filmés en Palestine (avec les combattants du Fatah et ceux de Tsahal), au Congo (avec les rebelles et les militaires de l’armée régulière), et au Salvador (avec deux gangs sanguinaires rivaux), chaque combattant est l’objet d’un face-à-face avec son adversaire. The Enemy place alors chaque fois son spectateur entre les deux rivaux et à lui d’établir le contact avec l’un, l’autre, les deux.

Cependant face au visage et au corps de chacun de ces témoins recréés en 3D interactive, le spectateur reste seul un moment, puis va établir le contact direct. Chaque combattant s’adresse à lui, il est son voyeur, il est face à face, visage contre visage, corps à corps, de près ou de loin. En cela Karim Ben Khelifa trouve la dimension juste pour nous faire revivre ces rencontres dans ces zones de guerre comme autant de précieuses rencontres humaines. Dispositif « multi-users », The Enemy propose à un groupe d’évoluer dans ce « musée » de la haine qui devient musée de la paix l’espace de notre visite. Car chaque guerrier a le même discours… celui de la paix comme rêve ! Le spectateur VR de Karim Ben Khelifa n’est plus seul, il partage une aventure commune. Pourtant, il n’est plus temps de se divertir que de partager la prise de conscience sociale et politique que tout bon documentaire peut convoquer, mais ici par visage(s) interposé(s).
Aujourd’hui les spectateurs de notre nouveau méta-cinéma qu’est la VR (ou même les réseaux sociaux) n’ont pas de visages et voyagent à travers une méta-activité spectatrice subjective où le regardeur n’existe plus… il est le regard. Et c’est ce regard que Karim veut changer en proposant son dispositif dans les zones mêmes des conflits où il a tourné et engagé ces rencontres. Mettre les frères (ennemis) face à face avec le visage de leur fraternité. Le sujet, le regardeur est l’objet, le regardé ; c’est ainsi que Rabanel[24] tente de clarifier la situation de celui qu’il appelle son spectateur ultra-contemporain.
« Le cerveau c’est l’écran ! » écrivait Deleuze. En écho au philosophe, le réalisateur de Dobermann[25] constate la disparition de l’écran dans la réalité virtuelle et sa proximité de l’état du rêve. Le cerveau est réellement devenu l’écran (qui a disparu) et Deleuze a mille fois raison, le cerveau est plus que jamais devenu l’interface de nos images… quatrième mur que nous sommes devenus, nous, spectateurs ultra-contemporains aux yeux sans visage(s).
« Parmi tous les concepts agités par les surréalistes, celui que préférait Franju, […] ce cinéaste de commande, qui s’est violemment opposé au cinéma de divertissement, qui dominait son temps, […] et qui présupposait une activité critique et créatrice de la part de son spectateur », écrit Gérard Leblanc « était celui de l’insolite[26] ». Franju disait que « l’insolite était le non-événement, la perception de l’inhabituel issu du quotidien », « l’anormal du normal ». Ne serait-ce pas là une description de ce que devrait nous proposer la création VR, l’anormal du normal ; une créativité dans une réalité artistique reconstruite.
En 2025 nous allons voir comment quatre expériences en VR (réalité visuelle), en AR (réalité augmentée), ou en XR (réalité mixte) – nouvelles normes de lunettes – nous permettent d’hybrider les réalités-spectateur à travers différentes narrations immersives. La VR mise en abîme de ses aquarelles par Jérémy Griffaud, Jeune niçois qui présente au Musée Chagall de sa ville une exposition immersive, Sous le Ciel (2025), devient une VR (faite à la maison) mais qui rivalise de trouvailles monstratives. Ce qui n’est pas le cas de la grosse artillerie qu’est Ito Meikyū (2024). Imaginée par l’artiste animateur Boris Labbé et présentée au Drawing Lab de Paris, cette pièce, Grand Prix du Festival de Venise Immersive 2024 (ou quand la 81e Mostra réunit 63 œuvres de 25 pays) Ito Meikyū engage le spectateur aveugle de son casque VR dans un monde féerique passionnant qui le projette dans la nouvelle vision d’un monde qui se développe autour de références de l’histoire de l’art comme de la littérature japonaise (le Fukinuki Yatai, Le Dit du Genji, Les Notes de Chevet). Ici, l’espace virtuel déambulatoire fonctionne comme un cadavre exquis qui lui permet d’accéder aux différentes scènes ; une sérendipité s’engage alors comme une partie de cache-cache au centre de laquelle nous devenons le regardeur-voyeur omniscient et curieux de la création née de notre visite.
Pourtant l’époque, comme l’avenir de ce type d’appareillage, semble développer un engouement pour la réalité mixte XR. Le masque VR ouvrirait une mixité des réalités. Le normal et l’anormal réunis en un même temps dans une surréalité. Là aussi, deux créations récentes montrent les limites d’un narratif à la faveur d’une innovation technologique. Ainsi l’Ombre (2015) livrée par Blanca Li lors du festival Manifeste du Centre Pompidou reste déceptif. Dix ans après le succès de 360°, la chorégraphe franco-espagnole revient avec une adaptation incompréhensible d’un conte d’HC Andersen. Stupéfiant d’hybridations techniques, rythmées par un live époustouflant de percussions, ce spectacle pharaonique s’essouffle, alors que le modeste Silence(s), paysage du Vide (2025) de la jeune Faye Formisano (Seine Musicale Lab) nous fait voyager dans un univers intérieur narratif plus conséquent. Réservé dans ses ambitions, mais ambitieux dans un scénario entre nouvelle vague et nouveau roman, Silence(s) propose un futur désirable à l’expérience visuelle sous masque XR. Une jetée visuelle à la croisée des réalités comme des virtualités.

Visage(s) sans regard
En regardant tous ces méta spectateurs masqués d’œillères technologiques et casqués d’écouteurs binauraux, on pense à nouveau à Georges Franju et à son film Les Yeux sans visage[27]. Dans ce film des années 1960, surréaliste en diable, Franju travaille sur le double : répétition des situations, duplication des personnages…
Les Yeux sans visage est un film fantastique où Georges Franju rend visible ce que l’on ne voit pas dans une sorte d’infra-réalisme. Un chirurgien cherche un visage pour sa fille défigurée et tue des jeunes filles aux doux sourires pour réussir enfin une greffe, sans espoir pour cette jeune enfant innocente qui ne retrouvera jamais de visage. Ne serait-ce pas là une allégorie de ce qui se passe aujourd’hui avec la VR qui cherche à réussir une greffe sans espoir sur ses spectateurs ? « Ce qu’il y a d’admirable dans le fantastique », disait André Breton, « c’est qu’il n’y a plus de fantastique, il n’y a que le réel ». Si on remplace fantastique par virtuel, Breton nous dresse ici le portrait de la réalité de la réalité virtuelle. Nous sommes au cœur des recherches du philosophe Bernard Stiegler sur l’« organologie générale ». Greffe technologique sans espoir, la VR, AR, XR demeure un leurre de plus de l’industrie du rêve, masque destiné à oblitérer le « chaos de l’anthropocène en marche[28] » (Stiegler) pour que nos regards restent… des Yeux sans visage(s).
[1]Marcel Duchamp développe la notion d’infra-mince et commence par cette sentence « Le possible est infra-mince ». Pour Duchamp, tout ce qui n’existe pas, ou n’a même pas encore été formulé, est dans l’infra-mince.
[2] Jan Kounen, réalisateur français connu pour ses expérimentations formelles et chamaniques dans ses films de fiction (Dobermann 1996 ; 99 Francs, 1997 ; Blueberry, l’expérience secrète, 2004) ou documentaires (Darshan – L’étreinte, 2005 ; Mère Océan, 2016 ; ou D’autres Mondes, 2004) et aussi pour ses expériences VR remarquables (Ayahuasca – Kosmic Journey, 2019, –22,7°C, 2019 ; ou Seven lives, 2019.
[3] Les GAFAN, acronyme de Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix, qui par son N a remplacé le M de Microsoft.
[4] Le spectateur augmenté, terme qu’emploie Jean-Jacques Gay dans sa thèse sur la nouvelle organologie numérique des spectateurs des arts des nouveaux médias, précurseurs à nos errements technologiques contemporains : Le spectateur augmenté face à l’Art Numérique comme organogenèse programmée, Université Paris 8, nov. 2018.
[5] Cf. Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Les écrits sur le cinéma T. II (1984-1998), Paris, Éditions Cahiers du cinéma, 1985.
[6] 360°, expérience VR de Blanca Li, réalisée en 2014 avec 20 danseurs.
[7] Cf. Jean Claude Yon, Pascale Goetschel dir., Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire contemporaine », 2014.
[8]Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938.
[9] Cosa mentale est développée à la Renaissance par Léonard de Vinci comme « une pensée de l’œuvre avant sa réalisation ». Il écrit dans son Traité de la peinture (1490) « la peinture est une chose mentale » (cosa mentale).
[10] Oxymore, figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. Exemple : un silence éloquent ou dans notre cas mort-vivant.
[11] Maurice Benayoun (AKA MoBen), auteur, réalisateur, plasticien, chercheur et universitaire fonde le CiTu, équipe de recherche du laboratoire Paragraphe avec Jean-Pierre Balpe. Pionnier des Arts de nouveaux médias internationaux. benayoun.com/moben/
[12] Cf. Platon, et son « Allégorie de la caverne », texte célèbre du Livre VII de La République (428 – 348 avant J-C). Le philosophe imagine une conversation entre Socrate et son élève Glaucon, où le philosophe évoque l’ignorance et la connaissance, mais aussi la problématique de la transmission de cette connaissance.
[13] Cf. René Descartes, Discours sur la Méthode (1637).
[14] Cf. René Descartes, Méditations métaphysiques (1641).
[15] Troupe de théâtre expérimental et libertaire créé en 1947 par la metteuse en scène Judith Malina.
[16] Pascal Rousseau, « The Other – Matt Mullican sous hypnose », in Matt Mullican. 12by2, Paris, Presses du réel, 2010.
[17] Denis Diderot, Les Salons 1759/1781, le libraire Grimm en propose un compte rendu des neuf salons relatés par Diderot aux abonnés (souvent étrangers ou non parisiens) de sa Correspondance littéraire – réédition posthume en 1798, puis en 1819. E Édition moderne complète : Denis Diderot,Salons, Paris, Gallimard, 2008.
[18] Le principe d’« absorption » est annoncé par les premiers traités d’esthétique de l’Abbé Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719), réédition ENSBA, Paris, 1994.
[19] 2013, nouvelle version de l’Oculus Rift. 2014, Oculus VR (créé en 2011) est acquis par Facebook pour 2 milliards de dollars. Apparition du HTC Vive, développé en coproduction entre HTC et Valve Corporation. Sony annonce un projet de casque de réalité virtuelle pour sa console de salon la Playstation VR. En septembre 2014, Samsung annonce son propre casque de réalité virtuelle : Samsung Gear VR. 2015, Valve et HTC annoncent leur collaboration sur un projet de casque de réalité virtuelle : le HTC Vive. En novembre 2015, le Samsung Gear VR est disponible à l’achat. En 2016, cinq casques de réalité virtuelle seront commercialisés et les smartphones s’adaptent à des Cardboard.
[20] Étienne-Gaspard Robert dit Robertson, scientifique et aérostier, est à l’origine des spectacles fantasmagoriques de la fin des temps révolutionnaires. Il déposa de nombreux brevets de dispositifs de projections d’images et serait aussi à l’origine du Panorama.
[21] Jim Sharman, Rocky Horror Picture Show, USA, 1975.
[22] The Enemy installation VR multi-utilisateurs et application de réalité augmentée pour smartphone initiée par France Télévision Nouvelles Écritures, sous la houlette visionnaire de Boris Razon (aujourd’hui slade.fr) par le photographe reporter Karim Ben Khelifa, artiste invité du MIT où il entre en collaboration avec le professeur d’intelligence artificielle Fox Harrell du laboratoire ICE.
[23] MIT, le Massachusetts Institute of Technology est une célèbre université américaine de l’état du Massachusetts, à proximité immédiate de Bostonfondé au XIXe siècle et précurseur sur presque tous les nouveaux axes de recherche sur les technologies avant-gardistes.
[24] Rabanel, Spectateurs Sidérés. Ou l’Allégorie du Goéland, Paris, L’Harmattan, 2016.
[25] Jan Kounen, cf. note #2.
[26] Gérard Leblanc, Georges Franju, une esthétique de la déstabilisation, Saint-Étienne, Créaphis éditions, 1992.
[27] Les Yeux sans visage, film fantastique franco-italien de Georges Franju (1960), avec Pierre Brasseur, Alida Valli, adapté du roman de Jean Redon, publié dans la collection « Angoisse » des Éditions Fleuve noir, en 1959.
[28] Anthropocène, période géologique proposée pour caractériser l’époque de l’histoire de la Terre qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l’écosystème terrestre.