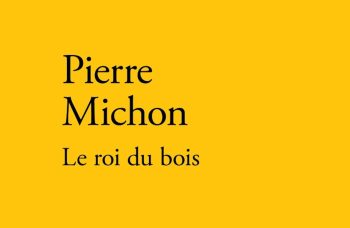Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui, nous publions une contribution de Rodolphe Olcèse.
Quelle que soit la forme qu’il puisse prendre, le souci est d’abord le signe d’un esprit traversé ou mis en mouvement par une inquiétude. En cela, la simple expression de « souci des œuvres » exprime implicitement que les œuvres ne nous laissent pas en paix, ce dont nous pouvons tous faire l’expérience d’une manière ou d’une autre. Nous nous en inquiétons quand nous voulons les voir, les préserver, et plus encore quand nous voulons les produire ou les réaliser. Le premier à se soucier d’une œuvre n’est-il pas en effet celui à qui il incombe de la faire, et qui doit trouver les ressources pour répondre à cet appel d’une forme à venir ? Mais cette expression dit peut-être, par sa simplicité même, quelque chose de plus radical encore. Les œuvres en effet ne sont-elles pas elles aussi, d’une certaine manière, non seulement l’objet, mais le sujet d’un souci et d’une inquiétude quant à leur devenir ? Les œuvres ne sont-elles pas en souci les unes des autres et inquiètes les unes pour les autres ? C’est l’hypothèse que nous voulons formuler à partir du travail de Marylène Negro, une plasticienne qui développe une pratique filmique au moyen de laquelle elle entretient un dialogue plus ou moins explicite, mais toujours riche et fécond avec des œuvres du patrimoine cinématographique.
En 2014, Marylène Negro réalise notamment deux films qui composent une sorte de diptyque : You I Tourneur, fabriqué à partir de photogrammes de films de Jacques Tourneur, et Matteo, qui s’empare pour sa part de l’intégralité de L’Évangile selon Saint-Matthieu de Pasolini, films qui engagent un principe de composition dont les ressorts mêmes sont particulièrement éclairant sur le souci qui motive de tels travaux. Dans ces deux films, des œuvres du patrimoine cinématographique sont exploitées comme une matière première pour faire surgir une figure – en l’occurrence un visage – qui dans un même mouvement suppose et occulte radicalement cette matière. You I Tourneur et Matteo sont des films de remploi s’enracinant dans un geste artistique qui fait disparaître purement et simplement les ressources utilisées au profit d’une forme qu’elles contiennent potentiellement mais ne pouvaient elles-mêmes laisser apparaître.
L’œuvre au moyen de l’œuvre
Dans Matteo (2014), mais cela vaut également pour You I Tourneur (2014), l’œuvre est à la fois le moyen et la fin du mouvement de création. Le premier geste de Marylène Negro devant cette forme qu’elle envisage de produire consiste à prendre acte de la préexistence d’une autre œuvre, qui peut constituer la matrice de son propre film. Œuvrer, au sens artistique, c’est toujours s’inscrire dans une histoire, dans un jeu de relations qui sont, d’une façon ou d’une autre, parties prenantes des actes de création auxquels ils ouvrent la voie : le souci des œuvres exprime le fait que c’est l’existence même de ces œuvres qui conditionne les possibilités à venir de multiples gestes artistiques. Chez Marylène Negro, cette inscription dans une communauté de formes préexistantes se manifeste par un acte de reprise qui transforme radicalement l’objet dont il se saisit, au point de le rendre méconnaissable et de le faire disparaître dans une plasticité qui n’est plus celle du film réemployé, mais celle de la forme filmique qui l’accueille, ou plutôt qui s’accueille elle-même avec lui.
Pour en prendre la mesure, il convient de décrire le processus de fabrication de Matteo. Ce film se saisit de la totalité de L’Évangile selon Saint-Matthieu selon deux modalités différentes mais complémentaires. Le film de Pasolini est diffusé en accéléré, en arrière-plan, après inversion de ses valeurs chromatiques. Les 140 minutes de L’Évangile selon Saint-Matthieu sont donc contractées en 10 minutes, et les figures qui traversent fugitivement le fond de l’écran apparaissent en « négatif ». Cette première transformation rend de fait le film de Pasolini méconnaissable et le perd dans un flux visuel qui frappe à la fois par sa vélocité et son instabilité. L’Évangile selon Saint-Matthieu devient une matière première, le révélateur d’une forme tout entière présente à l’écran, où elle doit pourtant encore apparaître. Cette seconde image qui prend fond sur ce flux d’images contractées, c’est un visage, lui-même obtenu par la superposition de tous les visages d’homme qui traversent le film de Pasolini. Ces visages, Marylène Negro les a isolés, recadrés et superposés au visage de Jésus, joué dans le film de Pasolini par le militant espagnol Enrique Irazoqui. Cette figure que le film va provisoirement révéler se présente ainsi comme une composition réalisée à partir de toutes les faces masculines proposées par le film et indexées sur le visage de Jésus. En ce sens, c’est une omni-indicialité de L’Évangile selon Saint-Matthieu qui annule toute référence explicite à ce film. Comme le Christ des Miettes philosophiques de Sören Kierkegaard, le film de Pasolini traverse l’écran de manière parfaitement incognito.

L’Évangile selon Saint-Matthieu est une « matière d’images », selon l’expression qui forge le titre d’un ouvrage de Jacques Aumont. Examinant les migrations et transformations auxquelles donnent lieu les réappropriations d’images (empruntées à la peinture notamment), Jacques Aumont écrit : « Assimiler [un héritage] ne veut pas dire calquer ni dériver ; cela veut dire refaire, et à neuf. Démontage et remontage conscients, désarticulant la scène en ses éléments premiers, personnages, lieux, accessoires, moments, mimiques, postures – pour la recomposer avec les mêmes éléments dans un autre ordre[1] ». On accordera que la désarticulation ne peut être plus totale et plus radicale que dans Matteo, où il ne reste rien, au premier abord, du film de Pasolini, sinon une trace fugitive qui soutient un visage dont le film figure l’apparition. Mais ce qui importe dans cette incise de Jacques Aumont, qu’il rédige pour évoquer un film de Godard, c’est cette idée que faire, quand on revendique un héritage comme source et moteur d’une œuvre personnelle, c’est toujours re-faire, c’est-à-dire non pas recommencer à l’identique un geste effectué par un autre, mais répondre par un acte personnel à un geste autre, qui le précède et qui d’une manière l’a suscité. L’acte de création, dans ce registre très particulier du remploi qui nous intéresse ici, où le patrimoine cinématographique devient un terreau élémentaire, consiste à répondre à une forme singulière par une forme singulière. C’est en quoi ce film de Marylène Negro signale dans sa méthode même un double souci de l’œuvre : soucis conjoints pour l’œuvre reçue et pour l’œuvre à faire, qui coexistent dans un lien tissé par le geste artistique lui-même. Car toute réponse fait exister ou résonner en elle quelque chose de l’appel qui l’a conduit à elle-même, toute réponse communique quelque chose de ce à quoi elle répond, ne serait-ce que cette part de sollicitation ou de pro-vocation qu’il lui apporte.
Un autre aspect important de ces deux films de Marylène Negro découle de cette idée. Matteo, ainsi que You I Tourneur avant lui, font exister dans l’image les outils qui ont servi à sa composition. Ces deux œuvres, qui sont des films de montage, laissent apparaître les repères de cadre que proposent les outils de composition numériques, lesquels repères ont servi directement à l’élaboration de ces films puisqu’ils reposent tous deux sur des opérations de recadrage. Par ce parti pris de réalisation, Marylène Negro donne à voir la nature du lien qu’elle cherche à établir au film de Pasolini dans un cas, et à l’œuvre de Jacques Tourneur dans l’autre. Le rapport instauré aux images d’origine est matérialisé à l’écran. Il ne s’agit donc pas seulement, en ce sens, de réemployer des images préexistantes, mais d’exposer la part relationnelle dont les images ainsi composées procèdent : le film lui-même devient relationnel et partage ce qui conditionne cette relation dans laquelle il s’engage. Le faire se réalise en exposant les moyens de faire et une petite part de la machine rentre dans l’image dont elle soutient la composition. Comme s’il fallait rappeler dans le processus même du film que ce dernier n’est pas un objet donné une fois pour toutes, mais que sa forme est au contraire indissociable du mouvement qui l’accomplit et qui en un sens se rejoue à chaque projection. Cette décision artistique de Marylène Negro réaffirme le caractère processuel des œuvres de cinéma et s’y installe.
En exposant ce au moyen de quoi ses films opèrent, Marylène Negro peut tout à la fois occulter complètement le patrimoine cinématographique qu’elle explore et rappeler que son propre travail n’a de sens que dans son rapport à cette source qui l’irrigue et le fait croître. En ce sens, de tels films, pour radicalement étrangers qu’ils puissent être au patrimoine qu’ils accueillent, retiennent quelque chose de leur « fond perdu » et c’est cette rétention qui permet de faire jaillir une image – un visage – qui surgit à la matière d’une matrice invisible ou inaccessible. Les films de Marylène Negro manifestent une potentialité qui appartient paradoxalement aux œuvres qu’elle exploite, mais qui ne peut être captée et enregistrée que par la manipulation de ces ressources filmiques. « La caméra, c’est l’écran », selon le mot paradoxal de Jean-Luc Godard dans les Histoire(s) du cinéma[2]. Cette phrase exprime parfaitement la singularité de l’acte artistique de Marylène Negro. Elle donne également corps à cette idée d’un double souci de l’œuvre qui à partir de films préexistants invite à prêter attention à des formes possibles qui les traversent secrètement.
Retenir le flux
Malgré l’extrême rareté de ses considérations sur l’art en général et sur le cinéma en particulier, la philosophie d’Emmanuel Levinas peut être d’un secours précieux pour mettre en évidence ce qui est en jeu dans ces films de Marylène Negro. Dans De l’existence à l’existant[3], une courte digression sur le gros plan au cinéma fait apparaître une propriété fondamentale du médium filmique – lequel médium intéressait assez peu le philosophe – et au-delà, de toutes formes artistiques. Emmanuel Levinas vient de souligner que le propre du tableau est d’arracher et d’isoler un bout d’univers pour le particulariser. Cette forme, dit-il, propose à la fois un monde déterminé, à même de coexister, dans un musée notamment, avec d’autres mondes singuliers, mais aussi elle donne à voir une réalité donnée dans sa nudité, c’est-à-dire en tant qu’elle procède ou provient d’un monde cassé (entendons : un monde qui ne répond plus aux usages que nous pourrions en avoir). Or, dit Emmanuel Levinas, il en va de même du gros plan au cinéma, qui opère un tel geste à un double niveau pourrait-on dire, à l’endroit du monde, représenté par autant de segments isolés qu’orchestre le film, mais aussi à l’endroit de l’œuvre filmique elle-même, qui par le gros plan suspend ou surprend quelque chose dans son propre mouvement pour lui donner une existence particulière. Les gros plans, écrit Emmanuel Lévinas [Levinas], « n’empruntent pas leur intérêt uniquement à leur pouvoir de rendre visibles les détails. Ils arrêtent l’action où le particulier est enchaîné à un ensemble pour lui permettre d’exister à part : ils lui permettent de manifester sa nature particulière et absurde que l’objectif découvre dans une perspective souvent inattendue, la courbure d’épaule à laquelle la projection donne des dimensions hallucinantes en mettant à nu ce que l’univers visible et le jeu de ses proportions normales estompent et dissimulent[4] ». De même que le tableau, le gros plan isole, mais ce qu’il isole est lui-même arraché à un ensemble qui se donne comme une forme esthétique, c’est-à-dire peu ou prou comme un ensemble limité prélevant dans une réalité qui le dépasse absolument une infime portion pour lui donner une existence autonome. En un sens, le gros plan est comme un tableau dans le tableau, un prélèvement dans le prélèvement, une puissance à même d’arrêter ou de retenir un être particulier dans le flux insaisissable du film.
Déjà Béla Balázs, dans l’un de ses précieux ouvrages sur le cinéma, soulignait que le gros plan fait surgir dans le flux du film une vie propre aux choses minuscules qui d’ordinaire passent inaperçues :
« La caméra n’a pas fait que montrer des choses et des événements inconnus jusqu’alors : l’aventure de minuscules scarabées dans la forêt vierge des herbes, le drame d’un coq dans une basse-cour ou l’érotisme des fleurs. La caméra n’a pas fait que découvrir la poésie de paysages en miniature. Elle n’a pas fait qu’apporter de nouveaux sujets. Avec le gros plan, le cinéma a découvert aussi les racines secrètes de la vie déjà connue – que nous avions l’illusion de connaître. Car la vie la plus grande est constituée de ces vies minuscules et elle en est le résultat[5] ».
Dans un contexte tout différent, Béla Balázs rappelle lui aussi, comme le feront Siegfried Kracauer et Walter Benjamin par la suite, que le cinéma nous fait accéder à ce qui échappe ordinairement à notre attention : les vies minuscules qui participent, en la rendant possible, d’une vie plus grande, plus vaste, plus large. Cet accès nouveau à des vies discrètes ou invisibles ne fait pas qu’ouvrir une dimension nouvelle dans une réalité elle-même renouvelée. Car ces vies minuscules sont approchées selon un double mouvement : élargissement de l’image que nous nous faisons de la vie ; le gros plan, dit encore Béla Balázs, en est aussi l’approfondissement. « Le gros plan ne se borne pas à montrer de nouvelles choses, il en révèle le sens[6] ». Le propre du gros plan au cinéma serait donc de retenir ce qui échappe, de rencontrer ce qui a pour vocation de passer inaperçu, de rester incognito.
À strictement parler, Marylène Negro se situe, d’un point de vue technique et formel, dans un tout autre espace que celui du gros plan cinématographique. L’enjeu de Matteo et de You I Tourneur n’est évidemment pas de focaliser sur une réalité minuscule à laquelle nous ne prêtons pas attention ordinairement. Le visage qui apparaît progressivement est cadré, ou plutôt recadré, en plan rapproché. Cependant, là où le geste de Marylène Negro se rapproche de cette question du gros plan, c’est dans la manière qu’il a d’isoler et de particulariser des éléments de l’ensemble ou de l’action auxquels ils appartiennent. Il s’agit bien de découvrir les traits d’un visage soustrait à tout rapport au réel, un visage abstrait par excès de détermination concrète pourrait-on dire. Car la dimension picturale des visages découverts par ces deux films de Marylène Negro résulte de l’empilement de visages et de traits sensibles. La plasticité de ces figures est le résultat d’une compilation de particularités, que les films isolent et perdent à la fois dans cette face unique qui vibre de la vie de ces autres visages entrant en composition les uns avec les autres. En un sens, on pourrait dire que Marylène Negro, par cette opération, retient et agence tout ce qui se joue « entre les lignes », « entre les traits », comme le dit encore Béla Balázs du gros plan, « sur un visage invisible[7] » qui se donne à voir directement quand on écarte définitivement l’environnement spatial et narratif dans lequel il s’inscrit.
Ce que montre Marylène Negro, c’est que le cinéma peut à sa manière et selon ses exigences propres, qui ne sont pas éthiques mais esthétiques, donner à voir le mouvement de rencontre du visage tel que Levinas s’efforce de le penser. Sans faire l’exégèse de cet aspect de sa philosophie, rappelons simplement que le visage est l’expérience d’une défection de la phénoménalité. Le monde dans lequel cette rencontre m’arrive se retire, se soustrait, se délite sous le ruissellement de l’infini dont le visage est le lieu. Pour Emmanuel Levinas, le visage apparaît en défaisant, en désarmant tout savoir, toute anticipation, toute référence objective à un monde commun qui pourrait me donner une prise ou une emprise sur lui[8]. Le visage, dit Levinas, est une étrangeté absolue et ne peut se résoudre dans aucun système de significations. En accélérant considérablement L’Évangile selon Saint-Matthieu de Pasolini, Marylène Negro défait littéralement le monde dont provient ce visage qu’elle compose, et que le film nous donne comme une forme absolue, déliée de toute relation à un environnement narratif permettant d’en justifier l’apparition. Le visage de Matteo pour apparaître suppose que le film de Pasolini soit comme évidé de son contenu.
Il n’est pas anodin que dans De l’existence à l’existant l’œuvre d’art soit comprise à partir de la notion d’exotisme. Les paragraphes sur le tableau et le gros plan évoqués ci-dessus prennent en effet place dans le chapitre « L’exotisme » d’une partie intitulée quant à elle « Existence sans monde ». « La réalité exotique de l’art qui, n’étant plus objective, ne se réfère pas à notre intériorité, apparaît à son tour comme l’enveloppe d’une intériorité. C’est d’abord l’intériorité même des choses qui, dans l’œuvre d’art, prennent une personnalité[9] ». C’est par son étrangeté que le tableau ou le gros plan apparaît comme l’enveloppe d’une intériorité. Ce qui apparaît avec le gros plan ou le tableau se tient dans une indépendance, ne concerne en rien mon usage du monde ou les relations que j’entretiens avec lui. C’est pourquoi le tableau – ou le gros plan – devient l’enveloppe, pour Emmanuel Levinas, ou le visage, pour Béla Balázs, d’une intériorité qui me fait face. Dans une autre courte digression sur le médium filmique, que l’on trouve dans des inédits publiés sous le titre « Carnets de captivité », Levinas écrit : « Dans l’Aufmachung les choses apparaissent dans le mystère de l’étrangeté. Étrange – étranger. Dans leur étrangeté les choses se révèlent comme mystère. C’est le charme du cinéma[10] ». Le charme du cinéma tel que l’évoque Emmanuel Levinas dans cette courte note, c’est cet apprêtement, cet arrangement du visible qu’il organise et qui fait apparaître les choses dans une part de mystère et d’étrangeté. Au cinéma, des choses qui me sont familières se présentent à moi depuis une extériorité, un dehors dont je ne peux pas percer le secret. Même l’image la plus quotidienne revêt au cinéma une dimension d’étrangeté qui fait que je ne peux pas la recevoir autrement que sur le mode de la rencontre. Le fait est que, eu égard au film de Pasolini, le visage de Matteo fait figure de pure altérité.
Ce que la rencontre opère
Tout en transformant L’Évangile selon Saint-Matthieu de Pasolini, Marylène Negro ne cesse donc d’y renvoyer comme à un film qu’il faut précisément rencontrer. Et la création elle-même peut constituer un moment de cette rencontre. Il importe de souligner que ces deux films de Marylène Negro ont été conçus sur la table de montage. Ils ne répondent pas à un projet, mais à une intuition, ou plutôt à une série d’expérimentations et de tentatives. Marylène Negro évoque elle-même l’apparition de ces deux visages sur sa table de montage comme une découverte et une rencontre. Il fallait mettre en œuvre le recadrage et la superposition de ces mille visages pour voir ce que ce geste pouvait produire. C’est en cela qu’un tel acte relève de ce que le philosophe Henri Maldiney appelle « les créations de l’appel », en les distinguant des créations qui relèvent du projet : « Parmi les créations artistiques les unes répondent à un projet, les autres à un appel. Les premières sont en projet dans le projet d’un monde dont l’artiste est l’ouvreur, les secondes ne découvrent qu’à la fin leur origine. La parole de Blanchot : « qui n’appartient pas à l’œuvre comme origine ne fera jamais œuvre » ne signifie pas que l’œuvre est là d’avance, mais que l’origine et l’horizon de la création ne sont là qu’avec l’œuvre (…). L’œuvre est en l’artiste en souci de son essence. Mais son essence n’est pas là d’avance ; elle ne se révèle qu’à la fin, en existant, c’est-à-dire dans une œuvre où les formes, qui existent ont leur auto-génèse. On peut dire que l’existence de l’artiste est le champ opérationnel ouvert par la formation d’une œuvre en voie d’elle-même appelant son essence : en energeia[11] ». L’artiste ou le réalisateur est un moyen pour l’œuvre et non l’œuvre un moyen pour l’artiste de réaliser son projet. C’est l’œuvre donc qui dit à l’artiste ce qu’il doit faire pour qu’elle accomplisse son mouvement formateur. L’artiste ne se soucie donc pas tant de l’œuvre qu’il ne répond au souci de l’œuvre : il est l’instrument de son accomplissement. L’artiste devient donc le lieu d’une effectivité dont il n’est lui-même ni l’origine ni le terme, d’un mouvement dont il ne pourra découvrir l’origine et le terme, c’est-à-dire le sens, qu’en le réalisant. Le souci de l’œuvre implique une poétique de l’expérimentation. L’artiste, qui est toujours en recherche, toujours à l’étude, est agi par son œuvre, ce qu’exprime encore Henri Maldiney quand il évoque la notion de projet comme un danger pour l’art : « Pour l’art le projet est un danger à côté duquel ne « croît que ce qui sauve ». Quand l’artiste est fait d’avance, que ce soit dans son être intime ou dans son personnage public, la création des formes cesse d’être formation du créateur. Ce qui manque le plus aux œuvres qui apparemment le recherchent – mais parce qu’elles le recherchent explicitement – c’est le vide[12] ». Une œuvre à laquelle manque ce vide est précisément une œuvre qui ne permet ou ne suscite aucune rencontre. Pour le dire trivialement, l’œuvre est déjà là où on l’attend, elle est comprise d’avance. En un sens, elle ne donne rien à voir, pour autant que le vide ou le rien, dans ce texte de Maldiney, c’est ce autour de quoi s’articule toute apparition : c’est le « y » de l’il y a.
C’est en vidant le film de Pasolini de sa substance que Marylène Negro opère, en obéissant à une intuition dont elle ne peut pas anticiper les effets, l’apparition du visage que son film propose et qui par là déploie diverses modalités ou diverses possibilités de la rencontre. Une rencontre se joue entre L’Évangile selon Saint-Matthieu et Matteo, entre Marylène Negro et la forme qu’elle développe, entre ce visage enfin et le regard qui le reçoit dans la pure gratuité de son apparition. En ce sens, ce film articule les multiples sens que porte le souci des œuvres, souci des œuvres pour elles-mêmes, souci des œuvres les unes pour les autres, souci des mains qui les mettent en œuvre et enfin souci des regards qui les accueillent. Un autre texte de Henri Maldiney conjugue avec subtilité ces multiples inquiétudes qui signent les œuvres et les relations auxquelles elles nous engagent : « Notre contact avec l’œuvre est une rencontre. Toute rencontre est rencontre d’un autre, d’une altérité. C’est par où elle est épreuve de la réalité. Mais tandis que l’altérité d’une chose est une altérité opaque, celle d’une œuvre d’art est rayonnante, parfois dissimulée dans son propre rayonnement. Qu’est-ce qui à la fois se montre et se voile ? L’union de deux principes antagonistes. Une œuvre d’art est d’une part un ouvrage où se trouvent mis en œuvre un matériau, une technique, parfois une fonction, dont la prise en compte relève d’un savoir-faire historiquement déterminé. Mais ce qui dans l’œuvre nous saisit et nous enlève au-dessus de nous-mêmes n’est pas ce qui nous met au niveau de l’artiste, mais ce qui l’élève au-dessus de lui-même en nous. Ce qui nous surprend, nous et l’artiste, dans une œuvre d’art n’est pas sa perfection artisanale témoignant du pouvoir et du savoir de son auteur. Mais ce n’est pas non plus la manifestation d’une puissance supérieure opposée à la première et qui nous terrasserait. C’est l’indissoluble unité des deux[13] ». La rencontre de l’œuvre avec ce troisième homme que constitue le regard du spectateur prolonge le mouvement formateur de l’œuvre, qui est tout à la fois le résultat d’une situation empirique déterminée et transgression ou transcendance de ces déterminations factuelles ou techniques qui conditionnent son existence. L’artiste est porté au-delà de lui-même en nous quand son œuvre nous saisit, dit Henri Maldiney. Matteo est peut-être la mise en image de cette triangulation complexe et évidente à la fois entre un auteur, une œuvre, et le regard qui se dessille à sa rencontre.
L’Évangile selon Saint-Matthieu de Pasolini, rendu inaccessible par les opérations plastiques de Matteo de Marylène Negro, est conduit au-delà de lui-même, transgressé dans ses formes et dans ses effets. Mais il reste tout entier présent à cette œuvre de Marylène Negro et ne laisse pas d’y être envisagé comme ce dont il faut se soucier. Car ce que dit ce visage qui vient à nous, c’est bien que ce film existe – ek-sister, c’est être tendu hors de soi-même – comme une source à laquelle il ne faut cesser de revenir.
[1] Jacques Aumont, Matière d’images, redux, Paris, Éditions de la Différence, 2009, p. 74.
[2] Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, France/1988-1998.
[3] Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant (1947), Paris, Vrin, 1993.
[4] Emmanuel Levinas, op. cit., p. 88.
[5] Béla Balázs, Le cinéma, nature et évolution d’un art nouveau, Paris, Payot, 2011, p. 63.
[6] Ibid., p. 63.
[7] Ibid., p. 191.
[8] Voir par exemple Autrement qu’être, ou au-delà de l’essence, Paris, Le livre de poche, 2004, p. 146.
[9] Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant, op. cit., p. 88-89.
[10] Emmanuel Levinas, Œuvres complètes, tome 1, Paris, Grasset, 2009, p. 82. Aufmachung signifie l’apprêtement, l’arrangement, la parure : l’apparence extérieure d’un objet ou d’un produit.
[11] Henri Maldiney, Existence, crise et création, in Henri Maldiney, une singulière présence, Fougères, Encre marine, p. 105.
[12] Ibid., p. 107.
[13] Henri Maldiney, L’Art, l’éclair de l’être, Seyssel, Comp’Act, 1993, p. 14.