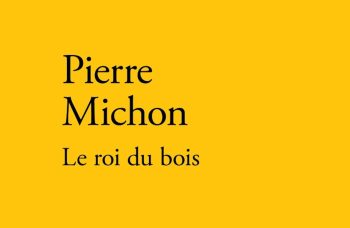Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui publions une contribution de Ghislaine Chabert.
Rencontres du visage de l’Autre à l’écran
Nous allons nous focaliser dans cette partie sur la question de la rencontre du corps de l’autre lorsqu’elle passe par son visage projeté sur un écran. Quelles expériences fait-on d’un visage à l’écran en tant qu’image projetée ? Que se passe-t-il quand ce qui se manifeste à l’écran est un visage ? Un de ces éléments du corps le plus communiquant puisque « toute relation intersubjective passe par le visage[1] » ? Ce ne sont là que quelques questions posées initialement par cette recherche, mais auxquelles il convient préalablement de répondre avant d’approfondir le propos.
Ici le détour par l’analyse des métaphores possibles du visage à l’écran s’avère fort utile. Des recherches préalables faites autour des relations aux écrans, notamment aux visages photographiques, ont mis en évidence des modes de présence du visage à l’écran et autour des écrans à partir des expériences spectatorielles convoquées.
D’abord, face à l’écran, le visage est surface sur laquelle un œil va naviguer. Le travail de Charif Benhelima dans sa série Polaroids (1998-2012), exposée en 2016 au musée Oscar Niemeyer à Curitiba (Brésil), souligne la disparition du visage derrière la fenêtre polaroïd et joue avec l’immersion empêchée dans l’image et au visage qui échappe à la saisie. S’y trouve un écrasement du visage sur la vitre du cadre comme possibilité plastique supplémentaire à l’image. Cet effet plastique, presque physique, sensoriel, y prédomine : aplatissement, écrasement de l’espace qui comprime les visages et les déforme. L’image-surface ne hiérarchise plus ses parties comme si elle était une fenêtre. La présence s’y trouve incorporée aux déambulations du regard sur l’interface, comme s’il y avait un excès de présence du visage en tant qu’image-surface, un retour d’un certain expressionnisme du matériau, de la forme et de la machinerie qui se cache « derrière l’écran ».
À l’écran, le visage s’hybride à un miroir. Il peut y être déformé, se contorsionner quelquefois à l’intérieur du cadre, comme le montre, pour le corps, la célèbre série Distorsions du photographe André Kertész (1933) qui évoque le dédoublement, mais aussi l’imaginaire, l’irréalité de la représentation du double et les contorsions du corps apparaissant à l’écran. Signes d’une gestualité numérique que motive l’apparition du visage à l’écran, qu’on retrouve dans les contraintes de mise en visibilité du visage dans la communication à distance généralisée aujourd’hui. Gestualité numérique plus globalement évoquée par l’acte performatif du corps à l’œuvre dans The Golden Calf de Jeffrey Shaw (1994), œuvre avant-gardiste et anticipatrice de la réalité virtuelle que l’on expérimente aujourd’hui et qui invite le visiteur, équipé d’une tablette numérique, à se tordre afin de voir, en réalité augmentée, le veau d’or sur un socle, laissé vide dans l’espace d’exposition. Jeffrey Shaw disant lui-même :
« Tous mes travaux sont un discours avec la possibilité d’empiéter les bords du cadre cinématographique, pour permettre à l’image d’aller physiquement vers le spectateur, ou bien permettre au spectateur d’entrer virtuellement dans l’image[2] ».
À travers le visage-paysage[3], je peux voir, à travers une texture transparente en profondeur – une fenêtre – un autre espace. J’adopte un point de vue traversant et en mouvement, situé dans l’allée et venue entre plusieurs espaces, sur une certaine « visagéité » du sujet, parfois objet, représenté à la surface (Deleuze et Guattari, 1980).
Sur l’écran-peau, visage-peau, je saisis la peau de l’écran, un entre-deux du dispositif que j’expérimente par la perception du toucher, par la déambulation entre différents espaces que me propose le jeu d’échelles de l’image entre le premier plan et l’arrière-plan, entre surface et profondeur comme l’illustre parfaitement l’image du célèbre film Persona d’Ingmar Bergman (1966), où l’on voit un jeune garçon toucher de ses mains l’écran de cinéma sur lequel se trouve projeté en gros plan le visage de sa mère. Peu à peu apparaît de plus en plus l’idée de l’écran comme d’un corps, comme d’un visage… Et du visage comme dispositif social, pris selon la définition proposée par Giorgio Agamben (2007), comme un composé d’éléments (de paroles, gestes, comportements, énoncés) produits par les acteurs sociaux qui le composent dans un contexte donné :
« J’appelle dispositif tout ce qui d’une manière ou d’une autre a une capacité d’orienter, de déterminer, modeler, intercepter, contrôler, assurer des gestes, les conduites, les opinions, les discours des êtres vivants[4] ».
Nous faisons l’hypothèse de la rencontre du corps à travers le visage à l’écran comme celle d’une nouvelle rencontre, une forme spécifique de communication interpersonnelle liée au numérique, qui passe par « une expérience intérieure et extérieure, intime et sociale, sociétale et politique[5] » ; qui se déroule entre les écrans. Je ne suis plus devant mais entre[6]. L’idée d’un « entre » les phénomènes perceptifs est particulièrement bien expliquée par le philosophe François Jullien dans son analyse de la pensée chinoise à propos du paysage, ou encore par l’artiste chercheuse, Carole Brandon, dans l’analyse qu’elle propose des « entre-espaces » corps-machine à partir du Ma japonais[7]. Une pensée non occidentale pour les deux auteur.ice.s qui semble bénéfique aux connaissances phénoménologiques de la communication humaine (il convient de le préciser aujourd’hui alors qu’explosent les travaux menés autour de l’intelligence artificielle).
De plus, cette rencontre du visage de l’autre à l’écran s’agrémente de plusieurs gestes numériques associés à cet usage (selfies, portraits visiophoniques, snaps, doubles virtuels dont les visages sont avatarisés, vignettes profils (avec ou sans filtres) des réseaux sociaux numériques, photographies en fond d’écran sur smartphone, etc.). Les gestes, pris ici au sens de rituels, d’habitus selon Bourdieu, sont de connivence avec les rites d’interaction déjà bien connus de la communication interpersonnelle (Goffman, 1974) et pour autant réinventent des formes d’entrée en interaction par les visages qu’il convient de documenter et de comprendre à l’ère de nos relations socio-digitales. Dessein que nous développerons plus loin dans l’article, car, au préalable, il nous semble prioritaire d’étudier en quoi l’image qui est celle d’un visage à l’écran est si particulière ? Pour y répondre, nous reprendrons les caractéristiques du visage-écran, largement dépeintes dans la littérature des arts visuels et médias audiovisuels (peinture, bande dessinée, cinéma, photographie, télévision), tout en observant leur adaptation au contexte digital lorsqu’une partie du corps propre de l’autre est projetée à l’écran. Enfin, par la suite, nous discuterons l’hypothèse d’une visagéité de l’écran (au sens deleuzien du terme) en identifiant les situations communicationnelles où l’écran est susceptible de se comporter comme « autre », où le corps de l’écran surgit comme « visage » pour le spectateur, alors conquis par ces formes d’altérités en double-face.
Le « visage-écran »
Pour Jacques Aumont, « si un visage est un écran, une surface, il n’y a rien derrière et ce qui s’y inscrit lui reste étranger – peut aussi bien s’inscrire sur un autre visage (où les visages peuvent s’ajouter, se superposer, s’accoler comme des surfaces in-différentes) ». En même temps, « il est le lieu du regard, lieu d’où l’on voit et d’où l’on est vu à la fois, et pour cette raison lieu privilégié de fonctions sociales – communicatives, intersubjectives, expressives, langagières[8] ». Le visage peut donc lui-même être interprété comme un écran. Il y a bien avec le visage une expérience communicationnelle très forte, ancrée dans l’héritage du regard et enracinée dans la représentation du visage-portrait pictural, comme lieu d’observation de la communication inter-individuelle. Mais tentons de comprendre à présent dans certaines séquences d’images de visages, la nature de l’expérience alors proposée par le(s) visage(s).
L’expérience du double et du miroir
L’expérience d’un visage à l’écran prend sans doute naissance dans cette curieuse situation communicationnelle qui se base sur l’analogie de l’expérience du double ou du miroir : « entre soi et le miroir, il faut que l’espace de l’Autre permette la distance et introduise le lien social, la possibilité précisément de percevoir le visage de cet autre en tant qu’Autre et de ne pas y reconnaître le sien[9] ». Une expérience primordiale, celle du double, dont les mythes sont tous fondés sur le miroir ou l’ombre. Le mythe de Narcisse[10] est le symbole de l’impossibilité d’être sans l’Autre et en même temps de perte par la fascination et l’attractivité du double : « Quant au miroir, il est l’instrument d’une universelle magie qui change les choses en spectacle, les spectacles en choses, moi en autrui et autrui en moi[11] ». Notons que, dans la même veine, un des gestes écraniques contemporains, devenu aujourd’hui assez commun, consiste à détourner l’usage de l’écran de son smartphone pour l’utiliser comme un miroir, non pas au sens symbolique, mais comme surface réfléchissante dans laquelle se voir, se regarder, se recoiffer, etc. On observe couramment cette pratique autour de nous.
…Miroir noir, parabole de l’écran – pour reprendre le nom traduit en français d’une célèbre série américaine -, que « vous trouvez contre tous les murs, dans tous les bureaux, au creux de toutes les mains : l’écran froid et brillant d’une télévision, d’un ordinateur ou d’un smartphone ». Charlie Brooker, inventeur de la série Black Mirror, en 2011, propose une vision réflexive et critique vis-à-vis des nouvelles technologies et de l’emprise qu’elles peuvent jouer sur les vies des téléspectateurs que le concepteur confronte à ses propres contradictions. La première étant d’assister devant l’écran de la plateforme audiovisuelle à la mise en scène de sa propre addiction à l’écran. Tout y est masque, sur-théâtralisé, et tout y fait écran. En effet, le fait de vivre par(mi) les écrans[12] nous enveloppe et nous structure. Il est temps que l’écran, voire le visage, devienne également enjeu politique, tel que le sous-tend la série Black Mirror.
Cette expérience communicationnelle et charnelle engendre un trouble, car le visage est du corps propre la seule partie que je ne vois jamais, sinon au miroir. Je ne vois jamais en effet mon visage autrement que dans un miroir ou un écran qui en déforme la réalité.

Car, celui-ci en donne une vision fausse, différente de celle des autres sur moi. Une similitude qu’on retrouve avec le visage à l’écran, lorsque le corps que je rencontre à l’écran est parfois le mien, où je me vois en train de communiquer – par exemple avec le selfie, la visio, la réalité virtuelle aujourd’hui – mais où se projette alors une vision très différente de celle du miroir (image 1). Cette expérience très troublante est celle que l’on retrouve avec le dispositif technologique immersif, The machine to be another[13], expérimenté en 2016 à l’occasion du GIFF de Genève (Geneva International Film Festival), qui découle des recherches menées sur l’empathie par les concepteurs. En réalité virtuelle, le dispositif s’expérimente à deux. Il est également couplé aux interventions de comédiens qui interagissent physiquement avec les spectateurs durant l’expérience. Dans une première phase, il permet ainsi de voir l’environnement, de se synchroniser et de toucher ce qui nous entoure comme si l’on était immergé dans le corps de l’autre expérimentateur, en se voyant dans le corps de l’autre bougeant et effectuant les mêmes gestes qu’elle ou lui. Puis dans un second temps, plutôt situé en fin de parcours et grâce à l’intervention des comédiens sur les éléments de décor (un miroir est inséré), le système de co-immersion permet cette étrange expérience qui consiste à se saluer et faire la rencontre de soi-même, comme si l’on était l’autre. Expérience de sortie du corps propre qui ne laisse pas indifférent, qu’on se remémore longtemps après, et que reproduisent assez souvent les dispositifs de réalité virtuelle et immersifs.
De cette surface pixellisée de l’écran, reste finalement de mon corps une reproduction d’un double dans une fenêtre ou une trace d’une présence inversée…
L’expérience d’une surface « haptique » émotionnelle
Le visage-écran est une surface émotionnelle dans le sens où l’écran, notamment celui du cinéma, par un procédé de cinématographisation, est une formidable machine à grossir et à amplifier[14]. Gilles Deleuze, dans L’image-mouvement[15], à partir de son analyse du cinéma muet, désigne deux pôles de la présence du visage : le visage réflexif et le visage intensif (au sens de la puissance, pas forcément de la qualité). De plus, il trouve d’emblée la formule pour le signifier : « une image-affection c’est le gros plan et le gros plan c’est le visage[16] ». Le visage-écran est une surface haptique par le gros plan, qui implique des modes de conversation et d’interaction inédits à travers les images interfacées. Il affiche une proximité à l’autre à travers une proximité perceptive et psychique (impression de voir l’émotion) et une proxémie numérique nouvelle, bousculée, qui produit, par exemple, les très gros plans impossibles à trouver dans la réalité (Close-up, chez Alfred Hitchcock, ou dans Faces chez Nick Cassavetes, 1968). Nous vibrons, par effet de réverbération émotionnelle, avec les visages représentés, au cœur même de ces visages et le cinéma est cette vibration. Le cinéma ne nous montre donc finalement que nous-mêmes ou, pour reprendre une très belle citation de Marcel Proust à propos de la littérature, où « en réalité chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même[17] ». Le visage en gros plan serait donc une présence du visage dans le film qui resterait indéfiniment dans l’émotif, l’affectif :
« Garbo appartient encore à ce moment du cinéma où la saisie du visage humain jetait les foules dans le plus grand trouble, où l’on se perdait littéralement dans une image humaine comme un philtre, où le visage constituait une sorte d’état absolu de la chair, que l’on ne pouvait atteindre, ni abandonner[18] ».
Le visage-écran favorise un mimétisme affectif (avec intersubjectivité des émotions) à travers les écrans[19] et peut exprimer plusieurs sentiments à la fois. Le visage ? « Une scène, dans la mesure où se lisent sur ses traits, les traits qui signent l’émotion[20] ». Précisons que l’émotion est ici étudiée en tant que phénomène social et pas du tout en tant que comportement décryptable, « botanique » et dictionnarisé comme certains, dans le prolongement des travaux de Darwin, aimeraient volontiers le laisser croire (Le Brun[21], pour la peinture, ou plus récemment Paul Ekman[22], en psychologie). Il prend la forme, chez ces derniers, de figures susceptibles de façonner le visage. Or, on ne peut comprendre les émotions humaines que « dans une situation donnée et dans l’immersion dans un monde ». L’émotion étant bien un phénomène lié à l’interaction sociale, qui ne peut être ressentie et déchiffrée en dehors de tout un contexte qui l’encadre.
L’expérience d’un visage-imprégnation
Le visage-écran a une nature profondément communicationnelle. S’il existe une visagéité des images de cinéma pour Jacques Aumont, il y a toute une visagéologie pour François Soulages, pour qui il y a toujours deux visages : celui de l’homme singulier dans sa contingence et son visage « survu », surpris par sa qualité rabaissante qui, paradoxalement, impose sa grandeur et sa singularité[23]. Le visage se comporte parfois comme une surface sur laquelle vient s’imprimer quelque chose, parfois la parole d’un autre. Il confère une aura à l’interlocuteur dont l’image est projetée à l’écran, au sens où l’entend Walter Benjamin à propos de la surface auratique et imprégnante[24] de la photographie. Proche de la Stimmung en allemand, d’après Aumont :
« ni humeur, ni atmosphère, ni harmonie… : un rayonnement invisible, auratique, éthéré qui contamine les objets voisins et s’établit de proche en proche sur tout l’espace. La Stimmung est contagieuse[25] ».
Ainsi se « crée un monde à côté du monde visible, du côté de l’écran[26] » qui rejoint les mondes de la magie, des arcanes, de l’initiation, recomposition presque magique d’un espace de vie. Ou, pour reprendre Alain Mons, l’essentiel est dans le moment d’apparition des choses, car avec « le battement des apparitions et disparitions du visible, c’est l’existence même qui fait l’épreuve d’une réalité qui lui échappe[27] ». Ainsi en est-il par exemple des phénomènes d’apparitions à l’écran. Dans ce cas, l’image de l’autre, en apparaissant et disparaissant de façon impromptue, peut sembler totalement irréelle, mais paradoxalement lui donner une place sacralisée par la présence et l’apparition du visage sur l’interface, une sorte d’« aura » particulière[28], cela d’autant plus dans des situations de déplacement, de mobilités, où ces images sont totalement inattendues. C’est d’ailleurs sur ce principe de l’éphémère et du visage comme trace de la présence que fonctionnent quelques extensions issues des médias sociaux, telles que Snapchat par exemple. Toute une économie de la visibilité émerge de ces formes d’expression de soi éditées par les utilisateurs eux-mêmes, contraintes par une production dans un temps de plus en plus court, éditorialisées et plateformisées. L’écran se fait alors le réceptacle de visages, figures et formes privilégiées de l’intersubjectivité. Ainsi, par le visage photographié, montré, envoyé et partagé, il y a une force inédite d’ancrage à l’autre, une interaction et une rencontre, favorisées à l’aune de ces « images conversationnelles[29] » (Gunthert). Le mimétisme affectif déjà souligné précédemment, qui passe ici par une communication autour du visage, souligne l’interférence des affects avec ceux d’autrui et la dimension intersubjective des émotions qui ne se jouent pas simplement dans un face-à-face entre l’individu et le monde, mais aussi entreles individus autour des écrans. Parfois certains « accidents » visuels[30], liés à la surface numérique, peuvent se produire et « dé » -visager alors la représentation de la personne, laissant parfois paraître une forme de « monstrueux » cachée derrière le visage ou d’« extraordinaire » révélé dans la plasticité. Ces phénomènes, générés souvent par des bugs et glitchs, tout en redéfinissant en même temps méthodes et « manières de faire[31] » des recherches visuelles et multimodales, incitent de plus en plus au prélèvement de données issues directement des espaces digitaux et sont favorables ainsi à la photographie instantanée des écrans et des phénomènes d’apparition furtive des visages, d’ontophanie (Vial[32]) à travers les écrans. Le sentiment de rencontre est ici favorisé par le flux des images et le caractère vivant de leur animation à l’écran, leur mobilité, perceptible dans autant de petits gifs animés d’instants vécus sur smartphone (mode « live » des applications photos disponibles sur smartphone). Ces instants médias, live media, captés dans l’animation de l’image numérique et de la vie écranique, révèlent un visage écran pris dans toute une esthétique de la relation, de l’instantanéité et du parcours qui se fait dans le flux numérique et dans cet « entre » des espaces que nous évoquions plus haut. Ainsi en est-il des situations visiophoniques où, par ce phénomène de balayage du regard, de « déconcentration, dé-fixation du regard », le visage se fait paysage. Car, pour qu’il y ait paysage, il faut que le regard (flottant) se mette à circuler sur l’interface[33], trait et trace d’un parcours qui marque fortement les dispositifs écran de la communication à distance.
Cependant, le visage n’est pas un lieu comme les autres dans la géographie du corps. David Le Breton, en effet, le considère comme un lieu[34] et, dès 2003, affirme cette imprégnation de l’autre par son visage : « le visage est le lieu de l’autre, il prend naissance au cœur du lien social (…). Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, ce que nous ressentons profondément les uns pour les autres, que nous le voulions ou non, réapparaît dans nos portraits[35] ». Tel le visage résonnant dans la foule du magnifique Metropolis(1927) de Fritz Lang, ou le travail vidéo Versions d’elle de l’artiste Catherine Gfeller, de 2006[36], qui révèlent tous deux la perception de l’espace public à travers une intériorité du visage et son échoïsation sur tout le social, où chaque être s’y retrouve émotionnellement. Le visage investit donc tous les espaces possibles du dispositif numérique et s’étend au-delà même de l’écran, sortant du visage-écran. Il s’agit ici d’un visage étendu, éclaté, augmenté autour de l’écran.
Plusieurs dispositifs et expériences numériques, de même, sortent le visage de l’écran, comme dans le dispositif filmique App the movie (image 2). Dans ce film de type second screen[37], le visage entre en résonance avec tout l’espace de projection, le visage en contrechamp investit le hors-champ, hors-cadre du film (la salle de cinéma) pour ré-apparaître par magie sous une autre forme sur les écrans des smartphones des spectateurs connectés. Il incite à voir à travers leur écran comme dans un miroir dans lequel se projettent les visages des acteurs en train de regarder leur mobile et de faire usage de leur écran.

L’émotion y est produite par la navigation entre les différentes formes de présence de l’autre révélées par le dispositif. Le montage, le sens est alors dans le flux, dans le mouvement des visages. L’effet produit par le montage des images, et bien connu de Koulechov (1922), se produit ici par la lecture du visage intercalé entre les séquences d’espaces (grand écran, écran du smartphone, salle), il devient une expérience de visages multiples, à double sens et issue d’un parcours entre de multiples écrans.
L’écran-visage
Dans son rapport à l’écran, se produit un tout autre phénomène sur le visage sur lequel il convient de s’arrêter quelques instants. Pour le comprendre, il est utile d’aborder ce qu’on nomme en nouveauté « l’écran-visage », symétriquement au « visage-écran ».
Un visage qui disparaît derrière l’écran
On peut naturellement expliquer dans un premier temps le concept d’écran-visage par l’observation des expériences communicationnelles où le visage se glisse et se camoufle derrière l’écran qui, alors, montre toute sa puissance étymologique originelle de paravent et de voile faisant écran.
Avec l’idée de l’écran-visage, en effet, on ne signifie plus l’inscription du visage sur l’écran, mais l’inverse, c’est-à-dire les gestes de la vie contemporaine où il y a inscription d’un écran sur le visage, cela passant par l’appareillage de dispositifs machiniques : port de lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle (image) – robots de téléprésence ou encore projections directes sur le visage[38]… Mais aussi par des situations qui incitent à cacher une partie du visage derrière un masque, comme c’était le cas lors de la pandémie COVID19, par exemple. Dans ces situations, c’est le visage qui, finalement, disparaît derrière un écran, qui le défigure par ces nouveaux masques et nouveaux rituels de communication.
Le visage s’habille parfois et se comporte symboliquement comme un écran pour masquer et cacher un sentiment, une gêne, un usage qui se cherche. Ou pour dévoiler une émotion collective. Ce phénomène social a été joliment décrypté par Roland Barthes à propos d’une technique (du corps) qui consiste à « cacher pour que cela se voie ». Dans ses Fragments d’un discours amoureux, le sémiologue explique en effet « le paradoxe des lunettes noires » que l’on met pour cacher quelque chose, par exemple qu’on pleure, alors qu’on veut paradoxalement que les autres voient et remarquent cet état émotionnel :
« Il faut que cacher se voie, que l’on sache que je ne veux pas le montrer (…) Imaginons que j’ai pleuré, par la faute de quelque incident dont l’autre ne s’est même pas rendu compte (pleurer fait partie de l’activité normale du corps amoureux), et que, pour que ça ne se voie pas, je mette des lunettes noires sur mes yeux embués (bel exemple de dénégation : s’assombrir la vue pour ne pas être vu). L’intention de ce geste est calculée : je veux garder le bénéfice moral du stoïcisme de la « dignité » (et, en même temps, contradictoirement, provoquer la question tendre (« Mais qu’as-tu ? ») ; Ce faisant, je joue, je risque car il est toujours possible que l’autre ne s’interroge nullement sur ces lunettes inusitées et que, dans le fait, il ne voie aucun signe[39] ».
Enfin, il convient d’insister sur le visage dans ses figurations sociales et sur une mobilité de l’écran-visage, rôle important du visage qui porte l’écran au regard pour filmer, cadrer, représenter, cacher, comme forme de nouvelles chorégraphies sociales, résonances des corps dans le social[40]. Cette altérité passant par les visages est fortement marquée dans les écrits de chercheurs socio-anthropologues : « le visage est la partie émergée d’autrui[41] », derrière le visage il y a « une multitude de virtualités qui m’échappent[42] » et me ressemblent en même temps. L’écran révèle au sujet le sujet d’en face, à savoir lui et pas lui[43]. Le point commun à tous est qu’il y a bien attachement à l’autre, et peut-être paradoxalement à l’écran qui m’attache aussi dans ce courant alternatif, de double-face. Double face car elle conjugue en même temps relation et émotion tel que l’entend le philosophe Pierre Kaufmann[44].
Le concept d’écran-visage, on l’entend donc ainsi d’une tout autre manière dans ce texte. Non pas comme écran sur le visage, mais comme écran devenant visage par la relation qu’il instaure. Pour le comprendre reprenons d’abord ce concept de « visagéité » avancé pour la première fois par Gilles Deleuze dans un de ses cours[45] de l’année 1982, repris par la suite dans Mille Plateaux. Pour le philosophe, la visagéité s’envisage aussi à propos des objets, peut être également un trait caractéristique des objets et n’est pas strictement réservée aux seuls êtres humains. Ainsi par son intensité, ses micro-mouvements sur une surface, tout gros plan, même celui d’un objet, est un visage. L’enjeu est alors bien l’observation d’une altérité en double-face, celle de l’émotion telle qu’elle trouve sa place dans la relation aux visages, aux autres et aux espaces dans un seul et même mouvement numérique, et enfin du visage tel un espace de communication où « tout sujet est face au sujet d’en face, où l’écran est alors vécu comme une personne, car l’écran frontière est oublié au profit de l’écran donateur de l’être, de l’être aimé, bien évidemment. Le sujet /comme Narcisse/ est amoureux de l’écran[46] ».
Or, c’est par l’effet d’une invention de relations que la forme devient elle-même « visage » comme le suggérait à son tour Serge Daney un peu plus tard[47]. Piste de recherche sur la réversibilité, subrepticement effleurée par Anne Cauquelin à propos du rapport au « jardin si parfait », souvenir d’un rêve de sa mère, comme le fit en son temps Roland Barthes à propos de l’essence de la photographie et du fameux « ça a été » révélé dans La chambre claire (1980) en découvrant une photographie datée de sa mère jeune dans un jardin :
« C’était une lumière dorée, elle éclairait la villa, venant de l’ouest (elle était mêlée de vert, couleur marine s’il en est) et dans sa manière oblique d’allonger les ombres à peine, elle rendait toutes choses fragiles comme un dernier soir d’été ou le dernier été (…) La maison dont les fenêtres étaient entrouvertes, se dépêchait de jouir de cet éclat jaune avant d’entrer dans le sombre octobre ou dans la nuit, quand, inversant les rôles, ce serait elle, la maison, qui projetterait la lumière du salon sur la pelouse, lumière tout aussi mélancolique que celle de l’ouest mais plus orange et aussi plus maîtrisable : il suffisait d’allumer les deux candélabres ou de laisser filtrer par le biais de la porte-fenêtre du couloir le reflet de la suspension[48] ».
Comme la maison, l’écran, en projetant la lumière, sait aussi parfois inverser les rôles et imprégner par sa lumière les visages qui le regardent.
Visages « face à face », l’expérience d’une subjectivité à « double face »
Cette lecture du visage dans le flux des relations c’est ce qu’on cherche à faire en observant des visages qui regardent des visages, l’altérité dans les moments où le visage est face à une autre face, à un autre visage dans une situation de communication, que cette dernière soit conversationnelle ou non. Elle peut être en effet contemplative. Mais selon Deleuze et Guattari : « le visage construit le mur dont le signifiant a besoin pour rebondir… Le visage creuse le trou dont la subjectivisation a besoin pour percer…[49] », par conséquent il y a bien « une éthique renversée du visage[50] » à prendre en compte autour de l’écran :
« Actuellement le désir exprimé d’avoir un écran “derrière” et devant le “prétendu” spectateur a été exaucé littéralement et exponentiellement. Les écrans, aujourd’hui, non seulement nous regardent et nous projettent par derrière alors que nous regardons l’image des autres devant nous, mais ils le font aussi par le côté et du dessus. »[51]
Il suffit pour s’en convaincre de voir reprise à son compte cette idée dans la publicité d’une marque informatique célèbre[52], où l’on voit des visages d’utilisateurs « derrière leur écran » comme c’est le cas dans de nombreuses situations sociales d’aujourd’hui. On a remarqué que les émotions des « faces[53] » devant l’écran devenaient un sujet de conversation, d’échanges, un contenu informationnel, comme si l’écran lui-même devenait bavard, un visage « conversationnel » comme suggéré par certains (Gunthert[54]). Beaucoup de travaux et d’œuvres d’artistes ont été précurseurs à ce sujet et évoquent ce régime médiatique de réverbération des visages. Nous pensons à deux œuvres notamment : celle de Bill Viola, Reverse television (1983-84), qui montre l’envers de la réception télévisée et la projette par réflexivité sur le petit écran ; ou plus récemment celle de Robbie Cooper, Immersions (2013), qui affiche les multiples figures et expressions d’enfants capturées alors qu’ils sont en train de jouer à des jeux vidéo de combat. Finalement quand on parle de visage on évoque toujours la situation d’un face-à-face, d’un individu en situation d’en voir un autre qui parfois peut aussi être lui-même. C’est donc cette question de la réversibilité de l’écran et de faces devant des faces, à savoir de « double-face » qu’il semble devoir traiter à propos des visages et de l’écran.
Arrêtons-nous quelques instants pour le comprendre sur le geste du selfie que les jeunes adolescentes et adolescents pratiquent massivement autour de leurs différents « snaps [55] ». Depuis l’expérience du photomaton, ce geste autour du selfie se définit comme un autoportrait avec smartphone qui a vocation à un usage fondamentalement collectif se prêtant au(x) jeu(x) des multiples palettes des réseaux ou médias socio-numériques (filtres, masques, trucages…). Cette captation reverse photo à bout de bras, comme on tenait autrefois un miroir pour « s’autographier », qualifie l’importance des gestes liés au visage autour de l’écran dans nos pratiques et sociabilités contemporaines. Les lèvres qui touchent l’écran, un décor qui bouge, de nouvelles proxémies, des icônes de langage, des trucages d’images, des mouvements rapides entre les écrans pulsionnels, racontant la vie quotidienne et banale des utilisateurs se trouvent révélées à travers ces conduites et ces doubles peaux numériques. C’est ainsi tout le « méta-écran » qui rejaillit à travers ces comportements de « faces » (pris ici au sens goffmanien du terme). Ce geste très fortement identitaire et sociologique qu’analyse Elsa Godart dans son étude sur les métamorphoses des identités dans le numérique[56], qui permet à ses utilisateurs d’expérimenter un nouveau rapport à soi, mais aussi « de saisir ce qui surgit entre nous et les autres, (…) un moi qui devient autre » selon l’expression consacrée par François Laplantine[57]. Par exemple, ce lieu et ce moment précis où le moi m’échappe pour devenir un autre par son visage, et ainsi s’ajouter aux autres faces du groupe. Parfois c’est tout le visage du groupe qui rejaillit sur l’écran auquel cas le réseau devient lui-même visage, nouveau portrait social et paysage des relations qu’il enferme. Ce visage-réseau si fréquemment présent aux fenêtres digitales des mêmes ados :


Le visage est privilégié dans cette lecture de la culture numérique des ados. En pratique, les gestes qui y sont associés consistent à retoucher son visage, à filtrer, à animer le décor et les images. Ils mettent en scène l’identité et le visage au sein d’un espace public traversé par le digital et célèbrent ainsi de nouvelles cérémonies, par de nouveaux « habits[58] ». D’après certains, plus une société accorde d’importance à son individualité, plus grandit la valeur du visage[59], symptôme d’une société en quête d’identité en quelque sorte. Cependant, sous le règne de cette individualisation et instrumentalisation des visages, nous pensons qu’ils cherchent à dire l’adhésion à un élan commun, à un imaginaire partagé avec leurs pairs et tout simplement à faire société. Et que cette parole implique une esthétique de la relation qui passe par notre compréhension d’un corps de l’écran et d’un écran-visage.
[1] Emmanuel Levinas cité par Nicolas Bourriaud, L’esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 1998, p. 21
[2] Jeffrey Shaw cité in M.B.N Hansen, New Philosophy for new media Cambridge, MIT Press, 2006, p. 46.
[3] D’après la comparaison possible d’un visage à un paysage ou d’un paysage à un visage, proposée par Daniel Bougnoux, à propos de l’analyse du texte de François Jullien, Vivre de paysage ou l’impensé de la raison, 2014, in « Le paysage, de l’objet au milieu », Colloque Paysages, Chambéry, 2018.
[4] Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Rivages, 2007, p. 31.
[5] François Soulages, « Le sujet d’en face », in François Soulages, Sandrine Le Corre dir., Les frontières des écrans, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 10.
[6] François Jullien, Vivre de paysage, l’impensé de la raison, Paris, Gallimard, 2014, p. 41.
[7] Carole Brandon, « Entre le rouleau et la carte, l’espace flottant des œuvres hypermédias », Colloque international Habitabilité des mondes cartographiques, Paris 8, 11-13, décembre 2017.
[8] Jacques Aumont, Du visage au cinéma, Collection Essais, Paris, Ed de l’étoile, Cahiers du Cinéma, 1992, p. 11.
[9] David Le Breton, Des Visages, essai d’anthropologie, Paris, Métailié, 2003 (1992), p. 125.
[10] À l’emplacement du cadavre naît une fleur redoutable : le narcisse.
[11] Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964.
[12] En référence au titre de l’ouvrage dirigé par Mauro Carbone, Anna Caterina Dalmasso, Jacopo Bodini, Vivre par(mi) les écrans, Paris, Les Presses du Réel, coll Perceptions, 2016.
[13] https://beanotherlab.org/home/work/tmtba/
[14] Jacques Aumont, Du visage au cinéma, Collection Essais, Paris, Ed de l’étoile, Cahiers du Cinéma, 1992, p. 91.
[15] Gilles Deleuze, L’image-mouvement. Cinéma 1, Paris, Minuit, 1983.
[16] Gilles Deleuze, Cours n°8B, 26/01/1982, consulté en ligne le 6 mai 2025,
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=139
[17] Cf. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, T.3, Paris, Gallimard, 1956.
[18] Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p 70.
[19] Ondrej Svec, Phénoménologie des émotions, Philosophie Contemporaine, Septentrion Presses Universitaires, 2013, p. 14.
[20] David Le Breton, op.cit., 2003, p. 106.
[21] En référence aux 23 figures susceptibles de façonner le visage de l’homme (ex la colère, la jalousie…) peintes par Le Brun, alors au service de Louis XIV. Le Brun fait une anatomie des passions et dresse une « botanique des émotions » (selon Le Breton) surtout exprimée par le visage. Les émotions y sont dépeintes hors de tout contexte social, politique ou culturel…
[22] Paul Ekman, Le visage décrypté, Arte Production, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=iqnGv3Z6UlA
[23] Cf. François Soulages, op. cit.
[24] Voir Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie (1931), Paris, Payot, 2019, p. 39.
[25] Jacques Aumont, op.cit., p. 94.
[26] Simmel cité par Michel Moatti, « Nouveaux habits pour vieilles cérémonies », Médiamorphoses, n° 19, 2007, p. 92-99.
[27] Alain Mons, « Reflets dans les espaces et extériorité intérieure, une ontologie vacillante », in François Soulages, op.cit., 2015, p. 61.
[28] Stéphane Vial, L’être et l’écran, comment le numérique change la perception, Paris, PUF, 2013.
[29] André Gunthert , « L’image conversationnelle. Les nouveaux usages de la photographie numérique », in Etudes photographiques, n° 31, printemps 2014, p. 54-71.
[30] Au sens où l’entend Sarah Pink, « unanticipated uses of the visual may be discovered by accident and retrospectively defined as visual methods »,Doing visual ethnography, Image, Media and representation in research, Sage, 2007, 1ère ed 2001, p. 41. [TRAD] des usages non anticipés du visuel, découverts par accident, peuvent rétrospectivement être définis comme méthodes visuelles.
[31] En référence aux « manières de faire » évoquées par Michel De Certeau, L’invention du quotidien, arts de faire, T.1, Paris, Gallimard, 1980.
[32] StéphaneVial, op. cit.
[33] François Jullien, op.cit., p. 31.
[34] David Le Breton, Nadine Pomarède, Georges Vigarello, Bernard Andrieu, Gilles Boëtsch dir., Corps en formes, Paris, CNRS Éditions, 2013.
[35] David Le Breton, op.cit., 2003, p. 11 et p. 44.
[36] Chez Catherine GFeller, la peau des corps se croise dans une réverbération réciproque avec les bâtiments, les lieux, les autres passants selon une sorte d’entrelacement sensuel
http://www.catherinegfeller.com/fr/videos/view/80240/versions-d-elle-2006-3-44/?of=6 .
[37] App the movie, first second screen cinema experience, Bobby Boermans, présenté au Festival Tous Écrans à Genève dans la catégorie transmédia, novembre 2013.
[38] Voir le travail de Jeremy Bailey, The future of television, 2012, avec inscription de l’écran de télévision directement sur le visage de l’artiste.
[39] Cf. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.
[40] Ghislaine Chabert, « L’écran au pluriel : l’autre à travers et autour de l’écran connecté du mobile », op. cit.
[41] David Le Breton, op.cit., 2013, p. 173.
[42] Bernard Andrieu in David Le Breton, ibid.
[43] François Soulages, op. cit., p. 11.
[44] Pierre Kaufmann, L’expérience émotionnelle de l’espace, Paris, Persée, 1967.
[45] Gilles Deleuze, Cours n°8B, 26/01/1982, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=139
[46] François Soulages, op. cit.
[47] Cité par Nicolas Bourriaud, op. cit., p. 21.
[48] Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, PUF, 2000 (1989), p.
11
[49] Gilles Deleuze, Félix Guattari, « Visagéité, année zéro », Mille plateaux, Capitalisme et Shizophrénie 2, Paris, Ed de Minuit, 1980, p. 205-234.
[50] Elsa Godart, Je selfie donc je suis, les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel, Albin Michel, 2016.
[51] Vivian Sobchack, « Comprendre les écrans : une méditation in medias res », in Mauro Carbone, op.cit., 2016, p. 29.
[52] « Derrière le mac », signature du spot publicitaire diffusé sur les écrans de télévision français, 2018 où l’on voit, filmés de face, des utilisateurs de la célèbre marque derrière leur écran.
[53] Nous reprenons ici le concept de « face » cher à Erving Goffman (Les rites d’interaction, 1974) en hommage à ses travaux fondamentaux sur la communication inter-individuelle et aussi pour métaphoriser en quelque sorte ce visage expressif tourné vers la communication avec l’autre, même si le sociologue de la culture l’entend beaucoup plus largement et théoriquement comme une conduite générale relevant d’un comportement pris dans une interaction. Face étant pris au sens d’image communiquée et perçue par les autres. Ce qui a par ailleurs été repris ensuite par d’autres chercheurs ou chercheuses de l’approche interactionnelle avec les face-threatening-acts (Brown & Levinson) ou face-flattering-acts (Kerbrat-Orecchioni) ; [TRAD] actes menaçants pour les faces ou actes flatteurs, valorisants pour les faces.
[54] André Gunthert, op. cit.
[55] De l’anglais « snapshot » signifiant « instantané », d’où le snapchat, discussion, conversation sur la base d’images instantanées.
[56] Elsa Godart, op.cit., 2016.
[57] François Laplantine, Quand le moi devient autre, connaître, échanger, transformer, Paris, CNRS Ed, Bibliothèque de l’anthropologie, 2012.
[58] Michel Moatti, op. cit., p. 92-99.
[59] David Le Breton, op. cit., 2013, p. 163.