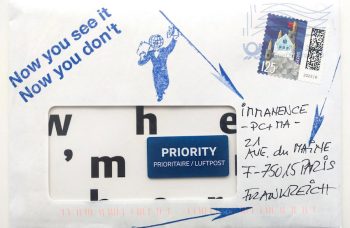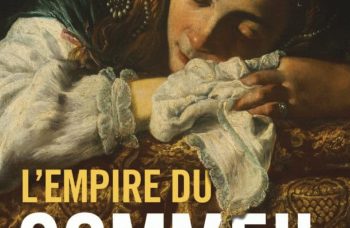Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui, nous publions une contribution de Carole Nosella.
Nos visages ne peuvent aujourd’hui se dérober de la capture des technologies numériques, ils font l’objet d’une collecte incessante et massive pour constituer des bases de données et affiner ainsi toujours plus la reconnaissance faciale par les machines. Ces bases de données, nous les alimentons bien volontiers (mais souvent à notre insu) par le partage régulier d’autoportraits et de portraits, dans une recherche continue de reconnaissance sociale et affective. Les images de visages sont omniprésentes sur nos écrans et il devient difficile de distinguer des images produites par les machines (par ce qu’on appelle intelligence artificielle) des captations de visages de personnes réelles[1], sans compter l’intervention de l’intelligence artificielle pour améliorer dans l’image (selon des critères de beauté standardisés) les traits de visages de ces mêmes personnes. L’IA en vient même à constituer des portraits plus nets, qui semblent plus vivants que les photographies. La netteté du visage semble être l’un des critères majeurs de la performance des IA. Ainsi entre les injonctions à l’identification permanente et la fascination pour cette seule nudité décente selon Emmanuel Levinas, chacun et chacune est sommé à tout moment de se montrer face dévoilée aux capteurs de nos appareils domestiques et nous envoyons les traits de nos visages sur internet, presque indifféremment à nos proches comme à des entreprises de services et autres plateformes professionnelles. Dans ce contexte de survalorisation de la netteté des traits et du visage comme preuve d’identité, il paraît intéressant de s’interroger sur ce que permettent des images de visages flous, à peine visibles, à peine identifiables.
Notre parti pris, pour cet article, est de nous concentrer sur l’appareillage permettant de produire un portrait ou un autoportrait. Si on peut apercevoir des formes de résistance à ce processus de survisibilité du visage, par le masque ou le floutage des traits, nous choisirons ici la voie de la défaillance intervenant dans le processus de fabrication ou de visualisation de l’image de visage. En effet, notre propos consistera à observer les possibilités de produire des portraits dont les traits sont à peine visibles avec des appareils défectueux ou utilisés à contre-emploi. Ces images ouvertes autant que flottantes, on supposera qu’elles peuvent faire ressurgir à travers leur lisibilité altérée, une forme d’aura. Ainsi, à travers la représentation du visage, c’est aussi la poïétique propre aux appareils technologiques que nous évoquerons ici. Plus précisément, nous chercherons à montrer comment l’expérience d’un certain type d’appareillage, un appareillage défaillant, dans la saisie d’un certain sujet, le visage, permet une résurgence d’une forme d’aura, à travers la production d’images infra-minces, fuyantes ou clignotantes dans la temporalité filmique.
Cette démonstration se fera à partir de l’analyse de deux de mes travaux : Lumière et brume (2013-16)[2] et La passante(2016)[3]. Pour chacun de ces travaux, un dispositif technologique particulier a été utilisé, le premier est un smartphone endommagé, et le second est un pico-projecteur, vidéo-projecteur portatif peu puissant. De la manipulation de ces deux appareils, ont émergé plusieurs réalisations dont deux se concentrent particulièrement sur l’apparition d’un visage.
Je décrirai dans un premier temps les deux réalisations dont il sera question, puis je reviendrai sur les notions d’aura et d’infra-mince et tenterai de montrer les apports de ces notions pour envisager la portée émancipatrice de la défaillance technologique.
Lumière et brume : quand l’accident détourne le selfie.
Lumière et Brume (2013-2016) est une vidéo produite avec un appareil défectueux. Il s’agit d’un smartphone dont la vitre, suite à une chute, s’est fendue jusqu’à modifier l’optique de la caméra frontale utilisée pour l’auto-photographie. Dès lors, tenter de prendre un selfie avec cet appareil accidenté ne peut qu’aboutir à une image floue, déformée du visage. L’accident devient alors prétexte à l’exploration de cette nouvelle relation au dispositif d’auto-photographie, comment profiter des propriétés inattendues des images produites par le filtre de cette vitre fendillée ? Le visage, sujet imposé par le dispositif de caméra frontale, devient un obturateur de lumière qui se diffracte autour de lui, de sorte que les traits sont difficilement perceptibles. L’accident détourne ici le dispositif. Selon André Gunthert, l’objet du selfie est « le signalement instantané d’une situation, spécifiquement destiné à un récepteur[4] ». Ce que l’on appelle selfie correspond à une pratique de l’autoportrait photographique visant à être partagé via un réseau de télécommunication, il s’envisage d’emblée comme « image connectée » et permet, selon André Gunthert, de combler « l’effondrement du contexte (…) par une hyper-contextualisation, qui corrige l’indétermination des échanges et devient immédiatement une ressource dialogique[5] ». Il s’agit alors d’une forme d’auto-photographie destinée à être partagée sur un réseau plus ou moins étendu, dans le but de faire le récit à travers des images de ce que Bourdieu définissait comme « l’aventure singulière de celui qui les a prises[6] ».



Le dispositif de caméra frontale rend la production d’un autoportrait plus immédiate, plus simple qu’un appareil photographique classique, et participe à l’explosion de cette pratique de partage ; dans le cas de mon expérience avec un appareil endommagé au niveau de cette caméra frontale, réaliser un autoportrait était non seulement évident, mais était imposé par le dispositif même. Pour profiter des effets produits par les fissures devant l’objectif, et en même temps contrôler la prise de vue, il n’y avait d’autre choix que de produire une image de mon visage, celui-ci devenant obturateur de lumière, une figure à défigurer par le jeu de défaillance de l’appareil confronté à un environnement spécifique.
Ainsi, la rencontre avec un dispositif défectueux permet de produire ce qu’on pourrait appeler l’infra-mince de la visagéité, l’infra-mince étant un concept esthétique de Marcel Duchamp désignant un phénomène quasi imperceptible. La figuration est ici oscillante entre l’ombre, la brume de la diffraction, et le halo d’une forme vague, d’un trait de lumière qui dessine furtivement le contour d’un visage. Ce retournement du selfie en « selflou » permet de créer un écart face à l‘injonction d’apparaître visage dévoilé, net, lisible. Ici la défaillance technique devient un processus de résistance face aux phénomènes de sur-visibilité qui s’associent aux dynamiques de contrôle par identification.
L’usage d’un smartphone cassé pour produire un autoportrait rompt avec le bon déroulement du dispositif du selfie, dont l’image n’est que l’un des éléments qui le constitue et permet d’introduire un temps d’arrêt, et de possible déviation. On reprend conscience de la relation à l’appareil qui disparaît habituellement dans l’usage. Ici, par le flou, l’image semble plus épaisse car opaque, ce surgissement d’un mystère dans l’image fait écho à cette épaisseur de la relation à l’appareil qui est permise par la défaillance.
Si les images créées n’étaient pas à proprement parler des selfies, puisqu’à aucun moment elles n’ont été pensées pour être partagées et restituer un contexte d’une quelconque aventure, Lumière et brume constitue une réflexion sur la capture d’une mobilité, celle des corps en transit, marchant dans la rue ou transportés par le train, le métro, ou bien une voiture. La plupart des photographies ont été réalisées dans un de ces transports : en effet, la variation lumineuse qu’engendre le déplacement rendait plus propice la production d’un selfie flou, tout en faisant écho à cet « effondrement du contexte » dont parle Gunthert, produit notamment par l’hypermobilité contemporaine. En usant de la technique du split screen, j’ai voulu créer un espace-temps indéfini dans lequel une présence humaine représentée par ces images de visages semble ballottée dans des flux de lumière, prise dans des mouvements qui la rendent impossible à se faire saisir[7].
Ainsi cette réalisation peut être pensée comme un contre-selfie si l’on s’appuie sur la définition du selfie d’André Gunthert. À la saisie instantanée marquant la présence d’une personne par l’identification de ses traits à un instant T et un espace précis se substitue une multitude d’images floues dans un contexte inidentifiable puisque résultant d’un montage.
La Diffusion d’un visage dans l’espace public
La passante (2016) donne à voir l’image d’une jeune fille projetée en mouvement dans les rues de Paris. Sur le bitume son visage apparaît et disparaît au gré des variations lumineuses, phares de voitures, éclairages commerciaux et routiers[8]. Dans cette réalisation, c’est le processus d’apparition de l’image qui rend propice sa disparition. En effet, le pico-projecteur utilisé pour produire cette réalisation possède une très faible capacité lumineuse : environ 100 lumens, quand un vidéoprojecteur de salon en compte plusieurs milliers. Ce type de projecteur de petite taille et fonctionnant sur batterie est intéressant pour sa mobilité et sa maniabilité, mais son efficacité est drastiquement réduite, d’autant plus dans un contexte urbain et donc très lumineux. Ainsi la projection trop faible par rapport à l’environnement rend cette passante semblable à un spectre, au seuil du discernable et de l’indiscernable. Dès lors, le mot diffusion entendu au sens de rendre publique une image peut s’entendre ici aussi comme l’action de diluer quelque chose dans un milieu, comme on diffuse un parfum d’ambiance. Ici, c’est l’image d’une jeune femme marchant dans les rues de la ville de Toulouse qui se retrouve diffusée dans le quartier de la porte d’Orléans à Paris. Passante discrète, elle fait écho aux figures féminines croisées dans l’espace urbain et qui subissent les regards des hommes portés sur elles.
Le titre fait ici référence au poème de Baudelaire, À une passante[9]. Pour le poète flâneur, les femmes croisées dans la rue viennent donner corps à son imaginaire, cristallisant la fugacité des échanges propres à l’expérience de la flânerie urbaine, et s’offrant comme simple objet de regard et de désir[10]. Il s’agissait en outre de marquer un paradoxe : alors que l’image de la femme est abondante dans les villes à travers l’affichage publicitaire notamment, la nuit tombée, de nombreuses femmes traversent les rues en cherchant à se faire les plus discrètes possible, à ne pas se faire remarquer afin d’éviter un potentiel harcèlement. Dans sa faiblesse et sa discrétion, la projection vidéo-mobile installe la présence et le regard d’une femme, d’une image qui fait corps avec l’espace, qui imprègne autant qu’elle se fond en lui. En utilisant un appareil peu performant, et qui dans ce contexte faillit dans sa fonction de diffusion, il s’agissait dans le même geste de marquer une présence, de s’approprier un espace par une image qui l’explore et de pointer vers l’effacement, la disparition de ce corps d’image.

L’aura comme lumière qui effacerait les visages
Dans les deux vidéos évoquées, la représentation du visage est ici mise en trouble, car le dispositif de fabrication de l’image fait défaut, débordé par d’autres éléments du réel qui viennent s’interposer entre le visage et le regardeur, éléments qui lui font écran. Cet écran, ce voile, ce flou, ce brouillage m’évoquent la notion d’aura.
Cette notion est délicate à utiliser, d’une part parce qu’elle renvoie aux croyances religieuses ou parareligieuses, d’autre part parce qu’elle a été employée par Walter Benjamin pour définir notamment la valeur cultuelle de l’art. Or, il n’est pas question d’identifier un quelconque caractère sacré dans ces images, mais plutôt de montrer comment un imaginaire, une survivance des images, peuvent être déclenchés par l’apparition de visages à la limite du lisible.
D’abord et avant tout, l’aura est ici à entendre comme un phénomène quasi-matériel, l’air léger, le souffle du vent, tel est le sens étymologique du mot aura en latin. Dans la physique antique, ce léger vent était associé à la lumière, l’aura peut se définir alors comme un air lumineux qui entourerait les êtres ou les choses. La lumière captée produisant une image flottante et une sensation brumeuse dans les deux dispositifs étudiés fait écho à cette idée. Ensuite, l’aura, associée à l’esprit divin ou non, s’exprime plastiquement par l’effacement, le retrait ou le brouillage des visages. L’auréole, dérivée de l’aura, peut être figurée par une lumière très forte autour du visage de la divinité, mais parfois même à la place du visage, ce qui est le cas dans les enluminures persanes. Dans un autre registre, celui des sciences occultes, la tentative de captation en photographie de l’aura, ici synonyme de l’âme ou de l’esprit d’un être vivant, suppose l’emploi d’un flou, d’une mise à distance de la figuration humaine, pour saisir l’« émanation, atmosphère qui semble entourer un être ou envelopper une chose[11] ».
Il s’agit ici non pas de ramener les images à un hypothétique statut spirituel ou sacré, mais de pointer un imaginaire à l’œuvre, des représentations de visages altérées, brouillées, floutées, sont ainsi associées à une dimension spirituelle, pointant la possibilité de figurer l’invisible par une forme illisible ou qui brouille le lisible.
Une expérience auratique, à partir de Walter Benjamin et de Georges Didi-Huberman
Par ailleurs, si la notion d’aura m’a semblé active dans ces réalisations, c’est davantage dans l’expérience de la fabrication des images, que dans la contemplation du résultat. C’est au moment de prendre l’image et que la lumière à contre-jour déborde les contours de la tête pour la flouter, au moment où la projection s’évanouit dans un recoin trop éclairé, que surgissent ces constellations d’images.
Ainsi Georges Didi-Huberman énonce :
« Auratique […] serait l’objet dont l’apparition déploie, au-delà de sa propre visibilité, ce que nous devons nommer ses images, ses images en constellations ou en nuages, qui s’imposent à nous comme autant de figures associées, surgissant, s’approchant et s’éloignant pour en poétiser, en ouvrager, en ouvrir l’aspect autant que la signification, pour en faire une œuvre de l’inconscient[12] ».
La notion d’aura chez Walter Benjamin peut être employée pour parler d’une œuvre, mais elle est aussi une expérience du monde, ainsi la définition qu’il donne ci-dessous se base sur la perception de la nature.
« Qu’est-ce au fond que l’aura ? Un singulier entrelacs d’espace et de temps : unique apparition d’un lointain, aussi proche soit-il. Reposant par un jour d’été, à midi, suivre une chaîne de montagnes à l’horizon, ou une branche qui jette son ombre sur le spectateur, jusqu’à ce que l’instant où l’heure ait part à leur apparition c’est respirer l’aura de ces montagnes, de cette branche[13] ».
Ce singulier entrelacement de temps et d’espaces, quand le maintenant rencontre l’autrefois, renvoie à la constellation d’images évoquées plus haut : à l’instant de l’effacement de la figure. À travers l’usage de ces appareils de basse qualité, surgit du lointain. Ce surgissement intervient dans l’expérience de la fabrication de l’image, dans l’expérience sensible. Le dispositif photographique tend à me faire produire un selfie, mais la défaillance détourne ce programme, et produit un temps d’arrêt formalisé par le brouillage du visage. L’image devient inutilisable en tant que portrait identifiable, mais elle fait revenir à travers elle d’autres visages, car le flou anonymise la figure, car l’effacement renvoie à une histoire de l’art empreinte de spiritualité, et à travers l’écran de mon smartphone, je deviens Autre. Des images remontent alors dans ma mémoire, une archéologie personnelle surgit : d’Hippolyte Baraduc aux icônes religieuses, du voile de Véronique à Memoria (2000) de Bill Viola, des fresques de Pompéi ou celles de Rome dans Roma (1972) de Fellini au Portrait Braille (1984) de Patrick Tosani, en passant par les autoportraits en clair-obscur de Rembrandt.
Didi-Huberman affirme que le déclin de l’aura ne signifie pas sa disparition totale mais sa résistance, sous forme de supposition. Parler d’une résurgence de l’aura dans l’expérience de la défaillance technologique, c’est supposer sa présence souterraine qui peut ressurgir à tout moment… Il faut pour cela, comme l’énonce encore Didi-Huberman, s’appuyer sur « un modèle capable de rendre compte des événements de la mémoire, et non des faits culturels de l’histoire[14] ». C’est-à-dire à la fois accepter le choc de la mémoire sans s’en remettre au passé.
Ici l’exploitation d’un dispositif associé à la superficialité, à la mise en scène de soi, au narcissisme, permet un détour par la mémoire, ce qui me semble être un moyen de se dégager des attentes du dispositif pour se réapproprier notre rapport aux images.
Autorité de l’aura : croyance et technologie
Pour Walter Benjamin les œuvres tiennent leur aura d’une croyance en ce qu’elles seraient acheiropoïètes, « l’aura s’impose dans la mesure même où la procédure imageante demeure secrète, miraculeuse, hors de portée[15] », explique Georges Didi-Huberman. Dans les images technologiques, même si l’on sait pertinemment que la procédure imageante n’a rien de miraculeux (quoi qu’on peut rappeler une des lois de Clarke : « toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie[16] »), nous n’avons pas accès au processus de fabrication de l’image, celui-ci n’est plus simplement physico-chimique, mais mathématique, algorithmique, et puissamment complexe. Dans le surgissement d’un flou auratique dans les images, n’y a-t-il pas une mise au jour de ce mystère ? Non une révélation, un dévoilement, mais au contraire la mise en lumière d’un voile qui pointe qu’il reste de l’invisible ? Cet invisible c’est la distance du calcul, l’architecture de données, les filtres formatant l’image, etc. Ce mystère non sacré des dispositifs numériques, que l’on aurait peine à appeler aura, fait pourtant autorité, et si l’on lit la définition de Walter Benjamin pour qui l’aura d’un être lui « confère le pouvoir de lever les yeux, et produit (…) un rapport déréalisé qui enchaîne celui qui regarde dans le rêve de l’autre, un rêve qu’il provoque lui-même en le regardant[17] », on peut opérer un rapprochement avec nos expériences actuelles des technologies. Lorsque nous sommes en train d’utiliser des appareils pré-formatés qui nous engagent dans une pratique normalisée de la fabrication des images, ne sommes-nous pas pris dans le rêve d’un autre ? Cet autre étant les acteurs de l’industrie culturelle ?
Si le vocable « aura » est sans doute inadéquat pour parler de la technologie, le transfert d’autorité, quant à lui, semble bien exister, et mettre en trouble les appareils pour produire des images floues peut être un moyen de réfléchir ce rapport. En saisissant la résurgence auratique dans l’emploi de ces appareils défaillants, en produisant un temps d’arrêt permettant la réminiscence d’images hors du temps technologique, ne pouvons-nous pas inverser l’autorité du simulacre de magie que produit le numérique ? Ces images au seuil du lisible pourraient être celles du réveil, moment clé selon Walter Benjamin :
« C’est au moment fragile du réveil qu’il s’en remettait, moment dialectique à ses yeux [et en position de seuil – AN] parce qu’à la frontière évanescente, ambiguë, des images inconscientes et de la nécessaire lucidité critique[18] ».
L’infra-mince comme éveil à la perception des images appareillées
« La chaleur d’un visage (qui vient de s’effacer) est inframince[19] »
Pour conclure, la défaillance technologique peut amener à produire des images de visages qui échappent à la standardisation et peuvent se relier à une histoire des représentations, à une dimension archéologique de l’image, le voile auratique dont il aura été question ici tient bien d’une profondeur accrue de la relation à l’image, à son sens autant qu’à sa fabrication, pour un recul critique qui n’empêche pas le plaisir esthétique. Représenter des visages flous est aussi un moyen de se désengluer de la fascination que ceux-ci peuvent causer, déplacer l’attention, renouveler l’effort. En ce sens, ces deux réalisations mettent en jeu l’infra-mince. En effet, le mouvement des images, le passage de l’une à l’autre dans Lumière et brume, et la diffusion voire dilution de La passante, pousse la perception dans ses retranchements : on cherche à retenir l’extrême évanescence des visages. Ainsi Thierry Davila explique que :
« Percevoir c’est saisir la différence au sein du jeu fluide des différences sensorielles, des différences du et dans le sensible (le chaud, le froid, l’aveuglant, l’assourdissant…). Lorsque celle-ci existe tout juste, lorsqu’elle est créée pour se dérober au regard ou aux sens en général, c’est-à-dire pour les mettre au défi de la distinguer, c’est alors tout le système des différences qui doit se remettre au travail, qui doit se remettre à faire la différence, à la saisir, pour ne pas sombrer dans l’anesthésie pure et simple, pour ne pas sombrer dans l’indifférenciation, pour pouvoir envisager la nouvelle différence, le nouvel écart dans le perçu, autrement dit pour continuer à sentir y compris lorsque le sensible se manifeste à peine[20] ».
Produire des images de visages à peine visibles, frôler l’infra-mince, serait ainsi un moyen de réveiller notre perception, de stimuler notre imaginaire, nos systèmes de référence face aux visages capturés, diffusés, organisés, classés à outrance par le système numérique.
Ainsi énonce Thierry Davila :
« Le rôle de l’invention, sa portée esthétique, c’est-à-dire esthésique (aiesthesis), est alors de relancer la perception à partir de l’imperceptible, d’en déconstruire le caractère mécanique et indifférencié, d’en défaire la capacité de neutralisation par habitude[21] ».
[1] On pense ici aux scandales des deepfakes qui se multiplient, le plus récent étant le cas du « faux Brad Pitt » qui a défrayé la chronique internationale en janvier 2025.
[2] https://vimeo.com/237554512
[3] https://vimeo.com/188355781
[4] André Gunthert, L’Image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p. 158.
[5] Ibid., p. 159.
[6] Pierre Bourdieu dir., Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965, p. 62.
[7] Des mouvements qui se veulent par ailleurs paradoxaux, puisque le format central est constitué d’images fixes animées par une suite de fondus enchaînés, alors que les deux cadres latéraux présentent des images en mouvement du paysage capté avec cette même caméra frontale endommagée.
[8] Cette réalisation s’appuie sur un protocole de projection et de captation simultanées : je projette des séquences filmiques (préalablement enregistrées) dans un espace urbain, tout en me déplaçant dans l’espace. Au gré de ce déplacement je cherche la surface la plus propice à révéler l’image projetée, en ville les espaces de projection peuvent être le sol, les façades, les panneaux de signalisation, voire les véhicules. La difficulté réside dans ce constant mouvement qui oblige à varier régulièrement les surfaces de projection.
[9] Voici un extrait du poème de Baudelaire À une passante qui illustre cette fugacité quasi-cinématographique de la rencontre urbaine :
« Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais. »
[10] Dans son livre Le flâneur et les flâneuses, Catherine Nesci énonce en parlant du flâneur baudelairien : « Notre pacha parisien évolue dans l’espace urbain comme dans son sérail privé. D’office célibataire ou veuf, le flâneur fait signe à toutes les passantes anonymes à qui il adresse un simple salut de reconnaissance (…) Le corps féminin joue ainsi le rôle d’appât orientant la course du promeneur citadin vers la chimère d’une conquête amoureuse », Catherine Nesci, Le Flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque romantique, Grenoble, Éditions littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble, 2007, p. 61.
[11] « Aura », Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/definition/aura
[12] Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, éd. De Minuit, Paris, 1992, p. 105.
[13] Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie » (1931), disponible en ligne in Études photographiques, novembre 1996 : https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/416
[14] Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, op.cit. p. 242.
[15] Ibid.
[16] Troisième loi énoncée par l’auteur de science-fiction Arthur C. Clarke dans « Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination », Profiles of the Future, publié en 1962.
[17] Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit.
[18] Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, op.cit p. 242.
[19] Détournement d’une citation de Marcel Duchamp : « La chaleur d’un siège (qui vient d’être quitté) est inframince » 1912.
[20] Thierry, Davila, De l’inframince. Brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp à nos jours, Paris, Du regard, 2010, p. 20.
[21] Ibid. p. 21.