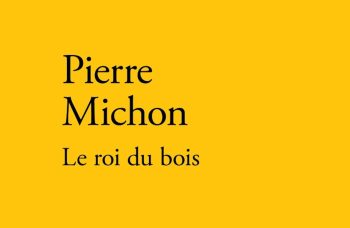Dans son travail artistique, Laura Sellies cherche à créer un langage alternatif hybride, indiciel et évolutif qui rend sensible des attentions aux corps, aux émotions, aux altérités considérés comme minoritaires et qui nous fait basculer dans des mondes autres où la notion de transformation est centrale. La chercheuse Solène Reymond a rencontré l’artiste pour retracer son parcours et interroger l’évolution de sa démarche collaborative et engagée. Voici la seconde partie de leurs échanges dont la première partie a paru mardi.
Solène Reymond : Pour réaliser la vidéo Le loup dont la queue est poussée par le vent (2022), tu as collaboré avec le philosophe Bastien Gallet. Des petites filles racontent une vieille histoire (après la catastrophe, le déluge, la fin des temps), deux habitants sans âge, sans sexe, seuls sur un terrain vague ont survécu, inventent des jeux. Le début de la vidéo sera repris à la fin d’Elia.
Laura Sellies : J’ai réalisé ce film à l’occasion de mon exposition à l’IAC Villeurbanne Soit je suis morte soit je deviens oiseau (titre emprunté à Incarner une abstraction de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker). Nous venions alors de terminer l’écriture du triptyque avec Bastien. Dans le triptyque, deux femmes se transforment et elles sont accompagnées par les Trois-petites-filles qu’elles croisent au hasard de leurs trajets quotidiens dans les deux premiers films. Mais les Trois-petites-filles existent aussi sur un autre plan plus mythologique. C’est ce que le troisième film explorera. Dans Le loup, elles jouent à un jeu de ficelle et racontent une histoire de création du monde. On découvrira par la suite qu’elles sont celles qui tirent les fils du destin des deux personnages. Les Trois-petites-filles sont une figure ambivalente, comme celle de la collectionneuse.

S.R : Après la notion de corporéité ou de transformation, ce travail avec Bastien Gallet développe aussi la notion de la temporalité articulée à une catastrophe qui appartient à un temps avant, qui n’a pas d’après. Quelle est la vision de la catastrophe que tu as voulu transmettre ?
L.S : Le travail avec Bastien a amené quelque chose qui était en germe, c’est la question de la narration. Et dans cette question de la narration, il y a celle de la temporalité. Dans Le loup dont la queue est poussée par le vent, la catastrophe est narrée par trois petites filles. Dans l’exposition, les écrans sont très grands, elles sont filmées légèrement en contre-plongée, de manière assez froide. Elles nous accueillent et nous dévorent. Les petites filles nous touchent et nous ingurgitent, elles sont douces et cruelles, c’est un Cheval de Troie. Elles nous attirent pour nous faire écouter une histoire, très longue (trop longue ?), qui ouvre l’exposition.
S.R : Mais comment rattaches-tu cette cruauté à la catastrophe qu’elles racontent ? Est-ce que tu as voulu enrayer l’idée que les jeunes générations représentent l’espoir et donc, tordre le cou à ce poids qui pèse sur leurs épaules ?
L.S : Je ne crois pas. Les Trois-petites-filles forment une entité. D’ailleurs, dans le film, elles n’ont pas de prénoms. Cette entité a pris la forme de trois petites filles dans une logique de métamorphose et peut-être de piège ou de ruse mais elle aurait pu prendre une forme différente. D’un autre côté, les petites filles sont pour moi les seules par qui le renouveau est possible, elles ne portent pas le monde, elles le font exister. Par leur récit bien sûr mais aussi physiquement, par la matérialité de leurs voix, leurs visages filmés comme des paysages, leur souffle qui se transforme en vent dans l’installation et a une influence sur tout le reste de l’exposition. Les petites filles sont le cœur de l’organisme que forme l’exposition.
S.R : D’où la figure des jeux de ficelle auxquels elles jouent. L’image peut faire penser aux jeux de ficelle de Donna Haraway, aux manières de réfléchir à comment faire des mondes et les penser[1]…
L.S : Oui, c’est sûr. Il y a une réflexion sur comment on raconte des histoires, que sont ces histoires (expériences ou productions de pensées) et qui les raconte. Comment ces histoires inventent des mondes et nous font penser le monde autrement. Comme je te le disais précédemment, je crois vraiment au pouvoir actif de la fiction. Donc oui, Donna Haraway, Ursula Le Guin… La théorie de la Fiction-Panier…
S.R : À quel point Donna Haraway et Ursula Le Guin sont importantes pour toi ? Est-ce que tu es influencée par d’autres références artistiques et/ou littéraires ?
L.S : Oui bien sûr, il y a des œuvres qui m’ont vraiment marquée. Par exemple, Hélène Cixous m’a marquée. Le titre Toutes ces filles couronnées de langues est d’ailleurs emprunté à son Rire de la Méduse. Elle a influencé ma façon de travailler.
Ce texte est un flux de conscience, on est pris dans quelque chose qui dégouline, qui déborde, se déverse, des pensées, des sons, des mots, des sensations. Entre la théorie et le récit de soi. Cette expérience de lecture a vraiment libéré quelque chose qui était en germe chez moi.
Dans cette lignée, je pourrais aussi parler de Maggie Nelson. Je suis assez pudique. Les formes artistiques que je produis ne me racontent pas mais j’ai conscience que je suis partout à l’intérieur.
L’une des raisons de cela est, je crois, que je choisis de travailler et de mettre en scène des personnes qui me touchent. Tout part toujours d’une émotion ressentie au contact de l’autre, de la volonté de créer une relation et d’inventer ensemble une forme.
Pour donner un exemple très simple de cela, il n’était pas question au départ d’une violoncelliste dans Elia et puis un jour j’ai vu Lucy Railton en concert. Elle m’a profondément touchée, par sa musique, sa présence, ce que je percevais de sa façon d’être au monde.
Nous avons alors écrit une histoire pour elle et j’ai mis un an à la convaincre de jouer dans le film. Si elle avait refusé, je n’aurais pas fait ce film, elle en était la condition puisque sa raison d’être.
S.R : Justement, comment choisis-tu les personnes qui jouent dans tes films ?
L.S : Je choisis des personnes qui me touchent par leur pratique et par leur présence.
S.R : J’ai noté que tes récits sont toujours ouverts, ils nous rendent actifs dans leur compréhension. On pense comprendre l’idée de l’œuvre mais le sens résiste à se donner entièrement tout en se révélant progressivement dans les travaux suivants. Comment expliques-tu cette résistance du sens de tes œuvres, comme une volonté de préserver leur état transitoire ou à résister aux normes ?
L.S : Je pense que mes pièces posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Tout simplement parce que je n’ai pas de réponse. Je ne peux proposer que des hypothèses.
Les pièces que je produis ne se donnent pas immédiatement, et peut-être qu’elles ne parlent qu’à celles et ceux qui prennent le temps de les déchiffrer, de se les approprier.
Ce n’était pas une stratégie consciente mais je sais aujourd’hui que c’est une façon de résister à ce que nous proposent les médias, les réseaux sociaux, au fait qu’il faut pouvoir tout comprendre et appréhender en un temps très court. Accepter de prendre le temps, c’est aussi un refuge. Je ne pense pas qu’on puisse construire une pensée en cinq minutes et je ne pense pas qu’on puisse la recevoir en cinq minutes non plus. C’est un échange.
Je crois aussi que les œuvres ne sont pas figées, elles évoluent avec nous et au contact des personnes qui les visitent, du monde dans lequel elles s’inscrivent, et elles nous transforment en retour.
La transformation est une de mes obsessions. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de réfléchir en quoi on se transforme mais plutôt de mettre en forme le processus lui-même. C’est un mouvement. Je pense ma pratique comme un long mouvement dont les expositions ne sont que des points d’arrêt. Les œuvres poursuivent ensuite leur chemin, elles s’enrichissent de celles qui vont suivre, on peut alors les reprendre, les relire, etc.
S.R : L’œuvre présentée à la péniche La Pop à Paris (du 05 au 28 juin 2025) Dans ta gorge les géantes emportées pousse tes expérimentations sur le langage par la mise en contact d’une femme sourde qui signe un conte et d’une femme entendante qui chante en traduisant le rythme, la prosodie du langage.
L.S : Oui. Pour ce film, j’ai à nouveau proposé à Bastien d’écrire un conte. Il dit la création d’un monde dans lequel les mains inventent langues et choses. Elles dessinent et quand elles dessinent parlent et quand elles parlent produisent : l’air, le temps, l’espace.
Et puis, j’ai eu la sensation que, pour être juste, pour coller davantage à l’idée que j’avais du projet, le texte devait être écrit à quatre mains. Je me suis donc insérée dans le récit de Bastien. Le conte est alors devenu une sorte de poème amoureux où un corps en invente un autre. Et ce corps devient le monde. Dans un double mouvement, il le contient et il l’invente à la fois. Ce film est pour moi très proche de l’état amoureux. Il raconte ce qui s’invente dans l’intimité d’une relation et qui n’existe que par cette relation.
J’ai ensuite demandé à Carine Morel, avec qui j’avais déjà collaboré sur Elia, de traduire ce texte en langue des signes. Elle m’a proposé de l’interpréter en VV (Visual Vernacular). Le VV est un art sourd, imprégné par la langue des signes, mais moins codifié, plus libre.
J’ai ensuite proposé à la chanteuse Isabel Sörling qui ne parle pas la langue des signes de traduire ce qu’elle percevait des gestes de Carine sans jamais lui donner le texte. Elle n’avait donc pas accès au sens et l’idée était de voir ce qui pouvait déborder des mots et des signes. Qu’est ce qui reste du langage si on supprime les mots, et comment trouver des manières d’être ensemble, d’échanger malgré cela.
Au début elles n’arrivaient pas à se connecter, et puis, au fil des répétitions, quelque chose s’est produit. Carine ne faisait pas de pause dans ses gestes et Isabel n’arrivait pas à trouver les endroits pour respirer. On peut respirer en faisant des gestes mais on ne peut pas respirer en chantant. Et puis, nous avons décidé de caler leur souffle, de les faire respirer ensemble pour se mettre sur le même rythme. La traduction est devenue un dialogue.

S.R : Dans la vidéo, les langages, les corps sont représentés face à face mais finissent par fusionner, les visages eux-mêmes sont très ressemblants. Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette fusion des corps et des langages ?
L.S : J’ai choisi Isabel et Carine pour plusieurs raisons mais l’une d’entre elles est qu’elles se ressemblent. Nous avons poussé cette ressemblance par les costumes, le maquillage, la coiffure. Ce film est divisé en deux écrans. Ce dispositif appuie physiquement l’idée de relation.
Mais cette relation est trouble et c’est aussi ce qui m’intéresse. C’est la question du fantasme. L’une pourrait avoir inventé l’autre, être sa projection, elles sont à la fois semblables et différentes, doubles et amies. Au départ, Carine et Isabel se font face, mais leurs corps sont morcelés par des très gros plans, on ne distingue pas s’il y a deux femmes ou une seule. Nous avons travaillé le son de la même manière, à la fois dans la composition avec Nicolas Becker et le mixage avec Ken Yasumoto.
Et puis effectivement, les visages s’interchangent, parfois les deux écrans sont occupés par Carine, parfois par Isabel, parfois elles se font face, parfois elles regardent dans la même direction. Il y a une dramaturgie dans le montage, dans la composition du texte, du son et une évolution dans la relation.
S.R : On ne fait pas la distinction entre le chant et le Visual Vernacular. Un son ricoche sur un autre, ou se fond dans l’autre grâce au travail du son et du visuel. Pourquoi avoir poussé aussi loin le dialogue entre le son et l’image ?
L.S : Il y a une synesthésie entre le son et l’image. Le projet est pensé comme cela puisque la voix vient traduire les mouvements. Initialement, le son est donc le double de l’image.
Mais ensuite, quand nous avons monté le film avec Ludivine Cambus, nous avons assemblé les images en cherchant les points de rencontre, en se basant sur le rythme de la voix. Sons et images sont donc intimement liés, il n’y a pas de hiérarchie. L’un est le double de l’autre et inversement.
Je crois que cette réciprocité vient aussi de la façon donc nous avons fabriqué les images et les sons. Avec Pauline Sicard, la cheffe opératrice, nous avons établi une grammaire qui comprend beaucoup de gros plans. L’idée était d’être proche de la peau, de son grain, de ses aspérités, de sa matière. Le fait d’être proche laisse découvrir une certaine intimité mais finalement c’est aussi ce qui empêche de tout saisir en même temps, justement parce que ça morcelle. C’est quelque chose que je travaille beaucoup dans les films. Nous avons travaillé le son de la même manière, les micros utilisés permettent une très grande définition du son, on peut donc se permettre d’être très petit dans ce qu’on enregistre, jusqu’au moindre filet de souffle.
S.R : Pourquoi placer les émotions au premier plan d’une de tes œuvres maintenant, pourquoi dans cette œuvre ?
L.S : Parce que je me détache et j’affirme petit à petit que les émotions sont un principe de connaissance, une manière de se relier. Quelques semaines après la première projection d’Elia, j’ai appris que j’étais malade. Comme les personnages que je mets en scène, j’allais à mon tour vivre la transformation. Cette maladie est génétique, ça veut dire qu’elle a toujours été en germe dans mon corps. Aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de penser que cette fascination pour la métamorphose m’a préparée à ce que j’allais vivre mais aussi peut-être qu’elle est née de cela. D’une forme d’inconscient corporel. C’est le premier projet que je réalise après avoir été malade et il y a peut-être des carcans qui ont sauté. C’est aussi un film de rupture et c’est le projet pour lequel j’ai la sensation d’avoir fait le moins de compromis.
S.R : Comment conceptualises-tu tes ressorts narratifs, entre éclatements du récit, permutations du point de vue, confrontations du son et de l’image ? Comment réfléchis-tu à ton écriture plastique du point de vue de tes choix formels ?
L.S : Oui, il y a quelque chose de l’ordre de l’éclatement du récit et du corps, on en a parlé. Le gros plan revient toujours dans l’image et le son parce qu’il me permet d’être au plus proche du personnage, de respirer avec lui, d’être en empathie avec les sujets que je filme. Et puis d’un coup, le plan s’élargit et le corps est une silhouette. Il devient alors le révélateur du paysage ou de l’architecture qui l’entoure. De son environnement. Peut-être que ça a rapport avec l’écologie, peut-être que ça crée du surgissement, de la surprise et donc une forme de stratégie de l’attention aussi. En juxtaposant plans serrés et plans larges, on n’oublie jamais qu’on est dans un film et que le film est une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Ce qui tire l’histoire est aussi à l’extérieur de l’histoire.
S.R : Dans tes expositions, tu croises souvent des objets, des médiums, des voix humaines et non-humaines selon une dynamique relationnelle, au cœur des théories et pratiques écoféministes (chez Karen Warren et les éthiques du care) : qu’est-ce qui t’intéresse dans ce rapprochement entre une perspective relationnelle et le dispositif d’exposition ?
L.S : Je suis très admirative du travail de Pierre Huyghe. De la façon qu’il a de faire d’une exposition un organisme vivant dont le spectateur fait partie intégrante. À ma façon, je tente de créer des expositions-environnements. L’influence du spectateur sur les œuvres ne se fait pas physiquement comme dans le travail de Huyghe mais par le montage. Les expositions que je mets en place sont des partitions, des parties à jouer. Plusieurs versions sont possibles mais elles n’existent que dans l’attention du spectateur. Je crois que ce que je propose ce sont des trames, des éléments – images, corps, sons, sculptures, textes, etc. – pour un récit à composer. Ces éléments fonctionnent sans hiérarchie et n’existent que par les relations qu’ils entretiennent. L’homme occidental s’est employé à désincarner, à supprimer toute altérité pour se placer au centre. Mon travail explore des mondes qui seraient repeuplés par ces altérités.

[1] Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2020.