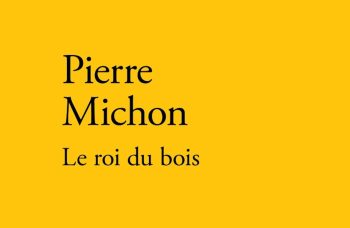Dans son travail artistique, Laura Sellies cherche à créer un langage alternatif hybride, indiciel et évolutif qui rend sensible des attentions aux corps, aux émotions, aux altérités considérés comme minoritaires et qui nous fait basculer dans des mondes autres où la notion de transformation est centrale. La chercheuse Solène Reymond a rencontré l’artiste pour retracer son parcours et interroger l’évolution de sa démarche collaborative et engagée.

Solène Reymond : Ton parcours a ceci de singulier qu’en plus d’être diplômée des Beaux-Arts de Lyon, tu es titulaire d’un master en Création littéraire réalisé à l’université Paris 8. Comment t’est venue cette envie d’une double formation ?
Laura Sellies : Quand j’étais en cinquième année aux Beaux-Arts de Lyon, je suivais un atelier autour de l’écriture lorsque j’ai entendu parler de cette formation à Paris 8 qui venait d’être créée. J’avais envie de m’aventurer davantage dans l’écriture, j’ai donc décidé de passer le concours. J’ai commencé mes études d’art à Nice, à la Villa Arson.
Mon amie Amélie Giacomini, avec qui j’ai collaboré pendant une dizaine d’années par la suite, était à Lyon. Nous avons entrepris une forme de correspondance, un blog. Chaque jour pendant trois mois, l’une d’entre nous envoyait une phrase à l’autre qui devait réaliser en une journée une vidéo en réponse à cet envoi.
J’ai rejoint Amélie à Lyon deux ans plus tard. J’avais un grand attrait pour la littérature et la poésie mais ce qui m’a amenée à l’écriture, je crois, c’est la rédaction de mon mémoire sur la transfictionnalité, un entre-deux entre réflexion théorique et auto-fiction.
S.R : Comment s’est imposée dans ta démarche artistique cette circularité de l’écriture textuelle, littéraire, vidéographique, performée par le corps ?
L.S : Avec Amélie, dès les Beaux-arts, nous avions envie d’explorer d’autres formes de langages. Nous avions l’intuition qu’il nous fallait nous réapproprier le langage usuel, le déconstruire pour penser de nouveaux modes d’échange. Et cela est passé par la rencontre entre un objet sculpture, un espace et un corps qui inventaient ensemble un nouveau système de signes. Les rudiments d’un langage. Plus tard, on s’est mises à les filmer, notamment pour intégrer le paysage. Cette exploration autour du langage est au cœur de tous mes projets.
S.R : Est-ce que tu penses ton corpus en fonction d’une complémentarité entre les médiums et en termes de liens narratifs entre tes œuvres ?
L.S : Toutes les pièces sont liées. Elles forment une toile même si elles sont aussi marquées par des moments de rupture, notamment la séparation avec Amélie.
À la suite de cette rupture professionnelle, j’ai proposé à mon ami Bastien Gallet, philosophe, de co-écrire un projet qui deviendra un triptyque de films. C’est alors un nouveau cycle. Il prend forme pour la première fois avec une exposition à l’IAC Villeurbanne en 2022 à l’invitation de Nathalie Ergino. Dans cette exposition, je mets en espace des éléments du triptyque à venir. On y trouve un film, des sculptures, des installations sonores qui sont comme les indices d’une narration en construction. Une partition pour un récit. Je réalise ensuite Elia (2023), premier film du triptyque, qui met en scène la violoncelliste Lucy Railton.
Ce cycle propose des portraits de femmes prises dans un mouvement de métamorphose. Évidemment, il y a des pistes qui se précisent et des événements qui changent ma manière de faire mais j’aime penser les choses en relation. J’aime travailler avec les mêmes personnes, retrouver des sujets, des formes, des personnages qui traversent les différents projets et se transforment.
Quand nous l’avons pensé, le triptyque était un projet de long métrage et puis j’ai préféré le découper en trois films parce que c’était d’une part plus léger en termes de production mais cela permettait également une manière plus organique de travailler. À la fin du premier film, nous pouvions réécrire le second en fonction de ce qui s’était passé pendant le premier, à la fois sur un plan théorique mais aussi sur un plan plus personnel. J’aime l’idée que les œuvres évoluent avec nous et qu’elles se déploient dans un espace plus vaste que celui de l’exposition.

S.R : Ton corpus d’œuvres assume une posture engagée (écologique et féministe). Qu’est-ce qui t’a conduit à articuler cette double perspective et comment s’est-elle imposée dans ton travail, dès le début ou petit à petit ?
L.S : J’ai toujours mis en scène des personnages féminins. Les femmes, leur condition minoritaire, leur corps, leur place dans le système social, leur capacité à se relier et à se transformer sont au cœur de mon travail. Des autrices féministes comme Hélène Cixous, Monique Wittig, Clarice Lispector, Octavia E. Butler, Anne Carson, Nnedi Okorafor, Émilie Hache, pour n’en citer que quelques-unes, ont beaucoup nourri ma pensée. Elles travaillent à se réapproprier le langage, les histoires, à fouiller de nouvelles formes de mythes pour produire une pensée qui n’est pas basée sur la domination et l’exploitation des corps, des richesses, des ressources, de la terre, etc.
Je suis persuadée que la fiction, les histoires qu’on choisit de raconter nous permettent de repenser ce qui nous arrive et nous entoure. Le fait de travailler exclusivement en collaboration a aussi pour moi un rapport avec une forme d’écologie. Une écologie de la relation.
S.R : Est-ce le fruit d’un déclic personnel, d’une envie de créer un espace safe dans ta manière de produire tes œuvres et de tisser autour de toi une toile relationnelle où tu peux prendre soin de ta création ?
L.S : À la Villa Arson à Nice, l’enseignement était quasiment exclusivement masculin. J’ai vécu des expériences assez violentes, c’est la raison pour laquelle je suis partie à Lyon. Je fais partie d’une génération qui a appris que les émotions sont à dévaloriser, elles sont des attributs féminins qui empêchent l’exercice de la raison, on ne se raconte pas, « c’est un exercice de midinette », « un travail de sac à main » comme j’ai pu l’entendre à la Villa.
Ça a été tout un processus pour déconstruire cette injonction et m’en libérer. Mon dernier projet (Dans ta gorge les géantes emportées, 2025) est celui qui va le plus loin sur ce territoire, parce que c’est à la fois le sujet et la forme du film. Il met en scène deux femmes. L’une est sourde, elle signe un conte. L’autre est entendante, elle chante ce qui déborde des signes et des mots, leur intensité, leur rythme, leur prosodie. L’idée au cœur de ce projet était de voir ce qu’il reste du langage lorsqu’on n’a pas accès au système de signe de l’autre. On part d’un dialogue impossible, et pourtant quelque chose se tisse dans l’intimité de la relation, une forme de communication, de partage, qui ne peut exister que parce que ces deux femmes sont ensemble.
Aujourd’hui, je crois que l’émotion est le produit d’une attention sensible au monde, c’est ce qui nous connecte aux autres. Avec Amélie, nous avons beaucoup voyagé pour nos projets. Nous avons travaillé au Sénégal, au Maroc, en Italie, etc. Chaque voyage, chaque projet était l’occasion d’une vie en communauté. Nous avons beaucoup exploré des formes d’artisanats traditionnelles comme le tissage et la vannerie par exemple. Dans le geste lent et régulier de l’artisanat, les langues se délient et on commence à se raconter des histoires. C’est le point de départ du projet que nous avons mené dans l’Atlas marocain, avec une coopérative de femmes avec qui nous avons réalisé un grand tapis où les différentes techniques de tissage étaient l’expression d’un sentiment ou d’un moment de vie. Ce tapis est ensuite devenu l’étendard de la communauté des femmes de notre film Toutes ces filles couronnées de langues (2019).

S.R : En quoi cette double sensibilité (écologique et féministe) influence-t-elle ta manière de créer, que ce soit en choisissant de collaborer avec d’autres artistes, chercheurs, ou en cherchant à inventer des langages alternatifs ?
L.S : Je travaille toujours en collaboration. Cette façon de travailler est née de la recherche en duo avec Amélie et s’est développée par la suite. Après notre rupture professionnelle, je crois que j’ai vraiment eu besoin de me créer une safe place comme tu l’évoquais tout à l’heure. Une sorte de communauté de travail a commencé à se former. Nous travaillons ensemble quasiment sur chaque projet et chacun et chacune a une pratique différente. Bastien Gallet se situe plutôt du côté de la philosophie et de l’écriture, Nicolas Becker, du côté du son, Florence Cohen du côté de la production. Petit à petit se développe un langage commun, une grammaire formelle et théorique qui nous permet je crois de faire émerger des mondes à la frontière du réel et sur un temps long. C’est pour moi une forme de résistance.
S.R : Qu’est-ce qui motive cette envie de collaborer avec d’autres dans ton travail ?
L.S : J’ai toujours travaillé comme ça. Je me suis beaucoup posé la question parce que la collaboration peut être compliquée sur beaucoup d’aspects et le milieu de l’art contemporain vise plutôt à l’exclure, à l’inverse du milieu du cinéma ou du spectacle vivant. Bien sûr, les institutions l’appellent de leur souhait mais en termes pratiques c’est une tout autre histoire ! Imposer la collaboration est un acte politique mais c’est aussi pour moi un geste qui vise à l’épanouissement. Être artiste est un choix de vie lourd ; dans la relation à plusieurs, je trouve énormément de plaisir. J’adore rencontrer des gens, être déplacée et pouvoir déplacer les autres. On s’accorde dans nos différences, de personnalités, de médiums, de pensées, et c’est là où le travail de collaboration forme comme une grande toile. Ça permet de lutter contre un point de vue qui serait dominant, ça donne du courage, ça rend plus fort, ça permet de vivre et de poursuivre le travail.
S.R : Entrons en détail dans une de tes œuvres. La vidéo Toutes ces filles couronnées de langues réalisée avec Amélie Giacomini (2019) donne à voir des personnages féminins qui se rencontrent sur une île, communiquent, s’expriment de manière étrange et familière à la fois. Est-ce que je me trompe si je l’analyse comme une bascule, non pas dans un autre monde (à la manière d’un récit de science-fiction), mais dans un monde autre (un réel dans le réel) où les personnages sont animés par un devenir autre ? Qu’est-ce qui t’intéresse dans ce travail des frontières entre le réel et la fiction ?
L.S : L’idée n’est pas de proposer un nouveau monde mais un monde « entre » qu’on ne peut pas vraiment situer. On ne sait si l’histoire est passée ou future. Il y a cette ouverture d’un espace liminal, être à la limite ou au bord de quelque chose. Le seuil c’est la possibilité d’une porosité entre deux réalités et je crois que c’est cela qui m’intéresse, voir ce qui déborde de l’une et de l’autre, comment elles se rencontrent et qu’est-ce que cela peut produire. C’est aussi le sujet d’Elia (2023). Tout au long du film, le spectateur ne sait si c’est la perception du personnage qui change ou si c’est le monde autour d’elle qui se transforme. Des créatures alors apparaissent.

S.R : On est dans l’imminence d’une bascule, mais pas tout à fait dans cette bascule. Est-ce que c’est un geste que tu as conscientisé, non pas comme une envie de faire table rase de quelque chose mais comme une infusion lente qui rend possible la transformation de mondes intérieurs et extérieurs ?
L.S : Oui, dans mon travail il y a une vision plutôt positive. Quelque chose est possible à la condition d’une transformation et de son acceptation. Il ne s’agit pas de tout déconstruire mais de réinventer à l’intérieur de ce qui existe en se reconnectant à l’environnement, aux autres, en faisant communauté parfois comme dans Toutes ces filles couronnées de langues par exemple.
S.R : Dans Elia (présenté au St. Moritz Art Film Festival du 21 au 24 août 2025), la notion de transformation est beaucoup travaillée. Elle est couplée avec le motif du déraillement, celui du son. Mais c’est un son qui blesse le personnage féminin et le spectateur à travers elle. C’est l’agression qui entraîne la transformation. Comment as-tu eu l’idée de mêler la notion de transformation à cette dichotomie blessure/transformation qui ouvre un passage vers un autre état intérieur, et donc une autre relation au monde ?
L.S : Quand on a réfléchi à ce film avec Bastien Gallet, nous avions l’idée que la transformation est une grande violence mais, parce qu’on est pris dans un mouvement qui nous dépasse, elle est aussi un plaisir intense. Une fois la transformation acceptée, elle permet une expérience nouvelle.
Dans Elia, le personnage fait face à un dysfonctionnement physique, un bouleversement qui va affecter sa façon de jouer de son instrument, puis l’affecter tout entière. Au début du film, elle a une pratique virtuose du violoncelle mais petit à petit elle va devoir la transformer, elle découvre alors une autre façon de jouer davantage basée sur l’expérimentation et l’écoute. Son point de vue sonore se transforme, des sons émergent en elle et autour d’elle.
Les témoignages de Pauline Oliveros et sa pratique du Deep Listening nous ont beaucoup influencés. Elia raconte que par un autre type d’attention au monde on peut découvrir d’autres voies/voix. C’est le sujet du film mais c’est aussi ce que l’on a tenté de développer formellement par une façon de filmer et de produire le son qui a pour moi un rapport avec l’empathie.
S.R : Et en faisant entrer ce déraillement dans sa vie, le personnage découvre l’histoire de deux femmes qui se sont aimées, et cet amour est transmis par le son qu’elle entend…
L.S : Oui, assez peu de personnes relèvent cette histoire alors que c’est le seul moment du film où il y a un dialogue (ou plutôt un monologue). Une collectionneuse étrange, interprétée par la comédienne Anne Alvaro, fait le récit des deux femmes qui habitaient la maison qu’elle occupe. Une architecte, Esther Vögel, et une violoncelliste, Rebecca Byrd, qui se sont aimées. Esther décide de faire fabriquer un instrument accordé aux fréquences de résonance du lieu pour les quarante ans de Rebecca mais cet instrument entraînera la disparition de l’être aimé, elle l’appelle « le monstre ». C’est cet instrument que la collectionneuse prête à Elia et qui fait dérailler sa vie comme tu dis car c’est à partir de là qu’elle commence à avoir de très violents acouphènes. La collectionneuse parle beaucoup, énormément, trop, en opposition à Elia qui est davantage dans une position d’écoute. Elle déverse ses mots sans considérer celle qui est en face. En termes sonores, sa voix est traitée par vagues, elle est par moments extrêmement claire puis devient presque inaudible, comme aspirée par les architectures que les deux femmes traversent durant tout le monologue. Ce cheminement à travers le récit et les différents espaces est une initiation qui va permettre à Elia de se connecter au son et, effectivement, à cette histoire d’amour.
La scène suivante se déroule dans une serre, une architecture de verre dont semble émaner une voix féminine qui chante une berceuse amoureuse mise en musique par Quentin Sirjacq. « Quand glisse sur mon corps le frémissement de ta langue, je rêve. Quand le sang qui flue dans tes veines monte dans ma gorge, j’endure. Quand le grès de ta peau fige dans ma peau ses caresses, je bous. Quand tu roules, sautes et tombes, pour capturer mon regard, je dresse. Quand nos corps désaxés par le vent mêlent leurs humeurs, je croîs, je crie ». Les mots se délitent et la voix devient matière. Ce sont les derniers mots que l’on entendra dans le film. Comme si l’histoire, pour continuer, devait s’affranchir du langage. Elia bascule alors dans une autre réalité.
Retrouvez ici la seconde partie de la rencontre avec Laura Sellies.