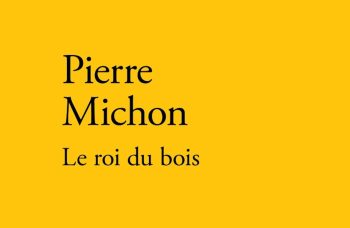Fabien Boitard est un peintre français. Actuellement représenté par la galerie Renard Hacker, il a participé à de nombreuses expositions dans des institutions publiques. Œuvrant dans le registre figuratif, il est à l’origine de la polyfacture, méthode visant à combiner des factures appartenant à différents registres visuels. Réfléchissant à la façon dont chaque gestuelle implique une symbolique spécifique, il donne à voir l’articulation entre la peinture-matière et la peinture-sujet propre à cet art. C’est pour cette raison qu’il est l’invité de la rubrique « méta » tout au long de l’année 2025.
Orianne Castel : Nous avions terminé notre discussion précédente en évoquant notre façon de regarder ailleurs alors que « la maison brûle » et j’aimerais que, pour celle-ci, la dernière avant notre numéro d’été, nous discutions ensemble de votre rapport à l’environnement. Vous avez peint beaucoup de paysages et, avant d’aborder des tableaux précis, j’aimerais savoir dans quel type de paysage vous vivez car vous avez fait de très nombreux tableaux présentant la vue de deux montagnes dessinant un morceau de ciel en V. Est-ce chez vous et quel est votre rapport à la nature ?
Fabien Boitard : J’ai choisi, après quelques années de vie en maison de village, de me rapprocher de la nature en louant un terrain sur lequel j’ai installé une grande caravane pour habitat et j’ai construit un atelier tout en bois et complètement démontable que la DRAC m’a aidé à financer. Je vis en autonomie en électricité et en eau. C’est un endroit où je me sens bien : une clairière en lisière de garrigue cachée par des chênes verts où je vois sans être vu. Le canal de Gignac, en contrebas du terrain, arrose toute la vallée de l’Hérault au sortir des gorges. Tous ces éléments contribuent à en faire un cadre de vie paisible. Mais, même si la vue depuis l’atelier donne sur le massif de la Séranne, les peintures de paysages dont vous parlez ne sont pas issues de mon environnement immédiat. Elles posent cependant pour moi des problèmes de perspective par la polyfacture.
O.C. : De cette vue, vous avez fait plusieurs déclinaisons et, notamment à partir de 2018, une série d’enveloppes dans laquelle vous insistez, par la touche, sur cette forme triangulaire du ciel prise entre les deux montagnes. Pourquoi ce jeu formel ? Pourquoi transformer cette vallée en missive ?
F.B. : C’est justement ce qui m’a plu avec cette série des vallées/enveloppes. Leur composition simple, leur perspective efficace, très minimale, très géométrique, je l’ai rencontrée au détour d’une montagne. J’ai photographié la vallée en enveloppe plus haut sur le Canigou alors que j’étais en résidence de dessin de montagne dans les Pyrénées Orientales. C’est donc une forme observable dans la nature si l’on choisit son point de vue. J’aimais beaucoup l’idée que le dernier plan soit aussi le dernier peint. Dans une perspective inversée, ce rabat d’enveloppe vient recouvrir une partie de la toile. C’est très pratique. Il installe un point de fuite tout en créant une rupture formelle pour jouer d’une perspective plus atmosphérique au loin, par la facture. Ce dernier plan recouvre et dessine les deux autres plans en même temps. Le plus loin est au plus près du regardeur car, dans le temps de fabrication du tableau, c’est le dernier élément posé.

O.C. : Vous avez également effectué une déclinaison de cette vue en avant/ pendant/ après (je ne sais pas si ça vous a été inspiré par cette forme de sablier que m’évoquent personnellement vos compositions en cône inversé) à travers trois tableaux dans lesquels le paysage se dégrade. Est-ce un triptyque ? Pourquoi avoir anticipé de cette façon sur l’avenir ? À moins que ce paysage ait réellement brûlé ?
F.B. : Dans les toiles « Avant », « Pendant » et « Après », réalisées en 2021, le même point de vue est confronté à divers états d’une même nature à différents moments. Cela m’a permis de rendre visible un scénario simple et plausible avec en arrière-fond le changement climatique. Il y a également quelque chose de l’ordre d’un « c’était mieux avant » dans cette série. C’est vrai que ces tableaux sont plutôt faits pour être vus côte à côte, en triptyque donc puisqu’il y en a trois, mais, comme les collectionneurs préfèrent « Avant », j’ai dû faire plusieurs versions de « Avant » pour continuer de pouvoir montrer l’ensemble. Le côté sablier, c’est vrai, renforce peut-être l’idée de temps qui passe… Mais il est là surtout en raison de la présence de la vallée, qui dessine un sablier ou une direction. Les diagonales du format rectangle agissent aussi comme un point de fuite. Tout invite, dans cette composition, à pénétrer dans cette fenêtre : le chemin figuré comme les différents plans. Cependant, en même temps, la matière rappelle le plan… qui agit alors parfois comme un mur.

O.C. : J’ai pensé à cette idée de sablier, de temps qui inévitablement s’écoule, parce que vous avez peint un autre paysage dans lequel on peut voir, sur la partie supérieure du tableau, une maison et un arbre campés dans une petite vallée à fleur de colline et, sur la partie inférieure, en miroir, cette maison et cet arbre traités sans couleur, réduits à de simples contours et dont surtout nous n’avons que la trace. Est-ce qu’avec ce traitement qui rappelle celui réservé à l’emplacement des corps des victimes dans les scènes de crimes, vous nous dites que le temps, pour ce type de paysage, ne peut aller que vers une disparition violente ?
F.B. : Je veux certainement dire cela mais sans doute pas en ces termes. C’est un négatif, c’est sûr, les choix ont été opérés dans un souci de rupture formelle entre les objets positionnés dans ce décor et leurs reflets. J’ai pris du scotch repositionnable pour dessiner grossièrement leurs reflets ou plutôt leurs prétentions respectives car ce ne sont pas des négatifs exacts : « l’ombre » du petit arbre a la forme d’un grand sapin, celle de la maisonnette ressemble à un immeuble. La bombe aérosol ici renvoie pour moi à une esthétique urbaine et à l’univers du tag. C’est une solution pour sortir de l’aspect bucolique choisi pour représenter le paysage. Cette technique amène également un peu de pollution, et c’est aussi ce qui compte. Les jeux de polyfactures entraînent des questions de choix pour le peintre et d’interprétation de ces choix par le regardeur. Je peux expliquer mes propres choix, mais tout cela se met en place de façon très intuitive. Comme je ne contrôle pas tout le potentiel narratif de chaque facture/outil pour chacun des regardeurs, le résultat est ouvert à l’interprétation.

O.C. : Pour en revenir à votre vallée, c’est intéressant car, à force de traiter ce morceau de ciel comme un fragment presque indépendant de l’autre, vous en êtes arrivé à rendre cet arrière-plan plus présent que le premier, et c’est une idée que vous continuez d’explorer avec la très belle série Derrière les fleurs la montagne (Photo d’ouverture). Pouvez-vous nous dire le sens de ces représentations où le lointain devient ce sur quoi on se casse la vue ?
F.B. : Oui, petit à petit, je me suis rendu compte de mon intérêt pour la perspective. J’ai donc essayé de penser ce qui différencie radicalement notre monde de ceux qui l’ont précédé. Nous partageons l’idée que l’on se fait du monde, il s’agit d’une construction collective de notre « époque », aussi je suis parti de l’idée contemporaine du « mur climatique ». J’ai pris pour point de départ cette échéance fatale annoncée à très court terme, le temps d’une vie humaine si rien ne change dans nos comportements à l’échelle mondiale, et qui bloque l’avenir dans un imaginaire partagé en nous promettant le pire. Naturellement, en ayant en tête cette idée d’un horizon/mur, je me suis mis à inverser la perspective. J’ai traité cette inversion par la matière. Dans ces tableaux, plus l’objet représenté est loin dans la fenêtre du tableau, plus il se charge de matière. La netteté est due à la matérialité de la peinture. L’horizon qui est le plus loin se trouve être le plus chargé et donc au plus près physiquement du regardeur… il a le nez dessus, mais c’est aussi le dernier objet peint dans le temps de constitution de la toile. Les flous du premier plan se trouvent en conflit avec cette « mise au point perspective ». Pour ce faire, je m’appuie aussi sur les codes de la photographie. Entre les différents plans du paysage, la transition d’un plan à un autre devient l’enjeu.

O.C. : Il me semble qu’avec les tableaux dont nous venons de parler, vous créez votre propre perspective inversée après des essais, comme dans ce tableau où vous avez travaillé la perspective inversée « classique » comme on peut la voir dans certaines icônes par exemple (ou dans les tableaux de David Hockney). Depuis combien de temps cette idée d’inventer une nouvelle perspective vous travaille-t-elle et qu’est-ce qui a mis en route cette recherche ?
F.B. : En termes de perspectives d’avenir, les scientifiques nous disent qu’à ce rythme, il n’y en a pas, ou pas pour tous. Très tôt, au lycée, je me suis intéressé aux modernes comme Dufy ou Picasso qui faisaient déborder leurs plans sur les personnages, Matisse qui redressait certains plans de ses compositions, comme les tables par exemple. Il y a aussi la perspective hiérarchique du Moyen Âge où le seigneur est représenté plus grand que les autres personnages même s’il se situe derrière eux. Il y a également la perspective classique que l’on m’a enseignée aux Beaux-Arts, plus géométrique, mathématique, rationnelle… Ces approches diverses m’ont appris que plastiquement l’espace du tableau et l’espace dans le tableau sont différentiables, et que l’on peut changer les règles de l’organisation de l’espace fenêtre et de l’espace plan. Ce qui me plaît dans ce tableau, c’est que l’horizon et la montagne sont les derniers gestes/intentions. En un geste, je montre et recouvre l’horizon qui se trouve à la fois figuré par ses couleurs et occulté par la matière généreusement étalée au couteau. Montrer en recouvrant… cela crée un paradoxe visuel mais on comprend quand même l’espace car l’horizon est à sa place dans un geste net, appliqué et légèrement autoritaire.


O.C. : Avec les champs du tableau que nous venons d’évoquer, nous sommes passés du paysage complètement naturel de la vallée à celui de la nature domestiquée par l’homme. Il y a beaucoup de paysages semi-naturels dans votre production et je pense notamment à ceux dans lesquels apparaissent, comme des doubles de la présence humaine, des tracés verticaux marquant ici un poteau électrique, là un mât d’amarrage. J’ai beaucoup étudié l’équilibre des contraires selon Mondrian et c’est peut-être à cause de lui que je lis votre œuvre ainsi mais, personnellement, je trouve qu’avec ce système d’opposition vertical/horizontal appuyé par la différence de facture épaisse/lisse, l’antagonisme nature/culture est plutôt harmonieux dans ces tableaux. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que vous aimez les paysages que vous avez pris pour modèles pour ces tableaux ?
F.B. : Le Mât Gris bleu a été peint d’après souvenirs, les poteaux électriques sont des réminiscences ajoutées sur un fond d’une vue peinte depuis l’atelier. Dans les deux cas, je connais ces paysages mais vient se surajouter un objet/geste directement sorti du tube. Il s’agissait ici de poser un geste dans un environnement et, en le contextualisant, de le rendre figuratif. La gestuelle devient poteau ou mât. C’est un élément qui tranche avec son environnement par sa nature. Horizontal et vertical c’est vrai… nature vs culture.

O.C. : Il me semble que ce « semi-naturel », vous le traitez aussi parfois seulement par le geste sans ajouter d’éléments visuels rappelant l’humain. Je pense notamment à cette toile qui au contraire du fondu impressionniste dessine un paysage quadrillé. Personnellement, cette répétition de petites touches rectangulaires m’évoque les jardins standardisés des campagnes pavillonnaires. Connaissez-vous ces paysages-là ?
F.B. : Parallèlement à la polyfacture, je tenais à avoir un autre travail plus monofacturé que je n’ai pas encore vraiment pris le temps de développer. C’est un travail sur le motif, donc en extérieur. « L’arbre » que l’on voit ici, un poirier, est l’un des arbres du grand jardin de mon ami le comédien Mathieu Lané-Maby qui m’a accueilli chez lui pendant un an au Pontet à Avignon avant que je m’installe à Aniane. Cette touche pixellisée, répétitive, presque mécanique dans sa touche, devait être la facture utilisée pour toute une série d’arbres peints pour être sauvegardés avant disparition. Comme je l’ai dit lors d’un de nos précédents entretiens, on peut rester une vie sur une seule technique, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Aussi, comme ce projet était monofacturé, je l’ai mis de côté.

O.C. : Il y a aussi dans votre production d’autres types de paysages qui ne sont ni la nature, ni la campagne, ou plutôt qui sont des points de vue sur la nature et la campagne, et qui pour leur part sont tout entiers humains avec leurs infrastructures massives ; il s’agit des autoroutes. Vous en avez peint quelques-unes. Pourquoi ? Êtes-vous d’accord pour leur donner, au sein de votre réflexion sur le paysage, le statut de point de vue ? Et pouvez-vous nous dire quelles vues, aperçues de là, vous avez souhaité décrire avec cette série ?
F.B. : Pour moi, le point de vue est essentiel puisque la pratique de la polyfacture m’oblige à faire des choix à chaque moment de l’élaboration de l’œuvre, du sujet à l’objet. Ces choix répétés m’engagent également, à tous les niveaux, du citoyen au peintre. Enfant, pendant les trajets interminables pour aller en vacances, je m’imaginais que si la voiture de mes parents fonçait sous un pont d’autoroute nous aurions le choix entre plusieurs mondes. Chaque pilier du pont dessinait pour moi une porte vers un autre monde possible. Plus tard, j’ai interprété ces rêveries d’enfant et peint ces paysages morcelés par le pont, c’est-à-dire que, dans un même paysage, se trouvaient différentes façons de le décrire par la facture. Couleur/non couleur, matière/non matière, flou/net, sale/propre, bien fait/mal fait, etc., je mettais déjà en œuvre la polyfacture mais sous forme de plusieurs monofactures séparées par les piliers du pont et liées par le paysage ou l’horizon. C’est une série que j’ai commencée en quittant Bourges pour Avignon. Les photos qui m’ont servi pour peindre ont été prises sur l’autoroute A75. Un point de vue très partagé.
O.C. : Oui, justement, le point de vue de l’autoroute ne vous a-t-il pas intéressé aussi parce qu’il donne à voir simultanément des paysages qui normalement ne se rencontrent pas (à droite un château, à gauche un silo à grain, un peu plus loin un entrepôt Ikea). Il me semble que le côté patchwork de ces paysages répond assez bien au projet de la polyfacture. Non ?
F.B. : Oui, c’est déjà de la polyfacture et un point de vue partagé avec d’autres enfants, je pense. Mais le monde peut aussi être décrit comme un immense patchwork rempli d’objets hétérogènes. En tant que peintre, je les dispose dans un espace donné. Je compose avec les objets d’un paysage. Il y a dans ce tableau « De quoi demain… » une esthétique de jeux vidéo ou synthétique que l’on retrouve également dans les « Ruissellements ».

O.C. : Il me semble justement que dans la série des Ruissellements (2018-2020) vous tentez de relier ces fragments de paysages disparates. Que pouvez-vous nous dire, par exemple, de « Ruissellement n° 1 » dans lequel on voit l’eau pure de la montagne devenir de plus en plus sale au fur et à mesure qu’elle passe par différents types d’habitats humains ? Et surtout, comment articulez-vous cette représentation, littérale on peut dire, du rapport des hommes à la nature et le titre ?
F.B. : Ce tableau est un format moyen qui décrit un cycle de l’eau associé à la théorie du ruissellement. Le cycle de l’eau finit par être corrompu par le château qui recrache une pollution. C’est un travail sur la perspective par la polyfacture. Comme je le disais, « Ruissellement » a une esthétique particulière, elle m’évoque celle des jeux vidéo où chaque élément devient presque signalétique. J’ai adopté ici une attitude de « chef d’orchestre », je me suis autorisé à faire ce que je voulais comme dans un monde virtuel. J’ai ainsi associé plusieurs perspectives selon mes besoins : l’une redressée pour raconter littéralement et l’autre de type plus classique. De ce fait, on tend vers le schéma.

O.C. : Vous parlez de schéma et je pense à vos petits pavillons, motifs de l’habitat identiques et duplicables. On les retrouve également dans un autre tableau que je trouve intéressant au regard du changement de perspective que nous évoquions en début d’entretien, il s’agit de celui dans lequel le paysage n’est plus l’horizon qui nous entoure mais une sorte de cœur minuscule que nous entourons et tentons de protéger de nous-même. Comment voyez-vous votre rôle de peintre par rapport à vos prédécesseurs qui ont peint l’aspect terrifiant pour certains (les romantiques), la beauté pour d’autres (les impressionnistes), de la nature ?
F.B. : Notre rapport au monde a changé. On ne regarde plus la nature comme quelque chose à découvrir et à explorer ou contre laquelle il faut se protéger, mais au contraire comme quelque chose de fini, petit, exploité, menacé. Ces motifs de pavillons représentent pour moi les personnes. Pour cette toile, je voulais faire voir une nature contenue, parquée au milieu d’une zone pavillonnaire, tel un parc dans la ville. Quand j’ai besoin d’un village, je me sers de ce motif/logo qui rompt avec un autre mode de représentation. Si notre rapport au monde s’est modifié, la manière de le représenter a nécessairement dû changer. Qu’auraient fait les impressionnistes s’ils avaient eu en tête le « mur climatique » comme seule ligne d’horizon ? Certainement de très belles choses. La connaissance que nous partageons collectivement d’une collapsologie annoncée, la future invivabilité de notre planète, permet-elle de dégager le début d’une esthétique ? La question paraît paradoxale. En effet, pourquoi peindre ou redéfinir une perspective alors que la perspective d’un futur collectif est incertaine ? Mais ces réflexions sur la société et notre rapport à la nature forgent naturellement de nouveaux rapports de facture et permettent de mobiliser de nouvelles combinatoires ; ce ne sont pas que des inventions techniques. Les avancées en matière d’esthétique traduisent un pas de côté ou un changement d’attitude. En forçant le choix par la facture/outil, je m’engage. On pourrait dire que c’est « mon » point de vue sur ce que « nous » voyons.

O.C. : Le réchauffement climatique (et le risque de disparition qu’il fait courir à la nature telle que nous la connaissons) n’est pas un sujet très joyeux, mais vous avez une série dans laquelle, par son titre au moins, il me semble que vous l’abordez avec humour. Pouvez-vous nous parler de Mes prévisions pour l’hexagone qui contient d’ailleurs nombre d’œuvres dont l’esthétique est abstraite, vous qui n’aimez pas l’abstraction ?
F.B. : Attention ! J’aime bien l’art abstrait mais ce n’est pas pour moi un genre complet car il oublie l’essentiel, ce qui relève de la politique. Il ne dérange personne. « Mes prévisions pour l’hexagone » est une série de shaped canvas de forme hexagonale. À mon sens, si on admet que l’hexagone symbolise la France, ce sont des compositions complètement figuratives. Ce ne sont ni plus ni moins que mes prévisions météorologiques pour la France avec un soleil par ci et un nuage par là. Il s’agit de compositions polyfacturées par un ensemble de gestes distincts afin de décrire l’ambiance du jour. Certaines sont plus tourmentées et d’autres plus tranquilles car chacune dresse un état des lieux des humeurs du jour. C’est vrai que cette série est plus humoristique, plus légère malgré un sujet une fois de plus climatico-social.

O.C. : Pour finir en beauté, et peut-être aussi boucler la boucle, j’aimerais que nous abordions vos fleurs. Nous le disions à l’occasion de votre tableau « Autoportrait à la GO Pro », vous avez choisi d’aller, comme les anciens, peindre sur le motif. Alors ma question est la suivante : est-ce que votre idée de peindre des fleurs en texture épaisse sur des fonds flous comme vous l’avez fait dans la série des Cerisiers vous est venue en observant la nature et notamment les fleurs d’eau se détachant nettement du fond plus flou de l’eau comme on peut le voir sur ce tableau ?
F.B. : J’ai toujours aimé l’esthétique de la photographie animalière. Celle, par exemple, où la mise au point se fait sur l’insecte, la fleur restant partiellement floue. Je trouve cette esthétique terriblement séduisante. Pour la série des branches en fleurs, j’ai travaillé d’après des photos collectées sur internet pour avoir une base plausible en couleurs, tons, cadrages, etc. Puis assez vite, la peinture s’est imposée. Cette série incarne l’idée d’une nature qu’il vaut mieux voir floue plutôt que nette. En reprenant les codes de la photographie animalière, l’alternance entre net et flou, je me sers de la fenêtre et du plan pour créer un espace entre ce flou et ce net, entre cette matière et cette non-matière. De la même façon et sur un format plus grand, un espace tend à s’ouvrir à l’extrémité de quelques pétales dans « les fleurs d’eau ». Cette recherche est très optique pour moi et j’ai du mal à imaginer la façon dont le public peut la recevoir. Je me demande aussi si ma vue qui baisse n’influence pas ma peinture. Mais, pour revenir à votre question, les « fleurs d’eau » sont des fleurs purement imaginaires, elles ont émergé d’un support dont j’avais travaillé le fond auparavant. Leur apparition est née d’une envie de peindre des fleurs pour compléter la scénographie de l’exposition « Là-Bas » 2023 à la galerie Renard-Hacker de Lille.

O.C. : Un paysage peint est un fragment, c’est-à-dire un focus porté sur tel ou tel aspect de l’environnement, et c’est pour cette raison que j’ai voulu terminer cet entretien avec vos fleurs en voie de putréfaction. Il me semble qu’elles soulignent une certaine progression de votre regard qui est peut-être aujourd’hui plus optimiste. En tout cas, avec votre renversement de la perspective, la montagne non seulement n’est plus inaccessible mais elle masque maintenant les fleurs et, vu l’état de décomposition des fleurs, je me demande si ce n’est pas mieux. Qu’en pensez-vous ?
F.B. : Disons que l’horizon se rapproche, formellement, littéralement, rapidement. Vivre avec la conscience de ce mur climatique crée une ambiance. Optimiste, je ne le suis pas vraiment, mais je tiens au beau. C’est un paradoxe qu’il me faut gérer. Je dois parler de choses qui fâchent sans emphase et séduire comme les fleurs d’un photoreportage. Les fleurs ont aussi l’avantage d’être un sujet qui a priori ne dérange personne. Elles sont comme la peinture abstraite… Un lieu commun pour le peintre. Un genre en soi presque… comme peut l’être la nature morte.