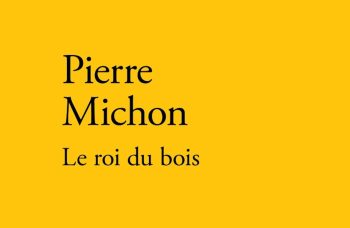Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui Vincent Ciciliato nous propose une introduction générale du dossier.
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face » (Saint Paul, Première épître aux Corinthiens 13 h 12).
« Robert Arctor s’interrompit. Les contempla, les straights dans leurs costumes de poussahs, leurs chaussures de poussahs, leurs cravates de poussahs. Il songea, la Substance M ne risque pas de leur détruire le cerveau ; ils n’en ont pas[1] ».
Visage inquiet
Là où il y a visage, il y a problématisation du pouvoir : pouvoirs éthique[2], politique[3], esthétique, technique, médiatique (qui convoque peut-être tout cela à la fois). Rien d’étonnant, donc, que le visage soit aujourd’hui le théâtre d’autant de déchirements, au travers desquels se pose à nouveau l’éternel conflit entre iconoclasme et iconodulie. Qui n’est pas uniquement une histoire de figuration, mais également de présence au monde (tangible ou simulé). Déchirements qui révèlent également des tensions propres au principe de ressemblance dont le visage incarne l’objet privilégié. Une ressemblance pourtant « inquiète » – pour emprunter une expression de Georges Didi-Huberman[4] – car « toujours passagère, migrant de-ci de-là, toujours fragile, susceptible de s’effondrer, au moindre changement pour se reconstituer ailleurs[5] ».
Mais cette inquiétude épocale – pouvant paraître à première vue positive, dans la mesure où elle permet de renouveler les plasticités et leur vitalisme matériel[6] – se borne aujourd’hui à une inquiétude (nouvelle) de la fin des temps, dont les symptômes ruissellent dans nos images contemporaines (particulièrement dans leurs formes appareillées et simulées) et dans la figuration des corps et de leurs états liminaires. Ainsi circulent, sur les épidermes vitrifiés de nos écrans augmentés, des images de corps et de visages déjà morts, « imaginés[7] » et générés par des intelligences artificielles en prise directe avec le déversement continu d’un inconscient collectif médiatisé et globalisé. Une inquiétude déréalisante surgit alors au spectacle de ces pantins moribonds qui s’adressent à nos regards orientés. Du projet thispersondoesnotexist.com[8], aux puissants générateurs d’images animés tels que Runway Gen-4, les mêmes fluidités expressives, les mêmes visages et regards dé-substantialisés, faces flottantes, éthérisées dans la brume fentanylisée des simulations génératives.

Ces signes d’une visagéité latente[9] sont investis, de manière critique, depuis le tournant des années 2020, par nombre d’artistes contemporains faisant usage de ces récentes IA. Parmi elles, les images aux corps psychotiques et délirants des univers infernaux développés par l’artiste italien, et spécialiste des effets spéciaux[10], Alessandro Bavari (Demoncracy[11], 2025). Ou, d’une manière plus utopique et iconoclaste, la série futuriste aux apparences dystopiques de l’artiste belge Sébastien Lacomblez, Burning Burning Man[12], réalisées en 2022, et inspirée de son projet OPTIMUM PARKTM[13]. Mais également, les corps et visages fluidifiés, incertains, des expériences par IA de l’artiste et écrivain Philippe Boisnard, tout particulièrement à travers sa série Paysages de la catastrophe (2022) et ses différents travaux sur les espaces latents. Auxquels s’ajoutent les corporéités liquides et plastifiées, conçues par IA, de l’artiste et philosophe Grégory Chatonsky (Perfect Skin XVII, 2023[14]). Et que dire, enfin, lorsque l’identité du visage calculé, de synthèse, supplante celle du visage réel ? Tel est le cas du projet performatif (ou « geste d’infiltration ») CNI, réalisé en 2017 par l’artiste Raphaël Fabre[15], qui, lors de son renouvellement de carte d’identité, remplace la photographie « réelle » de son visage par une image modélisée numériquement de ce dernier. Bien que ne faisant pas usage de l’IA, ce double synthétique, validé en tant qu’image d’identification du sujet physique, nous met face au même sentiment d’inquiétude déréalisante[16].

Visage contraint
Mais, bien avant l’émergence récente de ces faces aux autonomies synthétiques, l’histoire de la figuration du visage a su analyser son lien intime avec l’histoire de l’image et de sa capacité à troubler le réel et sa représentation. Et sa médiatisation technique – que ce soit du côté de sa reproduction ou de sa réception – nous pousse à en reconsidérer la nature. Comme l’indique à juste titre Hans Belting, « avec l’ère médiatique, l’histoire du visage a pris un nouveau cours » qui se caractérise par sa « consommation effrénée[17] ». Les visages sont partout, médiatisés par les affiches publicitaires, les magazines (physiques ou en ligne), les médias audiovisuels de masse, aujourd’hui les réseaux sociaux (selfies, profils Instagram[18], Facebook, autoportraits générés par IA, etc.) – partout, mais également indifférenciés, par un trop-plein de visibilité. En réponse à cette hypermédiatisation de la face – déjà en cours, sous d’autres formes, au milieu du XXe siècle – l’adoption par les artistes des médias électroniques, puis électro-numériques, sera caractérisée par une certaine forme de négociation, souvent violente, entre le cadre restrictif et contraignant imposé par l’appareil de vision et l’émergence du visage-portrait.
Ainsi paraissent, dans les pratiques vidéographiques des années 1960 et 1970, des visages isolés, extrêmement rapprochés, sur-cadrés, dévisagés. Littéralement emboîtés, encastrés[19], dans les limites réduites des écrans des moniteurs cathodiques. Tel est le cas, par exemple, de Open Book, œuvre vidéo de Vito Acconci, réalisée en 1974. L’artiste nous propose une vue rapprochée de son orifice buccal. Par la proximité induite par le gros plan, la bouche, grande ouverte, laisse paraître des dents et une langue rendus monstrueux par leur démesure. « You can go inside. It’s not a trap » (« Tu peux entrer. Ce n’est pas un piège »). Invitation devenue régurgitation onomatopéique par la contrainte musculaire opérée par l’ouverture prolongée de la bouche. Une contrainte doublée, voire imposée, par le cadre structurel du dispositif technologique employé. Nous retrouvons ce même principe de fragmentation et de limitation, et d’une certaine manière d’épuisement des fonctions corporelles, dans l’œuvre Lip Sync, réalisée par l’artiste Bruce Nauman quelques années plus tôt, en 1969. Dans cette vidéo performative de cinquante-sept minutes, il ne s’agit pas d’adapter le corps au seul cadre formel de la prise de vue, mais plutôt à certaines structures internes du média qui permettent, dans ce cas précis, la synchronisation entre le son (ici la parole) et l’image (ici la bouche de l’orateur). Le plan se concentre sur la moitié inférieure du visage de l’artiste, dont la vue est retournée verticalement. La bande-son (on entend la voix de Nauman) laisse entendre, de manière incessante, l’expression « lip sync », que les lèvres de l’artiste essayent de doubler. En vain, car la coordination et les tentatives de synchronisation au temps machinique de l’enregistrement seront mises à mal par l’épuisement résultant de son effort soutenu.
Cette procédure de synchronisation et d’« encadrement » du complexe voix-mobilité faciale[20] est également vérifiable dans l’œuvre vidéographique Primary, réalisée en 1978 par l’artiste vidéaste et performeur Gary Hill. Ici, nous observons une visagéité réduite à son maximum. Une bouche prononce de manière séquentielle les mots « red, blue, green », couleurs qui composent les couches de l’image vidéo, et qui sont appliquées au plan lorsque le mot correspondant est épelé. Cette mise en série[21] des fragments son-image-gestes faciaux, provoque un séquençage extrême du temps d’articulation du visage, contraint à outrance par le temps électronique qui le supplante. Procédure de dévisagéification électronique qui sera porté à son paroxysme par l’œuvre Modell 5 (1994) du groupe Granular Synthesis (Ulf Langheinrich et Kurt Hentschläger), par l’émiettement, généré informatiquement et en temps réel, de la continuité du geste facial. Une affection du portrait soulignant la force procédurale exercée par nos machines qui, par leurs principes contraignants, provoquent l’émergence d’une forme de visagéité médiatique symptomatique de la « crise des temps[22] » qui traverse nos corporéités contemporaines[23].
Visage et coprésence
Si les théories du cinéma, de la vidéo et des nouveaux médias (Deleuze[24], 1983-85 ; Aumont[25], 1995 ; Thély[26], 2002 ; Cauquelin[27], 2003…) ont su depuis longtemps problématiser l’articulation entre le domaine technique et la représentation du visage – à travers, par exemple, l’esthétique du gros plan, ou de sa diffusion par les réseaux – son histoire s’inscrit dans un héritage plus ancien. En effet, dès le XVe siècle, le portrait – considéré comme forme occidentale et profane de figuration du sujet individuel – s’appuie sur une articulation étroite entre : visage (du modèle), progrès des techniques de représentation, et interfaces de vision. Ainsi, l’amélioration des procédés de fabrication des miroirs (« miroirs vénitiens »), au début de la Renaissance, permettra au reflet d’investir l’espace de représentation, soit comme objet de production de l’image (le miroir en tant que modèle de figuration), soit comme sujet représenté (Saint Éloi Orfèvre de Petrus Christus, de 1449 ; Le Prêteur et sa Femme de Quentin Metsys, de 1514). Dans le premier cas, le miroir, en tant qu’appareil de vision[28], permettra, sinon l’émergence, du moins le développement de l’autoportrait en tant que forme picturale. Il induira l’émancipation de l’artiste lui conférant le statut de sujet de figuration autonome (Autoportrait de Dürer, de 1500 ; Autoportrait au miroir de Le Parmesan, de 1503). Parallèlement, son inclusion dans l’espace pictural conduira à une redéfinition de la place du spectateur, en intégrant celle-ci dans le principe de figuration de l’œuvre et en en autorisant la représentation, et par la même occasion la possible portraitisation[29], comme dans le cas des Époux Arnolfini (1432) de Jan Van Eyck. Cela contribuera également à renforcer le projet développé à la Renaissance visant à prolonger l’espace occupé par le spectateur avec celui de la représentation (l’espace qui se trouve derrière le plan du tableau). Une mise en continuité construite à partir de diverses techniques et « effets », parmi lesquels : la perspective centralisée, les techniques de trompe-l’œil, une certaine forme d’hyperréalisme des textures et des espaces. Nous voyons alors émerger la possibilité d’un certain effet de coprésence[30] induit par le face-à-face entre personnages représentés et le sujet observant, permettant leur coexistence dans un espace phénoménologique – bien que simulé – commun. Comme nous l’indique justement Hans Belting, « avec le détachement du portrait, le personnage acquiert l’espace actantiel nécessaire à la manifestation de la présence propre, une présence in imagine, produisant le même effet qu’une présence in corpore[31] ».
De nombreux portraits interactifs réalisés autour des années 1990-2000 s’appuieront sur des stratégies formelles et scénaristiques proches de celles mises en œuvre dans les portraits picturaux réalisés à la Renaissance. Leur objectif étant la mise en forme d’un « contexte[32] » (Jakobson), d’un espace de coexistence autorisant la mutualisation des présences. Un face-à-face qui sera propice au croisement des regards, aux échanges d’attentions, et permettant d’envisager la possibilité d’un échange discursif[33]. Tel est le cas de Portrait One[34] (1990), œuvre de l’artiste québécois Luc Courchesne. Le spectateur se trouve face à l’image holographique[35] d’une femme, Marie (incarnée par l’actrice Paule Ducharme), avec laquelle il peut interagir par un jeu de questions réponses. Bien que le procédé d’interaction soit composé de choix réduits, la configuration scénographique, volontairement héritée de celle du portrait pictural (choix du face-à-face, taille homothétique, cadrage au niveau du buste, utilisation du clair-obscur), permet d’inclure le spectateur dans un complexe dialogique crédible, en chargeant l’image cybernétique de Marie de cette « présence in corpore » dont parle Balting. Présence également affective et émotionnelle impliquée dans d’autres projets de la même époque, comme le portrait interactif Oscar[36], réalisé 2003 par Catherine Ikam et Louis Fléri. Ici, aucun dialogue, aucun échange discursif, seulement la présence brute – quasi naturelle – d’un visage simulé d’enfant, à échelle légèrement agrandie, encastré dans un cadre qui rejoue les signes de la forme picturale. Ou encore l’avatar Prosthetic Head[37] de Stelarc, lui aussi nourri à l’IA, réalisé en 2004. Agent conversationnel empruntant le visage de l’artiste et simulant la possibilité d’un déport (algorithmique) de la relation discursive, entre ce dernier et l’utilisateur du dispositif.

Cet effet de coprésence caractéristique du portrait interactif – qui hérite également de l’effet de présence des premiers automates[38] – se prolonge aujourd’hui dans les visages synthétiques et hyper-réalistes des avatars virtuels dopés à l’IA, disséminés dans les réseaux, ou incarnés par les récents androïdes « intelligents » tels que Sophia de Hanson Robotics, ou Erica conçu à l’Université d’Osaka. Cette interaction avec des visages réactifs déborde ici le seul domaine esthétique en enveloppant divers contextes de socialisation. Caractérisés également par cet investissement pulsionnel, voire érotique, propre à l’image-simulacre, dont le visage incarne le modèle. L’« autre image », pour reprendre les mots de Victor I. Stoichita[39] :
« l’image dont le caractère principal ne réside pas dans la « ressemblance » mais dans l’ »existence ». Construction artificielle, dépourvue de modèle original, le simulacre se donne comme existant en lui-même. Il ne copie pas nécessairement un objet du monde, mais s’y projette. Il existe[40] ».
Visage interprété
Enfin, le genre du portrait n’est pas seulement à chercher du côté de la représentation, de l’image destinée à être vue par le spectateur. Un nombre foisonnant de dispositifs automatisés font du visage individuel – et spectatoriel – un espace d’observation constant. Autour de cette « vision machinique », se concentrent aujourd’hui de nombreuses études et pratiques qui interrogent les enjeux politiques, esthétiques, sociétaux, de ces « images [souvent] invisibles[41] », qui pourtant existent et naissent de l’observation automatisée des machines (parmi elles, celles de Trevor Paglen[42], Antonio Somaini[43], Pierre Huyghe[44]). Dans le cas spécifique du visage, les techniques de reconnaissance faciale[45] et d’analyse oculaire (eye tracking ) permettent de déplacer la notion de portrait du côté de l’appareil en train d’observer le sujet. On parle bien de « portrait-robot » pour qualifier cet ensemble d’informations, d’indices, qui rendent possible l’identification et la description d’une personne donnée. Dans ce contexte particulier, la notion d’inter-face trouve le lieu adéquat de sa définition : un face-à-face, un « entre les visages[46] » – pour reprendre une formule chère à Peter Sloterdijk – entre une face réelle (celle du spectateur), et l’autre simulée (l’œil de traitement numérique). Que ce soit par des procédés d’analyse formelle, émotionnelle ou de suivi de regard, le visage est au centre du fonctionnement pseudo-cognitif de la machine, et, avec lui, celui des œuvres qui en exploitent les principes.
Parmi elles, celles de l’artiste canadien David Rokeby qui, depuis le milieu des années 1980, conçoit et programme des systèmes de reconnaissance gestuelle[47]. Au tournant des années 1990-2000, il va réaliser plusieurs œuvres à partir de la déclinaison des mêmes outils de reconnaissance faciale : Border Patrol[48] (1995), Watched and Measured (2000), Guardian Angel (2001), Taken (2002). Tous ces projets mettent en avant l’ambiguïté de ces outils, à la fois producteurs de plasticités, d’expériences esthétiques et formelles, mais reposant également sur l’invisibilité d’un œil électronique symbole de pouvoir et de contrôle sur nos corps individuels. De la même façon, Physiognomic Scrutinizer[49] (2009), de l’artiste néerlandais Marnix de Nijs, jouera sur ces principes de surveillance et de désignation automatisée en déplaçant la borne de contrôle, habituellement utilisée aux frontières étatiques, pour en faire une interface artistique. Les visages des spectateurs, scannés par un système de reconnaissance faciale, sont associés, par rapprochement de leurs caractéristiques phénotypiques, à ceux de personnages publics controversés (tueurs en série, personnages politiques, rock stars, etc.). Cette visée politique et critique est également mise en jeu dans Level of Confidence (2015) de l’artiste mexicain Rafael Lozano-Hemmer. Dans cette œuvre, Lozano-Hemmer confronte le visage du spectateur à ceux de quarante-trois élèves de l’école d’Ayotzinapa, dans la ville d’Iguala, au Mexique. À nouveau, les ressemblances phénotypiques permettent de mettre en lien, à des degrés de correspondance variables, le visage vu avec celui de l’archive.

Ce mouvement de saisie peut également déborder le principe de capture optique du visage et de son observation analytique par le biais d’une machine de vision. La capture peut en effet concerner d’autres attributs corporels, infra-organiques, tel le code génétique, tout en permettant de déduire et de générer les traits latents d’un visage. Le travail de l’artiste américaine Heather Dewey-Hagborg[50] repose principalement sur ce principe de transcodage dans le but d’« informer[51] » les traits d’un possible visage existant. C’est le cas de la série Stranger Visions, réalisée entre 2012 et 2017. À partir de traces d’ADN laissées dans l’espace public par des individus, et à l’aide de techniques d’analyse du génome humain, divers masques potentiellement « ressemblants » aux visages des personnes initiales ont été imprimés et présentés comme effigies aux traits vraisemblables. Une logique d’estimation statistique et informatisée des caractéristiques faciales qui est également en jeu dans les visages composites de l’artiste américaine Nancy Burson[52]. En renouant, d’une certaine manière, avec des pratiques pseudoscientifiques, et politiquement contestables, telles que la physiognomie. Des hybridations qui nous rappellent par la même occasion les formes recomposées, réassemblées numériquement, synthétisées, lissées, d’expériences photographiques comme celles menées par Aziz + Cucher (Dystopia, 1994), Orlan (Self hybridations, 1998-2002), ou encore Robert Gligorov (Orange Face, 1997).
En prolongeant cette proposition introductive, l’ensemble des contributions de ce dossier thématique, intitulé « Visages à contraintes : le portrait à l’ère électro-numérique », axeront leurs diverses approches à partir de cette double articulation entre, d’une part, le visage en tant qu’objet de représentation, de monstration ; de l’autre, le visage comme objet d’observation et d’analyse machinique. Il ne s’agira pas nécessairement de tisser une histoire du portrait médiatisé contemporain, mais plutôt de réfléchir aux inflexions, voire aux redéfinitions de la nature du portrait en tant que forme classique de l’histoire de l’art et de l’étude esthétique. La période privilégiée – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités.
[1] Philip K. Dick, Substance Mort (A Scanner Darkly) (1977), Paris, Folio, 2014, p. 40.
[2] Cf. Leszek Brogowski, Gwénola Druel, Anna Szyjkowska-Piotrowska dir., L’insaisissable du visage. Envoûtement esthétique et regard éthique, Rennes, PUR, 2024.
[3] Le visage, à la fois « il reproduit, il interpelle et il est fondé de pouvoir ». Cf. Jean-Luc Nancy, L’Autre Portrait, Paris, Galilée, 2014.
[4] Georges Didi-Huberman, L’humanisme altéré. La ressemblance inquiète I, Gallimard, 2023. Voir également, dans ce dossier thématique, Rodolphe Olcèse, « Envisages le cinéma. Marylène Negro et le souci des œuvres ».
[5] Georges Didi-Huberman, op. cit.
[6] C’est la thèse que développe Georges Didi-Huberman, en traitant, de manière particulière, le vitalisme de matières « inquiètes » telle que la cire, utilisée dans les sculptures votives de l’Italie méridionale, dans le chapitre du même ouvrage, « La ressemblance impure. Survivances et plasticités de la sculpture en cire ».
[7] Sur le concept d’« imagination artificielle », voir, par exemple, les travaux de Grégory Chatonsky : chatonsky.net/category/journal/ima/
[8] Plateforme permettant de générer des visages hyperréalistes, mais qui ne sont pas l’objet d’une saisie sur des visages réels.
[9] Je reprends ici l’expression adoptée par Philippe Boisnard et Grégory Chatonsky. Cf. Philippe Boisnard, « Figures de l’infigurabilité de l’espace latent », in Turbulences vidéo #128, 2024 : https://videoformes.com/magazine/. Cf. Grégory Chatonsky : https://chatonsky.net/espaces-latents/.
[10] Concept artist pour Ridley Scott (Alien : Convenant, 2017) et Luca Guadagnino (Suspiria, 2018).
[11] www.alessandrobavari.com/demoncracy
[12] Visibles sur son profil Facebook : https://www.facebook.com/serpentesnovae
[13] http://sebastien-biset.xyz/optimum-park
[14] https://chatonsky.net/category/artworks/
[15] Voir, dans ce dossier thématique, Raphaël Fabre, « CNI : Occlusion Ambiante, ou la carte d’identité et le paradoxe du portrait ».
[16] Dans son article « Persona, créer l’Autre », présent également dans ce dossier, Pauline Jurado interroge l’idée d’artificialité du double à partir de deux œuvres cinématographiques majeures Persona (1966), d’Ingmar Bergman et La Piel que habito (2011) de Pedro Almodóvar.
[17] Cf. Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017.
[18] Plusieurs contributions de ce dossier thématique questionnent, sous diverses formes, et de manière plus spécifique, cette dissémination du portrait au sein du réseau Internet : Ghislaine Chabert, « Du « visage-écran » à l’écran-visage ? Rencontres du corps de l’autre et altérités en « double face » » ; Alice Lenay, « Empreintes numériques. Miroirs et dialogues entre visage vu et visage voyant » ; Rudy Rigoudy, « @ller – retour : Instagram, entre paysage et identité » ; Marc Veyrat, « Ce[LU-i] que nous ne voyons et Ce[LU-i] qui nous regarde ».
[19] Cette « mise en boîte » du visage est traitée de manière toute particulière par Jean-Jacques Gay, dans son article « Les yeux sans visage(s) » du présent dossier. Il y interroge l’effacement du visage du spectateur par l’apposition des casques de réalité virtuelle, et l’effet d’emboîtement qui en découle.
[20] Voir à ce sujet, Vincent Ciciliato, « Visages résonnants et micro-gestualités. Nouvelles formes de visagéités dans la sphère de la création artistique contemporaine », in Lenka Stranska et Hervé Zénouda dir., The Medium is The Message : image, geste, son – une interaction illusoire ?, Paris, L’Harmattan, 2016. Ainsi que Vincent Ciciliato, « Petites affections du visage aux durées accidentées », in Leszek Brogowski, Gwénola Druel, Anna Szyjkowska-Piotrowska dir., op. cit.
[21] Sur ce rapport entre visage et sérialité, voir, dans le présent dossier thématique, l’article de Itzhak Goldberg, « Visage sériel ».
[22] Une « crise des temps » en lien étroit avec l’idée de présentisme, développé par François Hartog et Gilles Lipovetsky. Voir : François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003 ; Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004.
[23] Cet émiettement technique de la visagéité, déjà en cours dans les premiers procédés de reproduction de l’image, est en lien avec une certaine perte auratique du portrait. Dans ce dossier thématique, Carole Nosella nous propose, par une pratique artistique personnelle de la défaillance, d’en retrouver les contours et l’émanation positive, dans l’article « Visages presque invisibles : une résurgence auratique dans l’expérience de la défaillance technologique ? ».
[24] Cf. Gilles Deleuze, « L’image-affection : visage et gros plan », in L’image-mouvement. Cinéma 1, Paris, Minuit, 1983. Ainsi que Gilles Deleuze, Félix Guattari, « Année Zéro – Visagéité », in Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980.
[25] Jacques Aumont, Du visage au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard, 1992.
[26] Nicolas Thély, Vu à la webcam – Essai sur la web intimité, Dijon, Presses du réel, 2002.
[27] Anne Cauquelin, L’exposition de soi. Du journal intime aux webcams, Genève, Georg, 2003.
[28] Voir, à ce sujet, Soko Phay-Vakalis, Miroir, appareils et autres dispositifs, Paris, L’Harmattan, 2008.
[29] Bien sûr cela reste fictif. La place du spectateur étant suggérée par une silhouette déjà existante dans le tableau, à côté de l’image de l’artiste visible dans le reflet du miroir convexe.
[30] Idée proposée et développée dans un précédent article : Vincent Ciciliato, « À propos de Discursive Immanence : portraits interactifs, fiction située et réflexivité dialogique », in Marc Veyrat dir., Texte et image 5. Les fabriques des histoires, Chambéry, Publications de l’Université Savoie Mont Blanc, collection « Texte et image », 2019.
[31] Hans Belting, op. cit., p. 182.
[32] Cf. Roman Jakobson, Les fondations du langage, Paris, Éd. De Minuit, 1963.
[33] Cette réflexion a fait l’objet, par l’auteur, d’une production installée. Portrait interactif nommé Discursive Immanence (2017) et qui repose sur la mise en place d’un contexte de coprésence et de discursivité : https://www.vincentciciliato.net/discursive-immanence
[34] http://www.courchel.net/#
[35] Utilisation de l’effet du fantôme de Pepper, technique de projection optique décrite et vulgarisée dans le Magia naturalis (1558-1586) de Giambattista della Porta.
[36] https://www.ubikam.org/oscar. Catherine Ikam nous dit à son sujet : « La première nouvelle que j’ai lue de Philip K. Dick en 1976 The Variable Man, est l’histoire de l’invasion de la terre par une série d’androïdes tous plus perfectionnés que les précédents et dont le dernier modèle est un petit garçon avec un ours en peluche auquel il manque un œil. Grâce à la pitié qu’ils inspirent aux hommes, ces petits garçons envahissent la terre et la peuplent d’androïdes qui massacrent toute trace de vie ».
[37] http://stelarc.org/_activity-20241.php
[38] Parmi eux, ceux de Jaquet-Droz, de Jacques Vaucanson, de Peter Kinzing et David Roentgen.
[39] Victor I. Stoichita, L’effet Pygmalion. Pour une anthropologie historique des simulacres (2006), Genève, Droz, 2008.
[40] Ibid., p. 10.
[41] Cf. Trevor Paglen, “Invisible Images (Your Pictures Are Looking At You)”, revue The New Inquiry, 2016: https://thenewinquiry.com/invisible-images-your-pictures-are-looking-at-you/
[42] Ibid.
[43] https://www.critikat.com/panorama/entretien/dans-loeil-de-la-machine-avec-antonio-somaini/. Voir également, Ioanna Neophytou, « L’art de la contre-visualité : quand les artistes s’approprient la vision machinique », revue Turbulences #01, 2024 : https://turbulences-revue.univ-amu.fr/wp/01-ioanna-neophytou-artde-la-contre-visualite-quand-les-artistes-sapproprient-la-vision-machinique / Ainsi que Rahma Khazam, « Le regard numérique. Quand le regardeur devient regardé », in Leszek Brogowski, Gwénola Druel, Anna Szyjkowska-Piotrowska dir., op. cit.
[44] Plus particulièrement avec le projet UUmwelt (2018-24), œuvre vidéographique issue d’un processus de visualisation par IA, rendant perceptible, par l’image, l’activité imaginative humaine.
[45] Sujet traité par divers articles de ce dossier thématique, dont celui de Carole Brandon « La tradition du portrait à l’heure de la reconnaissance faciale », et de Philippe Boisnard, « De la cybernétique au visage ».
[46] Peter Sloterdijk, « Entre les visages. À propos de l’apparition de la sphère intime interfaciale », in Sphères 1 : Bulles, Paris, Fayard, 2003.
[47] Plus particulièrement à partir de son projet Very Nervous System (1986-1990).
[48] Ce projet, ainsi que les suivants, sont consultables à l’adresse www.davidrokeby.com/
[49] http://www.marnixdenijs.nl/physiognomic_scrutinizer.htm L’œuvre est abordée dans ce dossier thématique par l’article de Philippe Boisnard, op. cit.
[50] https://deweyhagborg.com/
[51] Voir, à ce sujet, l’article du présent dossier thématique, Anne Favier, « Informer les visages. Les portraits étrangers d’Heather Dewey-Hagborg ».
[52] Voir l’article de Leszek Brogowski dans ce dossier, « Des portraits composites (Francis Galton) au morphing (Nancy Burson) ».