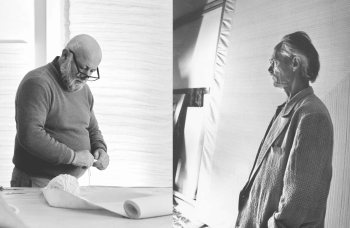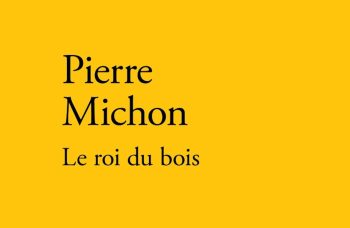Félix Trutat et son œuvre
Au musée des Beaux-Arts de Dijon se trouve une étrange Olympia : La Bacchante (1845) de Félix Trutat (1824-1848). La toile représente une femme dénudée, allongée sur un lit recouvert d’une peau de tigre. Elle regarde le spectateur. À la fenêtre, un homme dont seule l’immense tête apparaît la fixe. Disimulé par l’obscurité, il semble absorbé dans la contemplation de son sexe, caché par un tissu dont les plis en reproduisent la forme. La femme, quant à elle, est peinte avec réalisme : ses yeux sont cernés, une tache sous les aisselles suggère sa pilosité, et son teint évoque la maladie.
Le cartel indique que le modèle était probablement une femme aux mœurs légères. Elle était peut-être aussi une amie du peintre, jeune Dijonnais talentueux déjà remarqué à l’école des Beaux-Arts de la ville. Grâce à une bourse du Conseil général de Côte d’Or, Trutat rejoignit Paris et fréquenta l’atelier de Léon Cognier. Après avoir beaucoup travaillé à la reproduction des œuvres du Louvre, il réalisa La Bacchante.
Un scandale à Dijon
Satisfait de son œuvre, Trutat l’offrit au musée de ses bienfaiteurs. Ceux-ci la refusèrent. La Bacchante provoqua un scandale, à l’image de l’Olympia de Manet vingt ans plus tard. Les bourgeois de Dijon jugèrent la toile indécente. Dans sa première version, la tête de l’homme ne figurait probablement pas encore.
Selon l’historienne de l’art Sara Vitacca, la figure de la bacchante faisait partie de l’air du temps dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La littérature, la musique et les arts plastiques célébraient cette prêtresse de Bacchus. Trutat choqua car sa Bacchante ne possédait ni les attributs d’une déesse ni ceux d’une bacchante. Son éventuel lien à Bacchus se limite à un thyrse horizontal et à l’existence suggérée de son sexe. La toile montre une femme banale dans sa concrétude, et non un personnage mythologique.
Analyse plastique et inspiration
L’éclairage frontal de la femme transforme le spectateur en voyeur. Il n’a aucune échappatoire. En s’inspirant de la Vénus d’Urbino du Titien, Trutat impose au regardeur la sensation d’avoir surpris un moment intime. La composition, sans doute inspirée de La femme endormie de Dirck de Quade van Ravesteyn, reste rigide et rappelle la Vénus d’Urbino. Mais Trutat effectue des transformations fondamentales : le spectateur est confronté à une réalité incontournable. La jeune femme est éclairée de manière à capter le regard, et la deuxième partie de la scène n’offre aucune possibilité de fuite.
Le lit touche le mur de la fenêtre, et le voyeur représenté ferme toute issue. Ainsi, le spectateur se voit renvoyer sa propre immoralité, devenant le double du personnage masculin.
La modernité de Trutat
Trutat avait sans doute parachevé, avec La Bacchante, sa recherche sur la lumière commencée aux Beaux-Arts de Dijon. Il inaugurait également un travail sur la perspective. Bien qu’aguerri pour reproduire le tableau de Dirck de Quade van Ravesteyn, il choisit de rendre hommage à son prédécesseur tout en proposant une représentation peu conventionnelle d’une femme de son temps. Comme Manet le fera avec Olympia, il bouscule les règles établies par l’Académie.
Trutat mourut prématurément, pauvre et solitaire, instruit par sa seule pratique artistique. Avec La Bacchante, il participa aux commencements relatifs du modernisme, selon l’expression de Foucault.