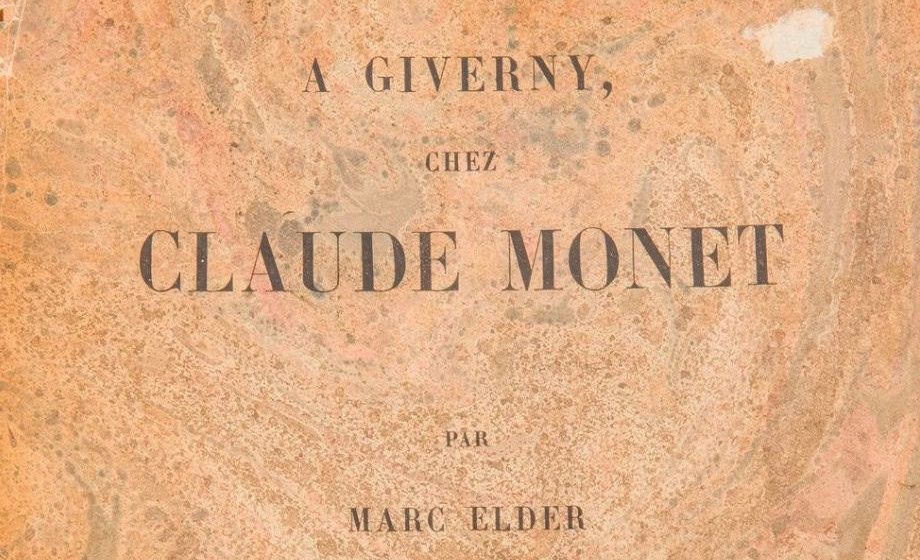À Giverny, chez Claude Monet. La couverture du livre choisie par Fayard interpelle le lecteur. Son image présente, sur fond de Nymphéas, des mains âgées serrées autour d’un bol mais la graphie du titre, par la réduction du « chez » et la mise en avant du nom de l’artiste, indique qu’il ne s’agira pas d’un récit sur la vie intime vécue par Monet à Giverny. C’est l’auteur, Marc Elder, qui rejoindra le peintre à son domicile. La Petite Collection des Éditions 1001 Nuits a en effet réédité en 2010 un texte issu des rencontres entre le lauréat du Goncourt 1913 et Claude Monet.
Comme le souligne l’historien Jean-Paul Morel dans quelques pages en fin d’ouvrage, Monet était peintre avant tout et aimait peu parler de lui. Cet entretien est donc une exception. Nous sommes au début du XX° siècle, le genre interview vient juste d’être importé des États-Unis et le mot lui-même n’est pas encore reconnu par l’Académie. Monet a donc consenti, pour faire plaisir à ses nouveaux marchands, les frères Bernheim, de s’entretenir avec un homme de Lettres, particulièrement attaché aux arts plastiques et peut-être surtout qui se trouve être son cousin éloigné.
La rencontre de ces deux hommes du siècle passé donne lieu aujourd’hui à un écrit surprenant. Les scènes s’enchaînent. Monet et Elder se promènent, voyagent en train, dînent, visitent la maison de Giverny… Elder semble endosser la figure du grand reporter mais le monde qu’il investit est celui de l’intimité d’un homme qu’il admire. Particulièrement motivé par son sujet, l’écrivain alimente cette conversation entretenue avec celui qu’il désigne comme son « cher Maître ». Il s’autorise à poser quelques questions directes mais elles sont peu intrusives et témoignent le plus souvent de sa propre culture. Il s’autorise des moments littéraires, nous faisant profiter, à sa façon, du jardin de Monet. Il révèle au lecteur ses « rosiers en sueur » et ses « nymphéas qui font la roue sur l’eau ». Face aux marines peintes par Monet, l’auteur du roman « Le peuple de la mer » est loquace. Il sent s’échapper « le vent furtif » et « flaire les acres saumures ». Monet, moins lyrique, place de nombreuses anecdotes dans les interstices laissés par son compagnon. Il raconte ses débuts en s’attardant sur les artistes qui l’ont formé. Il parle des peintres de son époque, majoritairement ses amis, de ceux aussi qui sont plus anciens. La technique n’est abordée qu’à travers les vernis. Le « pur praticien » au service de ses impressions de fleurs, d’eau, cède aussi parfois la place à l’amateur d’art. Il se laisse commenter sa collection personnelle, ses estampes japonaises. Monet reste cependant discret sur lui-même. La cataracte et le drame qu’elle a engendré pour lui, c’est Elder qui en fait le récit. Le seul moment perçant l’intimité de l’homme, et pas de l’artiste, est un bon repas pris en famille dans lequel Monet, son fils et sa belle-fille discutent cuisine avec Elder et sa femme.
Ce court texte, par le style un tantinet désuet d’Elder, recrée une atmosphère disparue. Le lecteur retrouve le type de relation dépeint par Monet lui-même dans des œuvres comme Déjeuner sur l’herbe (1865) ou Femmes au jardin (1867). Il peut savourer, un peu comme on le fait avec les bonbons de grands-mères, quelques métaphores de l’auteur. Il peut aussi imaginer les interactions des deux hommes en s’appuyant sur les réalisations de certains cinéastes. Monet, par exemple, apparaît dans le film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe. Cependant, le lecteur ne peut anticiper les dires. Cet écrit, à la fois sérieux et daté, casse la possible participation du lecteur à cet échange à deux voix d’autrefois. Les deux hommes parlent d’art et ils le font à partir d’un espace culturel qui leur est propre. Le lecteur n’en connaît pas toutes les règles. Cet entretien, réalisé avec les codes communicationnels et le langage propres à une époque révolue, lui fait sentir sa distance à ce monde. Le contexte devient étonnamment palpable. Son étrangeté révèle sa force de façon criante et, par contraste, rend intemporelles les œuvres de Monet. Le lecteur prend alors conscience que la plupart d’entre elles taisent le moment de leur création, mais surtout dépassent le sens qu’elles pouvaient y prendre.
À Giverny, chez Claude Monet, par sa réédition, rend ainsi, on ne peut mieux, hommage à un très grand artiste dont le lecteur découvre, comme l’a dit le peintre lui-même, « un tas d’histoires ». Cette conversation est suivie d’un autre texte dans lequel Monet, cette fois à la demande de son premier marchand Durand-Ruel, fait le récit chronologique de sa vie de peintre. Seul le recours au passé simple, souvent utilisé à la première personne du singulier, nous rappelle que l’impressionnisme est né à une époque particulière dans laquelle le rapport au temps différait de celui d’aujourd’hui.
Marc Elder, À Giverny, chez Claude Monet, Fayard, 2010, 160 pages