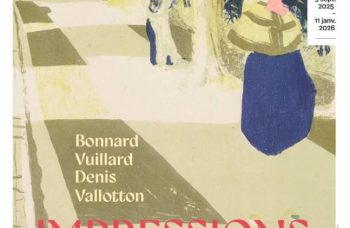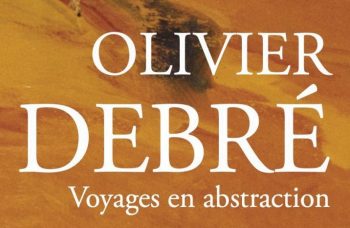Cet été, la région de la mer Égée a enduré son supplice, né de la négligence humaine et attisé par les vents ardents : les flammes ont dévoré les forêts, abandonnant derrière elles des terres devenues inhabitables, tandis que des vies s’éteignaient dans la fumée. Il est urgent d’en parler à voix haute : de la biodiversité, de la culpabilité humaine qui nourrit les flammes. C’est dans ce contexte qu’une exposition s’élève, pour montrer ces facettes, ces blessures, et rappeler la responsabilité collective face à la nature.
L’exposition Staged a ouvert ses portes le 29 mai 2025 à Arkas Sanat Alaçatı, en Turquie. Sous le commissariat de Billur Tansel, Staged explore les liens profonds entre la création artistique et la conscience écologique. À travers les œuvres et les événements qui accompagnent l’exposition, elle contribue, par la puissance de l’art, à l’édification d’un avenir durable, tout en nourrissant une conversation urgente sur notre rapport au vivant. Fidèle à la démarche curatoriale déjà observée dans les précédentes expositions de Tansel, cette proposition recentre l’urgence écologique au cœur du regard du spectateur. Elle rouvre les débats, crée des espaces de partage et réactive la perception d’un monde en crise.
Cette approche fait écho à l’article du chercheur Michael Cronin, « Thou Shalt Be One with the Birds: Translation, Connexity and the New Global Order » (2010), qui invite à « regarder sous la surface des cultures, vers le sol qui soutient leur vitalité persistante ». C’est avec cette perspective que se lisent les œuvres de Staged, à travers les médiums choisis et les langages qu’ils convoquent. Car ce qui s’écrit ici, au fil des gestes, des formes et des matières, c’est peut-être bien la scène d’un avenir encore à inventer.
Le musée se situe dans une ville dont les rivages bordent la mer Égée. Cette région, riche d’une nature endémique, abrite des espèces uniques, d’une grande diversité écologique mais particulièrement vulnérables à la destruction de leur habitat. Cette réalité entre en résonance directe avec le thème de l’exposition et le choix des œuvres présentées.
Le cadre conceptuel de Staged puise son inspiration dans l’œuvre et l’héritage intellectuel de Piero Gilardi, figure majeure de l’Arte Povera et militant écologiste. Ses créations mimétiques révèlent l’étrangeté croissante de la relation entre l’humain et la nature. Son œuvre Fiori Di Ciliegio, issue de la série Tappei-natura (1965), illustre cette tension : des parcelles de nature artificielle en caoutchouc moulé qui reproduisent légumes et plantes donnent l’illusion d’un printemps éternel. Pourtant, cette nature figée et immobile rappelle davantage une réplique que la vie qu’elle prétend incarner.
Le travail de Paul Hodgson prolonge cette réflexion avec sa performance L’Atelier du sculpteur (2025), réalisée in situ au musée. Ici, le processus performatif rejoint le geste de la récupération : des rebuts de lithographies sont réemployés pour composer une sculpture éphémère. L’acte de transformer et de réutiliser devient à la fois sujet et matière de l’œuvre, incarnant le propos curatorial autour du recyclage et de la métamorphose.
L’artiste Gül Ilgaz, qui a participé à la résidence du Banff Centre au Canada en 2004, est représentée par une photographie intitulée Taş (Pierre). Inspirée par une rencontre saisissante avec un bloc rocheux monumental, elle traduit une confrontation intime avec la permanence minérale. L’artiste explique avoir été obsédée par l’image d’une scène où elle tentait de pousser une pierre énorme, avant d’en trouver la matérialisation lors d’un voyage dans une région montagneuse de Lucerne. Cette œuvre résonne avec les images percutantes d’Ali Borovalı sur l’Antarctique et la fonte des glaciers : toutes deux questionnent la manière dont l’art rend visible les bouleversements climatiques. Ces images montrent des étendues glacées où la blancheur éclatante se dissout dans une eau turquoise inquiétante. La beauté hypnotique de ces paysages est indissociable du sentiment de perte qu’ils véhiculent.
De manière générale, les œuvres photographiques de l’exposition constituent une documentation sensible et saisissante des relations entre les êtres humains, les animaux et les paysages à travers diverses géographies. Dans un contexte artistique en Turquie où la photographie contemporaine peine encore à recevoir la reconnaissance qu’elle mérite, sa valorisation dans l’exposition prend une signification particulière. Chaque œuvre photographique contribue ici à élargir le débat et à renforcer l’impact du discours écologique.
Dans le parcours, le visiteur est surpris par l’apparition d’images de nuages s’échappant doucement d’une pièce obscure. Ce sont les nuages éphémères de Berndnaut Smilde. Alors que le rôle des nuages dans le réchauffement climatique demeure un mystère scientifique, Smilde en propose une lecture sensible : suspendus dans des espaces clos, ils deviennent les symboles d’une perte ou d’une métamorphose. Leur fragilité résonne avec les mots de la physicienne Sandrine Bony : « Les nuages naissent, évoluent, interagissent, meurent, renaissent. » En les décrivant comme des vivants, elle propose une lecture à la fois scientifique et poétique de leur cycle. À sa manière, Smilde offre lui aussi une lecture sensible de ce phénomène : ses nuages éphémères, suspendus dans des espaces clos, deviennent les symboles d’une perte ou d’une métamorphose, évoquant une expérience quasi métaphysique de la fugacité.

Cette méditation sur l’éphémère se prolonge dans la série Florilegium de Danielle Kwaaitaal. En photographiant des fleurs immergées dans l’eau salée, l’artiste altère la perception du végétal et compose un monde visuel étrange, presque surréel. Ces fleurs deviennent des créatures presque marines, fragiles et irréelles, suspendues entre la vie et la disparition. Les paysages urbains de Silva Bingaz apportent une autre nuance : ils explorent la tension entre humain et nature, mais laissent parfois apparaître une forme d’apaisement. Son regard se tourne vers les périphéries, zones liminales où les frontières s’estompent et les existences se croisent.
Listen (Écoute) (2017) de Nermin Er se présente comme une structure métallique élancée, semblable à un instrument ou à une antenne tendue vers l’extérieur. Minimaliste et silencieuse, elle semble capter un souffle ou une vibration imperceptible. Placée dans l’espace du musée, son orientation suggère l’absence d’un interlocuteur naturel : l’arbre auquel elle se destinait n’est plus là. Ce déplacement renforce la puissance de l’œuvre : elle ne se contente pas de figurer une écoute, elle met en scène une attente frustrée, le vide d’un dialogue interrompu entre humain et nature.
Dans ses aquarelles T-Vaccination: Acorn and Fig (2019), Ahmet Doğu İpek imagine des greffes impossibles entre espèces végétales. Le langage scientifique devient ici support d’une métaphore sur l’hybridation, la cohabitation improbable et la possibilité d’un territoire partagé.
Murat Morova, avec The Bird Dies, Remember the Flight (2017) et Nature Morte (2012), propose une esthétique de la fragilité. Ses œuvres, conçues à partir d’éléments naturels et de matériaux de récupération, dialoguent avec les recherches de Gilardi et interrogent la relation de l’humain aux animaux et à leur environnement.
Dans une veine plus ironique, Antonio Riello présente une vidéo intitulée Weather Wizard. Un ventilateur métallique y tourne lentement, donnant l’illusion de rafraîchir l’air. L’objet dérisoire devient métaphore d’une posture humaine face à l’effondrement environnemental : inerte, inadéquate.
L’exposition est enrichie par une sélection de lectures. Parmi elles, Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest (2021) de Suzanne Simard occupe une place particulière. L’autrice décrit les « arbres-mères » comme des centres de communication, de soin et de transmission. Cette vision écologique, poétique et interconnectée du monde végétal prolonge les réflexions portées par les œuvres.
En réunissant des artistes venus d’horizons multiples autour d’un thème aussi brûlant que celui de la conscience écologique, Staged réussit à dépasser la simple juxtaposition d’œuvres. Elle construit un discours collectif où recyclage, fragilité, hybridation et éphémère deviennent des fils conducteurs d’une réflexion sur l’avenir. Située en Turquie, sur les rivages mêmes de la mer Égée récemment marqués par les incendies, l’exposition prend une résonance particulière. Elle rappelle que l’art ne se contente pas d’illustrer la crise climatique : il en révèle les blessures, mais aussi les possibles métamorphoses.
Dans un monde où les catastrophes environnementales semblent se succéder, Staged apparaît ainsi comme un espace nécessaire de confrontation et de partage. Elle engage le spectateur à sortir du déni et à prendre part, à travers le regard, à une responsabilité collective. Loin d’esthétiser la catastrophe, elle en fait le matériau d’un récit critique et poétique, capable d’ouvrir des horizons nouveaux là où l’horizon lui-même disparaît.
L’exposition réunit les œuvres de 36 artistes, parmi lesquels Ahmet Doğu İpek, Ali Borovalı, Ali Kanal, Antonio Riello, Azade Köker, Bengü Karaduman, Berndnaut Smilde, Borga Kantürk, Burçak Bingöl, Danielle Kwaaitaal, Ergin Çavuşoğlu, Konstantin Bojanov, Ferhat Özgür, Gözde Mimiko Türkkan, Gül Ilgaz, Hayal İncedoğan, Henri Ferdinand Bellan, Ilgın Seymen, İsmail Eğler, Murat Germen, Murat Morova, Murat Yıldız, Nancy Atakan, Nazif Topçuoğlu, Nermin Er, Özgür Demirci, Paul Hodgson, Piero Gilardi, Rose Morant, Selçuk Demirel, Sibel Horada, Silva Bingaz, T. Melih Görgün, Tufan Baltalar et Willem De Haan. L’exposition est ouverte jusqu’au 4 janvier 2026.