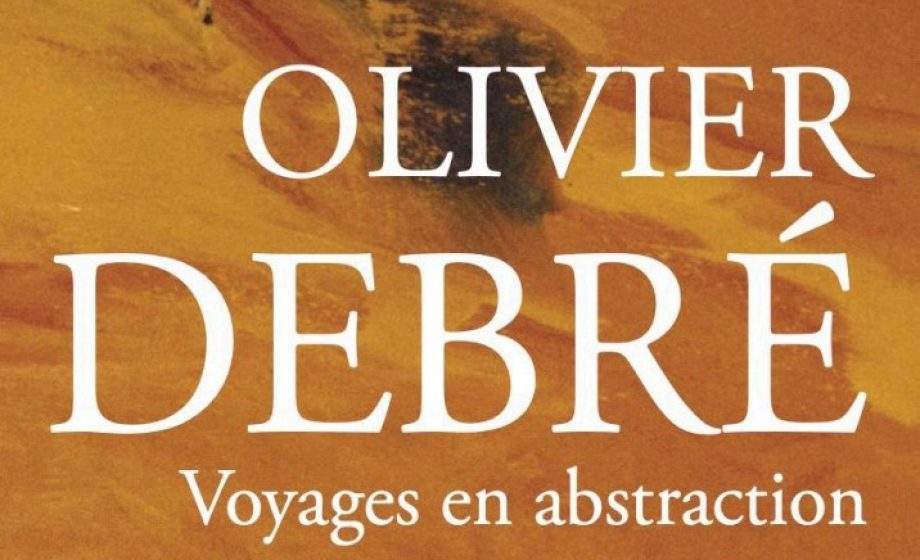Jusqu’au 2 novembre 2025, la ville de Dinard propose à la villa Les Roches Brunes l’exposition Olivier Debré, consacrée au peintre lyrique (1920-1999). Le parcours conçu par Laura Goedert, accompagnée de Françoise Wasserman, est résolument chrono-thématique, ce qui permet au visiteur d’apprécier l’évolution du peintre dans ce qui fait sa singularité au sein de sa tendance artistique : une forme de distance sans froideur.
Une première salle, consacrée aux œuvres réalisées dans sa jeunesse au moment de la guerre, fait ressortir le contraste vis-à-vis des peintres misérabilistes, comme Gruber qui, par la figuration, donne à voir par exemple l’épuisement des femmes. Chez Olivier Debré, la guerre de 39-45 a donné lieu à un ensemble de recherches picturales plus abstraites. Le peintre ne néglige pas le pouvoir suggestif du motif mais il s’en sert avant tout pour renforcer l’intensité de sa propre émotion. Par exemple, l’huile sur toile « Abstraction noire au miroir » (1946), qui reprend le principe d’insertion d’objets cher à Rebeyrolle, présente des couches de peinture noire extrêmement épaisses, dégageant une violence sourde, au point de masquer à l’œil du regardeur des nuances plus claires dessinant une forme structurée, ramassée sur elle-même. Parfois le motif rappelle le biomorphisme comme dans « le mort et son âme » (1946) où des nodules marqués par des taches d’aluminium et un trait de couleur à la craie se détachent d’un fond ocre. Picasso est également convoqué par des encres et gouaches sur papier sombres, entremêlant des formes rigides à d’autres plus souples. Dépourvues de référents explicites, les compositions laissent cependant au spectateur quelques possibilités d’interprétation. D’autres œuvres rappellent les pétroglyphes témoins des racines de l’humanité comme les sans titre de 1946 où de larges tracés noirs et violets encadrent de légers traits blancs, chargeant le fond gris de marques symboliques.
Ces différentes tentatives de représentation remplies d’émotions débouchent sur la période dite des signes. On retrouve dans les signes-personnages la technique d’empâtement, cher à Soulages, tout comme les tentatives d’expression d’un sens partageable. Dans une petite salle de l’exposition, des peintures de 1953-1954 déclinent, par un jeu sur la densité des peintures et sur leur tonalité, des façons de remplir des espaces délimités par des traits. De très près, les surfaces semblent être un agencement de nuances, et c’est de plus loin, dans une variation de gris ou de verts dominants, que les personnages se détachent. De même, face à l’immense tableau « Le Concert champêtre ou Grande brune » (1947-1952) aux nombreux aplats colorés faiblement circonscrits, c’est en prenant du recul que le spectateur reconnaît des formes.
L’exposition présente d’autres signes-personnages. Des encres sur papier, des dessins de taille humaine (1985) mais aussi des sculptures, de petites statues de bronze filiformes (1960) disposées devant une baie face à la mer, ou d’autres (1969) beaucoup plus grandes.
Dans le travail d’Olivier Debré, les signes-personnages cèdent progressivement le pas aux signes-paysages. Le format des tableaux devient classiquement rectangulaire et le peintre opte pour une plus grande légèreté dans ses compositions. Les deux œuvres réalisées autour de 1960, présentées dans l’exposition, rappelle la calligraphie en soulignant, notamment, la nouvelle fluidité du geste de l’artiste.
Ces travaux sur les signes, qu’ils soient personnages ou paysages, proviennent d’une recherche plastique intense doublée d’une autre plus intellectuelle.
Olivier Debré, parallèlement aux Beaux-Arts, a suivi des études de lettres. Il connaît la linguistique et se nourrit des découvertes de Saussure. En tant que peintre expressif, après avoir travaillé sur le sourire, il affirme l’arbitraire des traces émotionnelles. Le sourire n’a pas la même signification en France où il correspond à une émotion positive qu’au Japon où il traduit le désir de maintenir une relation. En tant qu’expressionniste, il accepte d’être le médiateur des ressentis et choisit d’en rendre compte par ses œuvres.
L’émotion du peintre se traduit dans une gestuelle qui part de lui. En ce sens, il se rapproche de Georges Mathieu, à la source de « l’expression lyrique », mais il s’en distingue en visant, a minima, une émotion ancrée culturellement. Comme Saussure a placé la valeur du signe dans une langue donnée, il va pour sa part se saisir de l’espace/plan offert par le tableau pour permettre l’expression non pas d’une émotion brute mais d’une évocation socialement identifiable. Par le choix de l’abstraction, il tente de l’enraciner dans les affects les plus profonds de l’homme. En s’instituant « peintre du réel », il privilégie les sensations que peut procurer la nature. Le geste s’enrichit alors de toute la gamme de possibles qu’offre le recouvrement de la toile. À l’écoute de l’art en train de se faire, tant dans le vieux monde ancré dans son histoire que dans le nouveau qui veut détrôner Paris, c’est cette gamme qu’il explore par la suite ouvrant la voie à ce qu’il a choisi d’appeler « l’expression fervente ».
Il joue du format et des dimensions de la toile. Il peint, par exemple, Blanche de l’Acropole (1988) ou Jaune de Loire (1991) sur des carrés rappelant le minimalisme. Il s’attaque à des œuvres monumentales comme le rideau de scène de la Comédie-Française (1 000 x 1 300 cm) dont l’exposition présente quelques travaux préparatoires. Il joue des couleurs en traduisant, autre exemple, ce que peuvent suggérer les variations de la Loire qui le fascinent. Il joue de l’amplitude de son geste, de la densité de la peinture ; il tente même d’autres matières telle la porcelaine, comme une vitrine consacrée à ce type de production permet de le constater.
Olivier Debré est un artiste reconnu qui, à la différence de Rothko qu’il avait rencontré en 1957, a pu, à travers la nature qu’il appréciait, nourrir un sentiment, non pas de tristesse comme son homologue désespéré, mais de sérénité qui transparaît dans la majorité de ses œuvres d’après-guerre.
Visiter l’exposition Olivier Debré à Dinard, à la villa Les Roches Brunes, en cette fin de saison, c’est à la fois, grâce à la proximité des toiles et à leur agencement clair, se former plastiquement, mais c’est aussi, grâce à la beauté du site et au calme qui se dégage des dernières œuvres d’Olivier Debré, prendre une bouffée d’espérance.