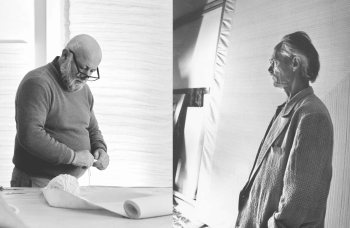Art Critique accueille un deuxième dossier thématique constitué par des chercheurs. Intitulé « Visage(s) à contrainte(s) : le portrait à l’ère électro-numérique », ce dossier coordonné par Vincent Ciciliato (artiste et Maître de conférences en Arts numériques à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne) a pour but de confronter la représentation du visage (et plus particulièrement le genre classique du portrait) à sa médiatisation technique. La période choisie – des années 1960 à aujourd’hui – tend à circonscrire un cadre historique dans lequel les technologies électroniques et électro-numériques semblent s’imposer massivement dans les modalités de construction et de réception des œuvres. Cette imposition technologique nous fait donc avancer l’idée de « visages à contraintes », au travers de laquelle se tisse ce lien d’interdépendance (« contrainte », de constringere : « lier ensemble, enchaîner, contenir »), de réciprocité immédiate, entre opération technologique et émergence de nouvelles visagéités. Aujourd’hui publions une contribution de Alice Lenay.
Le visage : surface et passage
Le numérique ne connaît pas d’épaisseur ; au contraire, il permet de traduire la densité de la matière en une série de nombres, calculables, reproductibles, transmissibles. En considérant l’épaisseur d’un visage numérique, nous voulons montrer comment l’intervention de médias numériques affecte notre apparence et produit, à partir de sa traduction en images et/ou chiffres, de nouvelles « peaux » et donc de nouvelles possibilités d’apparaître les uns aux autres.
Partons de deux approches générales du visage : la première est une méditation sur l’impossibilité de le saisir, la deuxième tente l’opération malgré tout.
La première concerne l’association du visage et de la présence. Ce « miroir de l’âme[1] » serait le lieu du désir pour la présence d’autrui qui, sans jamais nous y mener, ne cesse de nous attirer vers le lieu caché et inatteignable de sa subjectivité. Car à quoi ressemblerait une subjectivité nue se promenant dans le monde ? Pour penser l’altérité, Emmanuel Levinas choisit le visage, qu’il associe à l’idée d’infini. Le visage est la trace d’une subjectivité inassimilable, dont la description physique est insatisfaisante ; il y résiste, il la dépasse :
« C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ![2] ».
Quand on observe autrui comme une image, un objet, on n’est pas dans une « relation sociale » avec lui[3]. Le visage appelle la relation qui, selon l’éthique lévinassienne, s’établit selon des termes asymétriques : autrui me précède (il était là avant moi), et son visage m’impose de lui répondre. Reprenant cette approche, le médiologue Daniel Bougnoux parle du visage comme d’une « matière relationnelle[4] », qui s’éclaire dans l’échange. Dans son lien à une subjectivité qui me dépasse, le visage impose une définition instable, que la poésie et l’art tentent de tenir.
La deuxième approche tente quand même la description du visage et son explication. Le visage, cette partie en haut du corps chargée d’organes perceptifs et à l’interface de nos échanges, expose une série de signes et d’attributs pour mener à bien nos interactions[5]. Puisque le visage est le lieu que nous regardons pour nous reconnaître (identité), pour nous comprendre (expression, communication), mais aussi, et peut-être par conséquent, pour nous sentir avec les autres (présence), il se charge de formes construites socialement, qui fluidifient et encadrent nos rapports avec le monde. Froncement de sourcils, maquillage, piercing, sourire, croisement de regard, hochement de tête, clin d’œil : autant de signes qui peuvent être décryptés, interprétés. Le visage pourrait être considéré comme cette surface d’affichage dont l’analyse nous apporterait une compréhension plus ou moins nette de nos échanges[6]. L’épaisseur du visage n’est plus ici ce dans quoi on plonge à l’infini, mais ce dont émanent des signes identifiables constituant une personnalité. Le visage serait ainsi l’écran sur lequel apparaissent des états affectifs qui peuvent être décryptés.
La deuxième approche n’invalide pas la première. Nous pouvons envisager une sémiologie d’une surface visage qui constituerait aussi la trace d’une subjectivité insaisissable. Dire que le visage est un construit social n’empêche pas qu’il soit également l’interface vers le lieu supposé d’une présence « pure », par définition inatteignable. La subjectivité ou la présence reste médiée, et le visage – même au plus « nu » – est une de ces médiations. Nous dépendons de ces formes d’apparitions pour être au monde.
Nous pourrions donc considérer le visage comme constitué de strates, une multiplicité de couches superposées, comme un oignon : masques sociaux et culturels, attributs identitaires (maquillage posé à la surface, expressions qui y creusent des rides), jusqu’aux « ténèbres d’organes » derrière la peau, et plus loin encore, ou dans une autre dimension, l’infini d’une subjectivité qui ne peut se réaliser en phénomène.
C’est à partir de cette idée d’épaisseur formée par de multiples peaux que nous voudrions penser l’intervention de machines informatiques et audiovisuelles dans nos apparitions. Plus précisément, comment les médias numériques qui nous entourent produisent, déforment, calculent les couches qui constituent nos visages ? La fabrication de surfaces intermédiaires semble agir par-dessus ou par-dessous, en deçà ou au-delà de ce qui reste considéré comme visage, entre déshabillage (capter la structure d’un visage) et constitution de nouvelles peaux (habiller cette structure, la dissimuler, la retoucher).

Les nouvelles formes d’apparition introduites par l’utilisation des dispositifs et machines numériques constituent-elles de nouveaux moyens de se rencontrer et d’apparaître les uns aux autres ou abîment-elles nos relations, altérant l’interface de nos échanges, coupant le face-à-face d’une pleine reconnaissance réciproque ? Autrement dit : le numérique écrase-t-il l’oignon de notre visagéité, ou aide-t-il à en analyser, voire à en multiplier, les couches ?
À partir de quelques propositions artistiques contemporaines, on se demandera où se trouve le visage et quelle inter-surface (une face parmi les faces) s’impose comme visage à un moment donné.
Déshabiller rhabiller le visage
Avec Database Installation (2014), Tobias Zimmer et David Ebner mettent en scène la vidéosurveillance dans une rue de la ville allemande de Trier[7]. Entre deux caméras s’étend le mur vitré d’un local, au travers duquel s’active une imprimante. Les visages des passants qui franchissent le cadre des caméras sont identifiés et immédiatement imprimés sur du papier listing qui, aussitôt sorti de la machine, est détruit. Le visage ainsi découpé suggère une violence à l’endroit de cette saisie. Les lambeaux de papier ne maintiennent pas exposée l’identité du visage aux yeux des passants, la « protègent » en quelque sorte, mais pour mieux matérialiser le travail discret d’enregistrement qui l’aurait déjà (et pour combien de temps, sous quelle forme ?) capturée.
Le système de reconnaissance faciale repère un visage comme la concordance d’une série d’écarts entre différents points de la face. Comme une structure élastique, le calcul du visage s’adapte à la variation des modalités de présentation d’une personne (expression, maquillage, coiffure, etc.). Cette forme-visage semble être sous les traits, invisible telle quelle pour l’œil humain, une structure-squelette en somme qui serait la charpente ou « sous-couche » en deçà du visage. Dans notre stratification, nous pourrions parler ici d’un déshabillage du visage par la machine (dont le travail est par ailleurs rendu visible pour nous, par des cadres et/ou une série de points et de traits ajoutés à l’image).
Pour se protéger de ces saisies importunes, des artistes proposent des masques, sous lesquels reposerait un visage à défendre[8]. C’est cette fois une couche matérielle qui se superpose au visage pour prévenir sa captation. Avec ces masques de contre-surveillance, je peux apposer l’image d’un autre sur mon propre visage (URME Surveillance, de Leo Selvaggio, 2014), ou bien perturber les lignes d’analyse reconnues par la machine avec des masques informes (Facial Weaponization, Zach Blas, 2011-14), ou me faire des maquillages et des coiffures déstructurés (CV Dazzle, Adam Harvey, 2010), ou me poser des voiles transparents (Urban Armor #3 Miss-My-Face, Kathleen Marie McDermott, 2014) qui dissimulent pour la machine la forme visage tout en la laissant visible pour les autres.
En apposant sur le visage cette couche de silicone, de papier, de tissu ou de fard, je rends invisible mon visage pour la machine. Le visage, vulnérable dans son exposition, serait ici caché entre deux peaux : la structure-squelette de la reconnaissance faciale et le masque.
Faire bonne figure
Le système de reconnaissance faciale permet également d’associer le visage à un appareil identitaire. Cette structure d’un visage particulier, une fois captée, prend le rôle d’une clef dans les images passées et à venir de notre visage qui pourra être spécifiquement reconnu. Émancipé d’une forme particulière d’apparition, le visage informatique repose dans des bases de données, prêt à être « activé » à la recherche de son écho dans des images photos ou vidéos.
Avec Your Face is Big Data (2016), Egor Tsvetkov propose des diptyques photographiques de deux images d’un même visage : la première est prise à la volée dans les transports en commun, la deuxième est récupérée sur internet, grâce à un système de reconnaissance faciale appliqué à la première image. Egor Tsvetkov met en vis-à-vis deux présentations d’un même visage, d’un côté le visage songeur, absent, intime ; et de l’autre le visage exposé, offert, arrangé pour une photo de présentation sur un réseau social. S’agit-il de confronter l’image arrangée d’un visage qui serait plus « faux » que le visage pensif, qui « ne joue pas » et qui serait par conséquent plus authentique ? Une peau sociale par-dessus une peau plus sincère car plus solitaire, qui ne se donne pas directement dans l’interaction ?

Le premier visage, photographié dans le wagon, est cependant déjà « configuré » pour correspondre à un certain nombre de normes sociales : maquillage, coiffure et jusqu’au regard rentré en lui-même ou occupé à autre chose et qui, prenant en compte la présence d’autres usagers, n’invite pas à l’interaction (ce qu’Ervin Goffman a nommé l’« inattention civile[9] »).
La surveillance vidéo généralisée augmente l’étendue d’un regard social surplombant qui régule nos gestes et nos apparences (nous pouvons être tout le temps vus par des machines), et donc potentiellement par des êtres humains), assortie d’invitations à soi-même se surveiller et surveiller les autres (dans les gares nous sommes invités à être « attentifs ensemble[10] »). En me déplaçant dans l’espace public, je peux m’appréhender directement comme une image, sachant que mon corps est potentiellement capté par des caméras plus ou moins discrètes. Je joue alors le rôle que le cadre m’impose, pour correspondre aux attentes du film qui est fait de moi (être une bonne citoyenne dans l’espace public, ne rien voler dans le supermarché, attendre mon train sur un banc).
Cette présentation, ou mise en scène du visage, et son contrôle ont une histoire comme le montrent Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche, entre le XVIe et le XIXe siècle. En s’appuyant sur des textes de l’époque, ils observent notamment comment les traités de conversation sont ressaisis par le pouvoir en place. Richelieu par exemple « va voir dans l’usage systématique des règles de civilité, dans l’établissement d’un rituel obligé et méticuleux visant le moindre geste, le moindre regard, le moyen privilégié de dominer, de domestiquer, de contrôler, de discipliner les corps, les expressions, les propos[11] ». Le silence et la rectitude des expressions permettent ainsi de protéger l’individu de sa perte à l’extérieur de lui-même. La « contenance » consiste, comme son nom l’indique, à contenir ses expressions, à protéger du regard des autres son « visage intérieur », à ne rien laisser échapper de son état personnel, le visage étant comme un temple fermé, réservé à soi-même et à une poignée de compagnons intimes. Se développe également une crainte des bruits du corps, qui révéleraient un intérieur organique : c’est la peur « […] que quelque chose soudain surgisse du corps, s’en échappe, et que le corps risque de se répandre hors de lui-même[12] ».
Cette fermeture du visage ou son animation maîtrisée pour correspondre à la norme sociale est donc canalisée par le regard des autres et de plus en plus par le regard de machines, comme on le trouvait déjà dans l’imaginaire dystopique de George Orwell.
« Le corps de Winston s’était brusquement recouvert d’une ondée de sueur chaude, mais son visage demeura absolument impassible. Ne jamais montrer d’épouvante ! Ne jamais montrer de ressentiment ! Un seul frémissement des yeux peut vous trahir[13] » ; « L’idéal fixé par le Parti […] c’était trois cents millions d’êtres aux visages semblables[14] ».
Entre les deux visages des diptyques d’Egor Tsvetkov, fermé ou ouvert, il n’y a donc pas un visage plus authentique que l’autre. Les deux jouent selon un ensemble de mises en scène, mais aussi et par-dessus tout, les deux sont encore des images. Le visage absorbé dans ses occupations personnelles, hors de l’interaction, bien que potentielle, dans le transport en commun, est en fait déjà une image, saisie par l’appareil du photographe. D’un visage à l’autre, c’est d’abord la mise en scène de l’image qui diffère selon le contexte (espace réel ou virtuel mais public).
Partant alors directement de l’image du visage, nous pourrions nous demander dans quelle mesure elle fait justice à la personnalité de celui ou celle qu’elle représente. L’image, comme nouvelle peau, pourrait-elle parfois dire le visage mieux que le visage ?
Visage insaisissable ?
Le documentaire Z32 (Avi Mograbi, 2008) suit un ex-soldat israélien qui raconte sa participation à des représailles meurtrières contre un groupe palestinien. Pour préserver son identité, un visage numérique ajouté en post-production suit les mouvements de son visage réel.
Cette façade virtuelle évolue au fil de l’introspection sous le regard de l’objectif. D’abord, le visage est simplement flouté, puis la dissimulation prend la forme d’un masque grossier et opaque, qui figure une certaine épaisseur. Enfin, le masque numérique devient hyper-réaliste, suivant de près les contours du visage. Pour chaque étape, les yeux et la bouche restent visibles, ces parties étant soustraites à la face ajoutée en post-production et qui semble se trouver au « premier plan »[15].
La cohabitation des deux images de visages finit par se faire oublier au troisième stade de transformation. Le visage postiche semble suivre les expressions mêmes du personnage filmé, tout en maintenant l’identité du personnage anonyme (nous comprenons des expressions faciales sans savoir si elles sont le fait de la captation ou de la post-production). La dissimulation se rappelle à nous quand le visage est touché, notamment lorsque l’ex-soldat fume : la main et la cigarette révèlent la couche de pixels en la traversant. Le visage qu’on pensait pouvoir reconnaître est en fait un leurre.
De nombreuses autres productions utilisent des effets similaires (performance ou motion capture) à des fins plus réalistes. Ces techniques visent à donner vie à des personnages imaginaires, en s’appuyant sur la prestation réelle d’un acteur et son rendu numérique[16]. Le réalisme se fait plus vif lorsque le regard de l’acteur peut également être capté par la machine. La qualité de présence de l’être virtuel à l’image prend alors une tout autre portée, que les « regards synthétiques » reproduits jusqu’ici n’avaient pas[17].
Dans le film d’Avi Mograbi cependant, c’est justement la concurrence entre le visage virtuel et le visage caché qui est exploitée. Cet écart entre les deux espaces du film (espace capté / image manipulée) figure un vide dans lequel se balance la subjectivité du personnage, comme un pendule entre expression et introspection. Les deux peaux du visage (image saisie par l’objectif et pixels ajoutés en post-production) sont comme cousues l’une à l’autre pour figurer la dépersonnalisation du personnage. Le visage est au cœur de l’enquête personnelle, il est le problème à résoudre, le lieu à rejoindre, une apparition à (re-)conquérir.
Mais le chemin peut-il être parcouru ? Pouvons-nous (nous) saisir le visage pour nous saisir nous-mêmes ? Dans le film d’Avi Mograbi, le visage est littéralement insaisissable : le personnage passe au travers. Le trouble produit suggère alors une absence, la caresse ratée pointe métaphoriquement un lieu intangible. En cela, le masque agit aussi comme une condamnation : le soldat est privé d’un visage, il est affublé d’un faux. Peut-être même que le visage numérique n’est pas là pour dissimuler le visage humain, mais pour mieux couvrir un corps machine, rouage d’une guerre, ou rendu monstrueux par son meurtre. C’est la thèse d’Ophir Levy : la post-production ajouterait une « peau humaine (quoique numérique) pour recouvrir la surface froide de la machine, de l’homme devenu machine[18] ». Z32 affiche une dépendance à l’image qui permet à l’ex-soldat de se montrer.
Pouvons-nous à notre tour considérer notre corps directement pour l’image qu’il devient, dans les captations qui sont faites de lui et leurs modifications potentielles ? Pouvons-nous considérer les images de nos visages comme nos nouveaux visages, nos nouvelles « peaux » ?
Faire sa mue
De plus en plus, le corps peut s’arranger en fonction de l’objectif qui le captera. Simone C. Niquille montre comment le maquillage s’adapte, non pas à celles et ceux qui verraient ma peau, mais à la qualité de l’objectif, et donc à celles et ceux qui verront mon image. Elle prend l’exemple d’une première de film où l’actrice Nicole Kidman apparaît à travers les objectifs comme pleine de poudre blanche. Le maquillage pensé pour la HD reflète la lumière différemment, et le produit cosmétique utilisé a ici été sorti de son contexte d’utilisation[19].
Simone C. Niquille montre également comment le visage peut se modifier chirurgicalement : »The FaceTime Facelift » permet d’éviter, lors d’un lifting, la cicatrice disgracieuse sous le menton, rendue particulièrement visible lors de conversations visiophoniques où la caméra, posée avec le téléphone ou l’ordinateur sur les genoux ou la table, capte le visage en contre-plongée[20]. Suivant toujours la réflexion de Simone C. Niquille, nous pourrions aussi bien ne plus modifier notre corps organique mais seulement l’image qu’il produit :
« Au lieu de subir un « Facelift FaceTime », vous pouvez imprimer en 3D un implant de menton personnalisé […]. Comme nous changeons de tenue au jour le jour, pourquoi ne pouvons-nous pas changer également de visage ? Peut-il y avoir des distributeurs de visages à emporter ?[21] »
David Le Breton, observant l’évolution du corps dans les sociétés occidentales, développe l’idée d’un corps devenu encombrant et destiné à disparaître : « Face à l’écran le sujet est pareil à l’astronaute dans sa capsule, son corps est une épaisseur encombrante qui l’empêche de connaître la perfection du réseau en devenant lui-même information pure sans plus vivre de limites[22] ». Le corps organique deviendrait le support de transformations, un canevas pour fabriquer des images, et l’avenir nous inviterait à abandonner certaines couches de nos apparitions, à nous défaire de notre peau physiologique pour faire, en quelque sorte, notre mue.
L’historien Hans Belting montre aussi cette émergence de plus en plus claire d’une confusion entre corps et images. On intervient sur le corps comme on intervient sur les images : « La nouveauté de la crise réside dans une inversion : les images renvoient moins au corps que le corps ne renvoie aux images[23] ». Un retournement supplémentaire intervient alors dans cette « relation corps-image » quand « à partir d’images, nous faisons des corps[24] ». Dans son dernier livre sur la question du visage, il évoque une émission de télévision sur MTV, I want a famous face, qui consiste à modifier chirurgicalement son corps pour ressembler à des stars, en somme, des images[25]. Les images, comme des miroirs déformés, finissent par modeler nos visages. Nous nous adaptons aux images, arrangeant notre propre visage pour imiter ces modèles (nos visages retouchés ou ceux des autres), sorte de peau commune dans laquelle nous essayons de nous fondre.
Il y a donc encore des peaux fantasmées, des peaux qu’on voudrait avoir, qu’on s’imagine porter. L’homogénéisation de ces mises en scène de visages fait que d’une certaine façon nous partageons ces nouvelles peaux, faites d’un même tissu comme on dirait d’un même modèle. L’épaisseur du visage se dissout, pour s’affirmer dans une pure surface, indépendante des racines organiques qui l’ont générée.
Surface flottante
Catherine Ikam et Louis Fléri explorent les limites de ces surfaces de visage, détachées de leurs « donneurs ». Les Point Clouds Portraits sont des recompositions de modèles, faits à partir de scans volumétriques pris par soixante-quatre appareils photos, et traduits en « nuages de points[26] ». Ces « nuages » sont « un ensemble de points de données dans un système de coordonnées à trois dimensions »[27]. Il est possible de modifier les informations sur la réflexion lumineuse et colorimétrique du modèle de chacun des points qui forment le portrait (plus d’un million par portrait). Il ne s’agit donc pas de pixels issus d’une même image qu’on aurait déchirée, chaque particule peut être éclairée séparément et possède un comportement autonome[28]. Une fois captées, ces peaux numériques modélisées à l’écran prennent une forme d’indépendance.
Explorant la présence qui peut se dégager de ces visages, Catherine Ikam et Louis Fléri tentent de leur donner une forme d’intentionnalité[29]. À partir des mouvements du visiteur, l’image du visage se déplace, apparaît et disparaît. D’abord dans un mouvement d’imitation, le visage semble suivre les déplacements du visiteur, mais cette impression de synchronie est ensuite contrariée : le visage se détache, échappe dans l’image, soit par des effets de zooms et dézooms, soit par l’éclatement des particules qui le composent.
Il suffit donc d’une forme visage pour que les sculptures mouvantes faites de points deviennent comme des personnages qui invitent à l’interaction en reproduisant une forme de face-à-face. Cette fine membrane de peau craquelée est la garante d’une idée deprésence, elle l’empêche de s’écouler. Quand les visages virtuels volent en éclat, c’est l’impression de présence qui s’évanouit aussi.
Nous touchons ici à une surface visage indépendante, flottante (peut-être comme les premières couches sèches détachées de l’oignon, encore bombées mais déjà vides). Loin de la chair, muqueuses et vaisseaux sanguins, os ou globes oculaires, les portraits sont ici des modelages de matière numérique et de vide ; non pas un aplat mais une sculpture dynamique, un paysage qui se navigue, se traverse ou s’observe de l’intérieur. Derrière cette peau virtuelle qui semble se fissurer, comme un masque troué de courants d’air, il n’y a donc rien d’autre qu’un fond noir pour une lumière artificielle.
Seule persiste la reconnaissance d’une forme qui réagit à ma présence. Au plus « nu », ces surfaces fines, dont la forme échappe par moments, suggèrent que c’est d’abord dans l’interaction d’un face-à-face que se trouve le visage[30]. En cherchant les limites du visage, Catherine Ikam et Louis Fléri font émerger la fragilité de ce à quoi tient la présence : la forme signifiante d’une unité visage, et sa sensibilité à la présence du visiteur. Le visage flotte, il ne s’accroche pas, il navigue et se révèle dans l’interaction.
Visage-interface
Ces exemples témoignent d’un désir de savoir. Nous cherchons à comprendre le visage, à le saisir, à l’ouvrir, à le creuser, à le découvrir plus en profondeur, pour tenter de lui faire révéler ce qu’il semble cacher. Les médias numériques investissent cette quête en le dédoublant, le superposant, créant des écarts qui nous permettraient d’avancer, d’aller, comme le disait Walter Benjamin en comparant le caméraman au chirurgien, sous la peau du réel[31]. Ces médias permettent de voir « plus loin » (au sens d’autrement) que l’œil humain, de voir l’invisible[32]. « La peau n’est plus la limite opaque de corps rendus transparents par ces nouvelles technologies de l’image qui reculent les limites du visible comme autrefois la lunette de Galilée »[33].
Mais que trouve-t-on « sous » le visage ? À quoi nous mène cette quête ? Pour comprendre le visage, il semble vain de chercher à le transpercer, à le pénétrer – à moins qu’on ne cherche à comprendre son anatomie. Celui-ci se tient dans cette tension : il se donne à travers une série de signes, mais à laquelle il ne peut se réduire, échappant à la forme qui le définit pourtant. Giorgio Agamben expose cette ambivalence du visage : le visage est à la fois l’exposition irrémédiable de l’humain, son ouverture, et en même temps sa dissimulation[34]. Nous ne sommes pas « autre chose que cette dissimulation et cette inquiétude dans l’apparence[35] ».
« Le visage n’est pas simulacre, dans le sens de quelque chose qui dissimule et masque la vérité : il est la simultas, l’être-ensemble des multiples faces qui le constituent, sans qu’aucune d’elles soit plus vraie que les autres[36] ».
Le visage se diffuse donc dans la médiation, il est interface, face entre deux faces, peau entre deux peaux, et la multiplicité des couches et des analyses qu’on pourrait lui appliquer fait partie de ce système de médiation. Il n’y a donc pas de visage intérieur, il n’y a que des peaux superposées, tournées vers l’extérieur et ces couches constituent – comme l’oignon – sa substance même.
Ce rapport à l’extériorité suggère que le visage est d’abord ce qui est reconnu comme tel par un autre visage, dans l’interaction même. Comprendre le visage dans son lien à la subjectivité, c’est comprendre qu’il est toujours d’abord « pour autrui ».
[1]À l’entrée « Visage », rédigée par Louis de Jaucourt dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :
« Visage (Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Médecine) partie externe de la tête ; le philosophe dirait, c’est le miroir de l’esprit ; mais nous ne sommes ici que physiologistes, anatomistes, il faut se borner à son sujet ». Voir également le De Oratore, III, 22 de Cicéron.
[2] Emmanuel Levinas, Éthique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 2014 [1982], p. 79.
[3] Ibid.
[4] Daniel Bougnoux, « Faire visage, comme on dit faire surface », in Les cahiers de médiologie n° 15, 2003, p. 31.
[5] On peut parler ici, suivant le sociologue Erving Goffman, de « faces » : « On peut définir le terme de face comme étant la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier », p. 9. La face n’est pas logée à l’intérieur ou à la surface de son possesseur mais « diffuse dans le flux des événements de la rencontre, et ne se manifeste que lorsque les participants cherchent à déchiffrer dans ces événements les appréciations qui s’y expriment », p. 10. Erving Goffman, Les Rites d’interaction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974.
[6] On a essayé de fixer ces signes, y compris biologiquement. Une des plus célèbres physiognomonies est celle de Johann Kaspar Lavater, mais on peut remonter à des traités antiques ou aux leçons de physiognomonies médiévales latines et arabes. Voir là-dessus Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche qui expliquent que l’objet de la physiognomonie n’est pas tant le visage que la figure : « la figure c’est ce qui fait signe dans le visage », Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche, Histoire du visage, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2007 [1988], p. 43.
[7] On peut consulter une vidéo de l’installation à cette adresse https://www.tobiaszimmer.net/projects/database.php
[8] Le lexique guerrier est souvent utilisé pour ces propositions de masques : « Facial weaponization » chez Zach Blas, « Fashion guerilla » chez Adam Harvey, « Urban Armor » chez Kathleen McDermott, etc.
[9] Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 2 : Les relations en public, Paris, Les Éditions de Minuit, 1973.
[10] Jérôme Thorel, Attentifs ensemble !, Paris, La Découverte, 2013.
[11] Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche, Histoire du visage, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2007 [1988], p. 195-196.
[12] Ibid., p. 181.
[13] George Orwell, 1984, Paris, Gallimard, 2016 [1949], p. 53.
[14] Ibid., p. 103.
[15] Ophir Levy parle de « trous d’expressivité ». Ophir Levy, « Sous la peau numérique. Z32 d’Avi Mograbi », in Réel/Virtuel n° 1, février 2010.
[16] Anaïs Kompf, « L’humain et son double : esthétique du masque dans le cinéma hollywoodien d’aujourd’hui », in Patrick Louguet, Fabien Maheu dir., Cinéma(s) et nouvelles technologies [continuités et ruptures créatives], Paris, L’Harmattan, 2001, p. 268.
[17] Ibid., p. 275.
[18] Ophir Levy, « Sous la peau numérique. Z32 d’Avi Mograbi », in Réel/Virtuel n°1, février 2010, p. 5.
[19] Simone C. Niquille, FaceValue, Sandberg Institute in Amsterdam, 2013.
http://sandberg.nl/design/essays/2013/simone-c-niquille/
[20] Ibid., FaceTime Facelift, « a medical procedure developed to improve the way you look while video chatting, was developed by Dr. Robert Sigal in Virginia, USA, in 2012. It is named after Apple’s FaceTime video chatting feature for the iPhone 4 ».
[21] Ibid. « Instead of undergoing a FaceTime Facelift, you can 3d print a custom chin implant on demand at shapeways.com. As we change our outfit day to day, why can’t we change our face as well? Can there be face vending machines for on the go ? ». Par ailleurs, Raphaël Cuir suggère une parenté entre le développement simultané de la chirurgie esthétique et celui de la retouche informatique des images, Raphaël Cuir, « Peaux virtuelles, chairs hybrides, imaginer nos corps à l’âge digital », in Gérard Leblanc, Sylvie Thouard dir., Numérique et transesthétique, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 169.
[22] David L. Breton, « Vers la fin du corps : cyberculture et identité », in Revue internationale de philosophie, 2002, n° 222, p. 495.
[23] Hans Belting, « Images réelles et corps fictifs », in Le Monde, jeudi 27 février 2003.
[24] Ibid.
[25] Hans Belting, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017, p. 281-282.
[26] Rétrospective au Centre d’Enghien-les-Bains Points Clouds Portraits, 2016.
[27] Catherine Ikam, catalogue d’exposition, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 2016, p. 30.
[28] Ibid., p. 30. « chaque élément contient des informations sur la colorimétrie du modèle et ses propriétés de réflexion de la lumière, sur lesquels il est possible de jouer. » Développement des programmes : Thomas Muller.
[29] Ibid., p. 115 notamment. Catherine Ikam se confronte aux questions de l’altérité avec la création de personnages ou de visages virtuels à la vie propre qu’elle explorait déjà dans les années 1990. « En deux décennies, Catherine Ikam et Louis Fléri sont parvenus à transformer L’Autre (1992), simple masque, en Elle (1999), réalité virtuelle, puis en Faces (2014), visage fragmenté et reconstitué. L’art du portrait, revisité. Les sourires se superposent, une émotion nouvelle se diffuse dans le mouvement et la gaîté », Alexia Guggémos, « Digital art : Catherine Ikam, artiste du sourire, poétesse de la surprise », Huffington, 2014. http://www.huffingtonpost.fr/alexia-guggemos/exposition-catherine-ikam_b_5933820.html
[30] Ibid.
[31] Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Gallimard, 2008 [version de 1939], p. 38
[32] À ce sujet, l’inestimable contribution de Harun Farocki, et des images opératoires.
[33] Raphaël Cuir, « Peaux virtuelles, chairs hybrides, imaginer nos corps à l’âge digital », in, Gérard Leblanc, Sylvie Thouard, Numérique et transesthétique, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 166.
[34] Giorgio Agamben, Moyens Sans Fins, Paris, Rivage, 2014 [1995], p. 103.
[35] Ibid., p. 107.
[36] Ibid., p. 111-112.